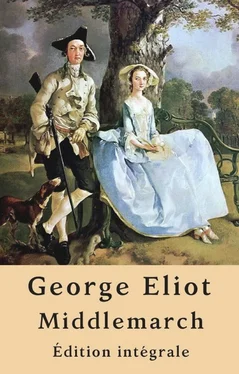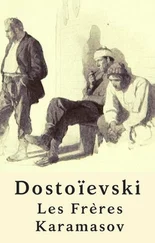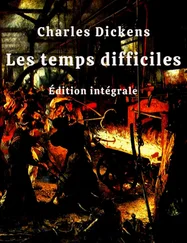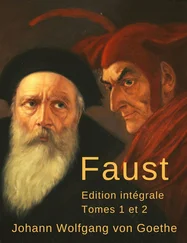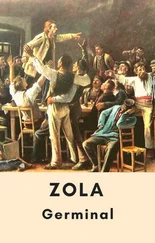Quant à M. Brooke, il croyait aux bonnes intentions de chacun. Il ne s’était pas jusqu’ici occupé en personne des affaires de l’hospice, malgré le vif intérêt qu’il prenait à tout ce qui se faisait pour le bien de Middlemarch ; aussi était-il enchanté de se rencontrer avec ces différents gentlemen pour discuter une question publique quelconque.
– Je suis très occupé de mes devoirs de magistrat et de la collection de toutes sortes de pièces justificatives ; mais je considère que je dois mettre une partie de mon temps à la disposition du public. – Et, en résumé, mes amis m’ont convaincu qu’un chapelain rétribué était une bonne chose, et je suis heureux de pouvoir venir ici et de voter pour M. Tyke, qui, à ce que j’entends dire, est un homme exceptionnellement apostolique, éloquent et tout ce qui s’ensuit ; et je serai le dernier à m’abstenir… suivant les circonstances, vous savez.
– Il me semble qu’on ne vous a farci la tête que d’un seul côté de la question, dit M. Frank Hawley, qui n’avait peur de personne et qui, en sa qualité de tory, soupçonnait volontiers partout des manœuvres électorales. Vous semblez ignorer que l’un des hommes les plus dignes que nous possédions a rempli ici, pendant des années et sans rétribution, le poste de chapelain, – et que c’est à lui qu’on propose de substituer M. Tyke.
– Je vous demande pardon, monsieur Hawley, dit Bulstrode ; M. Brooke a été mis tout à fait au courant du caractère et de la situation de M. Farebrother.
– Par ses ennemis, cria M. Hawley.
– Messieurs, dit M. Bulstrode avec calme, tous les points de vue de la question peuvent être établis en peu de mots ; et, si quelqu’un, ici présent, soupçonne qu’un de ces messieurs, sur le point de voter, n’en ait pas eu pleinement connaissance, je puis ici même récapituler les considérations qui influeraient sur l’un et l’autre parti.
– Je n’en vois pas l’utilité, dit M. Hawley. Je présume que nous savons tous pour qui nous allons voter. Quand on aime la justice, on n’attend pas à la dernière minute pour connaître les deux côtés d’une question. Je n’ai pas de temps à perdre et je propose que l’affaire soit mise aux vois immédiatement.
Une courte mais chaude discussion s’engagea encore avant que chacun écrivît « Tyke » ou « Farebrother » sur un morceau de papier et le glissât dans un large verre à boire ; dans l’intervalle Bulstrode vit entrer Lydgate.
– Je m’aperçois que, jusqu’ici, les votes se partagent également, dit Bulstrode d’une voix claire et perçante. Puis, regardant Lydgate : Il y a encore un vote à donner, un vote décisif. C’est le vôtre, monsieur Lydgate ; voulez-vous avoir la bonté d’écrire ?
– C’est une affaire réglée alors, dit M. Wrench en se levant. Nous savons tous pour qui votera M. Lydgate.
– Vous semblez mettre dans vos paroles une intention particulière, monsieur, dit Lydgate en tenant son crayon en l’air.
– Je veux dire tout simplement qu’on s’attend à ce que vous votiez avec M. Bulstrode. Cette supposition vous paraît-elle offensante ?
– Elle pourrait l’être pour d’autres. Mais cela ne m’empêche pas de voter avec lui.
Lydgate écrivit immédiatement le nom de « Tyke ».
*
* *
C’est ainsi que le révérend Walter Tyke devint le chapelain de l’hospice et que Lydgate continua à collaborer avec Bulstrode. Il se demandait sincèrement si, après tout, Tyke n’était pas le candidat le plus convenable à l’emploi ; mais sa conscience ne lui disait pas moins que, s’il eût été libre de toute influence indirecte, il eût voté pour M. Farebrother. Cette affaire resta dans sa mémoire comme un point douloureux, une circonstance dans laquelle les mesquines influences de Middlemarch avaient pesé trop lourdement sur lui.
Cependant M. Farebrother continua à lui témoigner la même amitié. Le vicaire de Saint-Botolphe n’avait rien d’un pharisien ; à force de se répéter à lui-même qu’il était trop semblable à tous les autres hommes, il était devenu étonnamment différent d’eux en ceci : qu’il savait excuser les autres de penser légèrement sur son compte, et qu’il savait juger impartialement leur conduite, alors même qu’ils lui faisaient tort.
– Le monde a été trop lourd pour moi, je le sais – dit-il un jour à Lydgate. – Mais aussi je ne suis pas un homme fort ; je ne serai jamais un homme de renom ; c’est une jolie fable que celle d’Hercule entre le vice et la vertu ; mais Prodicus rend la tâche trop facile au héron, comme si, une fois à l’œuvre, les premières résolutions suffisaient. Une autre fable nous dit qu’il en vint à tenir une quenouille et qu’il finit par revêtir la tunique du centaure Nessus. Je veux bien croire qu’une bonne résolution puisse maintenir un homme dans la bonne voie, à la condition toutefois que les circonstances lui viennent aussi en aide.
La parole du vicaire n’était pas toujours encourageante. Il avait échappé à toute ressemblance avec le pharisien, mais il n’avait pas échappé à ce naufrage des illusions sur les possibilités de la destinée auquel nous amène bien vite l’examen des conséquences de nos fautes.
Lydgate trouvait qu’il y avait en M. Farebrother une déplorable faiblesse de volonté.
Alors que George IV régnait encore dans les solitudes de Windsor, que le duc de Wellington était premier ministre, et M. Vincy maire de la vieille cité de Middlemarch, mistress Casaubon, née Dorothée Brooke, avait entrepris son voyage de noces à Rome. À cette époque, c’est-à-dire il y a quarante ans, le monde était en général plus ignorant du beau et du laid qu’il ne l’est aujourd’hui. Les voyageurs arrivaient rarement la tête ou les poches pleines de renseignements exacts sur l’art chrétien. Le romantisme, qui a contribué depuis, par l’amour et par la science, à combler certaines lacunes obscures n’avait pas encore pénétré ces temps de son levain et n’était pas entré dans la nourriture journalière de chacun ; il était encore, sous la forme d’un vigoureux et bruyant enthousiasme, à l’état de fermentation dans l’âme de certains artistes allemands à longs cheveux qui étudiaient à Rome, entraînant parfois dans le mouvement des idées nouvelles les jeunes gens des autres nations qui travaillaient ou flânaient à côté d’eux.
Par une belle matinée, au Vatican, un jeune homme, dont les cheveux n’étaient pas démesurément longs, mais abondants et bouclés, et dont l’équipement dénotait d’ailleurs un Anglais, venait de tourner le dos au torse du Belvédère, pour regarder le magnifique paysage de montagnes qu’on aperçoit du vestibule circulaire voisin. Il était assez absorbé dans cette contemplation pour ne pas remarquer l’approche d’un jeune Allemand qui venait à lui d’un air animé, et qui, lui mettant une main sur l’épaule, l’interpella avec un accent prononcé : « Venez vite par ici ! Pourvu qu’elle n’ait pas déjà changé de pose ! »
Les deux jeunes gens passèrent rapidement auprès du Méléagre, se dirigèrent vers la salle où l’Ariane couchée, alors appelée la Cléopâtre, repose voluptueusement dans sa beauté de marbre, entourée des plis harmonieux de sa draperie, comme d’une tendre corolle. Ils arrivèrent à temps pour voir, appuyée contre un piédestal, auprès du marbre blanc de l’ Ariane, une autre statue vivante, qui ne pâlissait pas à côté de l’ Ariane, une jeune femme habillée de draperies grises, à la façon des quakers ; son long manteau, agrafé au cou, était rejeté de chaque côté des épaules ; elle avait la joue appuyée sur sa main, dégantée, et de forme admirable, son chapeau de castor blanc légèrement repoussé en arrière et faisant à un visage une sorte d’auréole, autour de ses cheveux noirs, simplement tressés. Elle ne regardait pas la statue voisine ; ses grands jeux fixaient rêveusement un rayon de lumière qui venait tomber sur les dalles. Aussitôt qu’elle s’aperçut de la présence des deux étrangers qui s’étaient arrêtés brusquement, comme pour contempler la Cléopâtre, sans les regarder, elle se détourna et s’empressa d’aller rejoindre une femme de chambre et un courrier qui flânaient un peu plus loin dans la salle.
Читать дальше