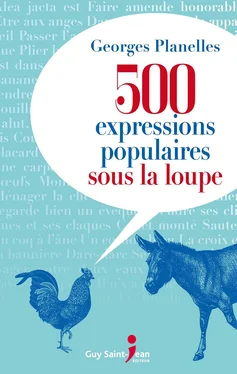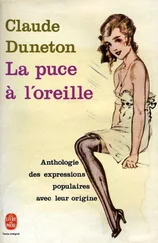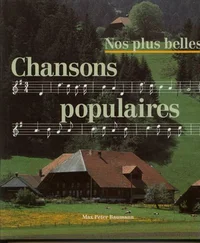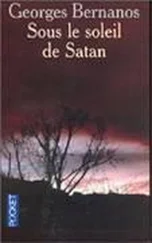Le 10 mai, si je suis élu, c’est bien que j’ai la majorité, pardonnez cette vérité de La Palice.
François Mitterrand —
Débat télévisé au second tour de l’élection présidentielle — 1981
Quand on dit beaucoup de lapalissades, on n’est qu’un sot, mais quand on dit un mensonge, on est un malhonnête homme.
Charles Péguy —
Œuvres en prose — Gallimard — 1987
494. Des vertes et des pas mûres
1. Des choses choquantes, grossières, incongrues.
2. Des ennuis, des difficultés.
Au XIII esiècle, si on parlait « du vert et du mûr », c’était bien pour opposer le blé vert au blé mûr. Mais ici, le vert n’est pas dans le fruit.
En effet, c’est au début du XV esiècle qu’on commence à dire « en bailler de belles, des vertes et des mûres » en voulant dire « raconter des histoires licencieuses ». Car « vert » prend ici le sens argotique qu’on lui connaît encore aujourd’hui pour qualifier des propos osés. Quant à « mûr », c’est depuis le XII esiècle qu’il est équivalent à « adulte » comme on le trouve dans « l’âge mûr ». Or, des propos osés ne doivent être prononcés et entendus que par des adultes, bien entendu.
Ce n’est que plus tard que cette expression initiale a été transformée et qu’aux « vertes » ont été accolées des « pas mûres » pour créer ce qui paraît être une répétition plaisante, mais qui n’en est pas réellement une pour qui connaît le sens réel de notre « vert ». L’expression prend son premier sens lorsqu’elle est précédée de « en entendre » ou « en raconter ». Par extension, des choses choquantes ou incongrues, on est passé aux ennuis ou aux difficultés, et l’expression est alors généralement précédée d’un « en voir » ou « en subir ».
Au service clientèle de SFR, les appels pour dépannage de mobile vont bon train […]. On nous en raconte des vertes et des pas mûres comme « Mon chien a mordu mon mobile » ou « Mon mobile est tombé dans la cuvette des W-C. »
Mobile Magazine — Juin 2001
Et pourtant, tu sais, depuis que je fais ce métier, j’en ai vu des vertes et des pas mûres… Oui, bien sûr. Chloé aussi en a vu des vertes et des pas mûres. Même si elle a à peine dix-neuf ans.
Claude Vaillancourt —
Les années de batailles — Québec Amérique — 2008
495. Prendre des vessies pour des lanternes
Se méprendre de façon absurde et naïve.
Sous sa forme actuelle, cette expression est attestée au XIX esiècle. Mais les linguistes Rey et Chantreau donnent les formes plus anciennes : « vendre vessie pour lanterne » dès le XIII esiècle, puis « faire de vessies lanterne ».
Il existe au moins deux hypothèses sur l’origine de cette expression. La première part de ces vessies de porc (comme de bœuf) qui étaient autrefois gonflées et séchées pour servir de récipient, mais qui, pour profiter de la transparence de leur paroi, étaient parfois utilisées en lanternes de secours, une fois une bougie allumée placée dedans. Du coup, il était facile de faire croire au nigaud de passage qu’une telle vessie pendue au plafond était une lanterne, en raison de leur similitude de forme.
La seconde hypothèse juxtapose le mot « lanterne », utilisé autrefois au pluriel dans le sens de « fadaises, absurdités », et « vessie » dans l’expression « vendre vessie », qui voulait dire « vendre du vent », en raison de l’air qui gonfle ladite vessie, enveloppe de très peu de valeur.
Quoi qu’il en soit, Pierre-Marie Quitard, dans son Dictionnaire étymologique, historique et anecdotique des proverbes , évoque le calembour suivant : « Un jour qu’on parlait dans une société du chirurgien Daran, inventeur des sondes en gomme élastique dites bougies, qu’on introduit dans le canal de l’urètre, une dame demanda au marquis de Bièvre : “Quel est donc ce Daran dont il est si souvent question ? — Madame, répond-il, c’est un homme qui prend des vessies pour des lanternes.” »
On rit de celui qui prend des vessies pour des lanternes, car il s’agit d’une grossière méprise. On ne doit pas rire de ceux qui prennent l’argent pour le bonheur. Car rien ne ressemble plus au bonheur authentique que l’argent.
Martin Blais —
L’échelle des valeurs humaines — Fides — 1980
496. Un vieux de la vieille
1. Un vieux soldat (sous le I erEmpire).
2. Une personne très âgée ayant acquis une vaste expérience dans un domaine précis.
Un vieux, on sait ce que c’est. Mais s’agit-il bien de la vieille du vieux dans cette expression ? Eh bien, s’il n’y a aucun doute sur « vieux », il est certain que vieille ne désigne pas ici sa moitié. Cette locution, qui date du XIX esiècle, est en effet une version courte de « un vieux de la vieille garde », car c’est bien de soldats d’une garde qu’il est question ici. Mais quelle garde, me dira à juste titre celui qui a suivi jusqu’ici ? Car la France en a connu de nombreuses. Il s’agit en fait de la garde impériale créée par Napoléon I eren 1804. Composée d’environ 100 000 hommes, c’était une troupe d’élite divisée en une vieille, une moyenne et une jeune garde. Vous souvenez-vous de Waterloo et de son fameux « la garde meurt, mais ne se rend pas » attribué à Cambronne ? Eh bien, il s’agissait de la même garde que celle dont il est question ici.
Une fois l’Empereur déchu, les anciens qui racontaient leurs exploits aux plus jeunes étaient appelés les vieux de la vieille (garde) . Avec le temps, ces soldats ayant été oubliés, les vieux de la vieille ont fini par désigner des vétérans ayant beaucoup d’expérience dans leur profession ou un domaine particulier.
Celui-ci [Patrick Pelata] est remplacé par Carlos Tavares, un vieux de la vieille de Renault, patron de Nissan aux États-Unis, provisoirement compatible avec Ghosn et sans doute appelé à lui succéder.
France Soir — Article du 31 mai 2011
497. Entrer dans le vif du sujet
1. Aborder le point le plus important.
2. Aller directement à l’essentiel.
Lorsque Ravaillac a planté son poignard dans la poitrine d’Henri IV, c’est plutôt le sujet qui est entré dans le vif du roi. Mais ici, il n’est pas vraiment question de ce sujet-là ni de feu son souverain. Notre sujet à nous, c’est celui d’une discussion. Quant au vif (qui vient du latin vivus signifiant « vivant » ou « animé »), c’est tout simplement, par métaphore de la « chair vive » de l’être humain, le cœur, le fond ou encore la partie essentielle du sujet.
Pour exemple, je ne citerais que l’explication que vous êtes en train de lire : je ne suis entré dans le vif du sujet qu’à compter du deuxième paragraphe. Ce qui précède est une mise en bouche, une introduction, plaisante pour certains, inutile ou stupide pour d’autres. Hélas (ou tant mieux), il est bien connu qu’on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais nous sortons du sujet. Si l’expression ne semble pas être datée avec précision, elle existe depuis le XV esiècle au moins.
Petit à petit, les pages s’ajoutent aux pages, et ces détails, ces attrayants souvenirs de famille s’épuisent. Encore quelques paragraphes, et ils seront achevés, et nous entrerons dans le vif du sujet, si ce mot n’est pas exagéré quand il s’agit d’un mort.
Paul Léautaud —
In memoriam — Mercure de France — 1956
498. En quatrième vitesse
Читать дальше