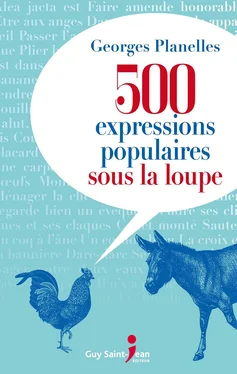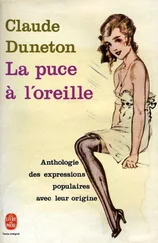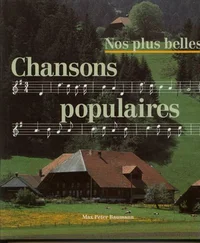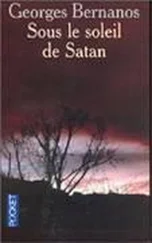Selon Gaston Esnault, ce sens de vache [57] Il y en a d’autres comme « traître, délateur » ou bien « paresseux, bon à rien », ce dernier étant justement lié au comportement placide et mou de l’animal.
apparaît en 1880. De là viennent nos deux expressions. Dans la première, il y a un renforcement par la valeur péjorative que prend parfois le mot « peau », comme dans « vieille peau ». Aujourd’hui, à la place de « la vache ! », on dirait plutôt « le salaud ». Par antiphrase, « la vache ! » peut aussi être une exclamation d’admiration.
La vérité, c’est que toujours plein de gens vous attendent. Des gars, des filles, des pourris, des peaux de vache, mais aussi quelquefois la future amitié, le truc de rêve inespéré, ou bien la fille de rêve qui va vous en sortir, à moins que ce soit le magot, qui vous tombe par hasard sans effort.
Bertrand Blier —
Les valseuses — Pocket — 2000
C’est le Môme l’Affreux qui a fait le coup, il est venu s’asseoir à ma table, ah ! la vache ! j’aurais dû me méfier.
Jean Lorrain —
La maison Philibert — Éditions du Boucher — 2007
Aller à sa perte.
Dès le XII esiècle, « aller à val ou à vau » voulait dire « en descendant le long, en suivant la pente de », le vau n’étant pas le petit de la vache, pour ceux qui ont des soucis d’orthographe, mais une vallée (on retrouve d’ailleurs ce terme dans l’expression « par monts et par vaux » indiquant un déplacement un peu partout).
Au moins jusqu’au milieu du XVI esiècle, cette locution avait le sens très concret de « suivre le fil de l’eau ». C’est à partir de cette période qu’émerge son sens figuré. On emploie d’ailleurs « à val de route » pour « en déroute » et « être à vau-l’eau » pour parler d’une entreprise qui fonctionne mal. Et entre le mauvais fonctionnement et la faillite, il n’y a qu’un pas qui a vite été franchi.
Victime d’un traumatisme crânien, il plonge dans le coma une semaine. Après cette agression, il laisse tout partir à vau-l’eau, jusqu’à la faillite. Sa conjointe le quitte, il abandonne son fils.
Yan Gauchard —
Le Monde — Article du 16 février 2011
486. Autant en emporte le vent
Se dit à propos des promesses que l’on se fait, mais qu’on n’exécute jamais.
Cette expression était déjà employée au XIII esiècle. C’est depuis le XVI esiècle qu’elle a un sens proche de celui d’aujourd’hui, inspiré par la vanité, la fugacité des choses et les promesses sans suite, par allusion aux œuvres humaines fragiles que le vent balaye en n’en laissant aucune trace, les faisant tomber dans l’oubli (« … et le vent les emporta sans qu’aucune trace n’en fût trouvée » dans l’Ancien Testament). On voit que cette expression ne date pas de Scarlett O’hara et de son Rhett Butler détesté/préféré. Elle pourrait être très utilisée par ceux qui se promettent d’arrêter de fumer, de maigrir un peu ou de se mettre à une activité sportive, et ne le font jamais. On peut aussi l’associer aux hommes politiques, habitués des promesses qu’ils ne tiennent jamais, surtout ceux qui deviennent présidents…
Pour comble, il me prit fantaisie
D’abjurer ce sexe charmant,
Qui nous inspire la folie,
Qui nous cause tant de tourment.
Tout à coup je vois Isabelle,
Qui sur moi braque sa prunelle :
Adieu, projets, adieu, serment ;
Autant en emporte le vent.
Lazare Carnot —
Opuscules poétiques — 1820
487. Avoir du vent dans les voiles
1. Se sentir décidé, après avoir bu.
2. Être ivre, ne pas marcher droit.
Le second sens proposé est le plus commun, et les liens qu’on peut trouver entre le vent qui pousse le bateau et une marche très incertaine due à l’abus d’alcool peuvent venir du fait qu’un voilier dans le vent avance penché comme peut avancer une personne ivre.
On peut aussi comparer la démarche d’une personne ivre au mouvement du bateau, qu’il ait le vent de face ou le vent en poupe. En effet, dans le premier cas, comme le voilier ne peut avancer directement face au vent, il est obligé de « tirer des bords » ou de louvoyer, comme la personne soûle. Dans le second cas, avec le vent arrière, comme ce dernier est rarement parfaitement stable en direction, le marin doit constamment adapter le cap du bateau pour éviter un empannage [58] L’empannage, c’est lorsque la grand-voile passe d’un côté à l’autre du voilier. Si l’empannage n’est pas voulu et maîtrisé, la bôme, cette barre horizontale rattachée au mât et qui maintient la grand-voile, traverse brutalement l’arrière du bateau, pouvant faucher un équipier debout et faire des dégâts au mât.
brutal qui peut être fatal à un équipier ou au mat ; cette correction constante du cap pouvant être comparée à la direction très hésitante du marcheur ivre.
Le linguiste Gaston Esnault affirme que le second sens (qui daterait de 1883) est abusif, alors que le premier, datant de 1835, serait beaucoup plus logique, la personne soudain très décidée — et plus très apte à peser les risques de ce qu’elle entreprend —, étant aussi « gonflée », au sens argotique, que peut l’être une voile un jour de bon vent.
Aussi ne retournent-ils à leurs navires que bord sur bord, ayant souvent, comme on dit, du vent dans les voiles, mais pas de ce vent qui accélère la marche d’une embarcation.
Félix Lacointa —
Revue de Toulouse et du midi de la France — Tome XXI — 1858
488. Avoir le vent en poupe
Être favorisé par les circonstances, aller droit vers le succès.
Au sens propre, les marins sont contents d’« avoir le vent en poupe ». En effet, quand on sait que la poupe est, peu ou prou *, l’arrière du bateau, alors que la proue est l’avant, on se doute que, pour avancer facilement, le marin préfère largement avoir le vent en poupe, soufflant depuis l’arrière vers l’avant du bateau, que face à lui.
Donc, quand le vent est dans ce sens souhaité, notre homme de mer peut considérer être favorisé. C’est ainsi que, par simple extension et au figuré, notre expression a été utilisée, dès le XIV esiècle, pour désigner ceux qui sont aidés par le sort, qui sont favorisés et qui, par conséquent, ont tendance à réussir ce qu’ils entreprennent.
À moins de dix jours du premier tour des régionales, la gauche a toujours le vent en poupe dans les sondages. Les sondages, dont la publication s’accélère à l’approche du premier tour des régionales, montrent tous une gauche dominante en termes d’intentions de vote.
Vosges Matin — Article du 6 mars 2010
1. S’emploie pour souhaiter bon voyage à quelqu’un qui prend le départ.
2. S’emploie pour signifier que l’on est content que quelqu’un s’en aille.
Étrangement, cette expression a deux sens quasiment opposés selon le ton qu’on lui donne. Cette locution nous vient de la marine à voiles.
C’est une formule parfaitement compréhensible lorsque les marins une fois embarqués et prêts à lever l’ancre, les proches restés à quai leur souhaitent de trouver le « bon vent » nécessaire à une navigation facile et agréable. Par extension, elle s’est logiquement transformée en une formule d’au revoir.
Читать дальше