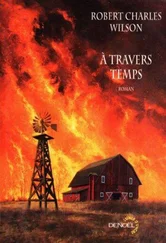— Qui ?
— Tout le monde.
— Tout le monde ?
— Les morts, précisa avec calme Tavitch. Des vies enchevêtrées comme des ficelles. Les vivants aussi… ceux-là ressemblent davantage à des mèches à feu. En train de brûler. »
Oberg avait frissonné. La pièce lui inspirait cette révulsion instinctive à chacune de ses visites. Un sentiment de contamination. Les gens pensaient les onirolithes apprivoisés, s’imaginaient que leur familiarité avait émoussé leur étrangeté. On en était loin, du moins aux yeux d’Oberg. Ils étaient les produits d’une intelligence profondément et irrémédiablement inhumaine. Comme on s’en apercevait en les regardant, en voyant leur éclat huileux, l’illusion de profondeur. Un mécanisme de pierre, songea-t-il. De la vie minérale. Cela le mettait mal à l’aise.
« Ils sont là-dedans aussi, précisa Tavitch d’une voix qui se réduisait en mode mineur.
— Qui, monsieur Tavitch ?
— Aima. Peter. Angela. » Le visage du détenu sembla s’effondrer sur lui-même. Oberg en fut stupéfait. Il pensa Tavitch, Tavitch le meurtrier qui n’avait jamais montré le moindre signe de remords, sur le point de pleurer. « Ils veulent comprendre, ajouta le condamné, mais ils ne… ils ne peuvent pas…»
Dégoûté, Oberg quitta la pièce.
Aima, Peter, Angela.
C’était la famille de Tavitch… le nom de ses victimes.
Plus tard, pendant qu’ils déjeunaient dans le décor aseptisé de la cafétéria du personnel, le responsable d’équipe avait essayé de dédramatiser l’événement. « Vous comprenez, nous travaillons ici avec des sujets choisis. Des criminels, des meurtriers comme Tavitch. Cela influence plus ou moins notre travail. La recherche conventionnelle ne nous a pas donné tout ce que nous cherchons. Nous sommes un tout petit peu plus à même qu’il y a quinze ans de comprendre ce que sont les Exotiques, comme on les appelle, ou comment et pourquoi un onirolithe interagit avec l’esprit.
— Ce n’est pas naturel, avait jugé Oberg. C’est horrible. »
Le chercheur cilla. « Je comprends votre inquiétude, monsieur Oberg. Je me contente de suggérer la modération. La patience. Essayez de comprendre notre point de vue. En l’occurrence, nous nous intéressons tous à la communication. Et nous en avons eu une, d’une sorte ou d’une autre, dans cette pièce avec Tavitch. Certains ont des préjugés envers ce qu’on appelle « l’interface humaine », c’est-à-dire l’effet des onirolithes sur l’esprit humain. Eh bien, de toute évidence, ce n’est pas un sujet d’étude facile. Il s’agit d’un effet subjectif, qu’on ne peut ni mesurer ni calibrer. Nous pratiquons donc un genre de recherches limité et, pour le financement, nous entrons en concurrence avec ceux qui téléchargent des données bien plus concrètes. Vous voyez où je veux en venir ? Je sais que vous avez réagi négativement à ce qui s’est passé aujourd’hui, mais je ne voudrais pas que cela affecte le déroulement de notre travail. »
Voilà donc à quoi cela se réduit, avait pensé Oberg : à la carrière de ce type. « Je n’ai aucun contrôle sur le financement.
— Vous avez de l’influence.
— Juste un peu.
— Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que nous effectuons un travail important, vital, avec ces nouvelles pierres. Personne ne veut le prendre en considération, monsieur Oberg, mais peut-être le véritable message que nous ont laissé les Exotiques n’est-il pas strictement linguistique. Il est peut-être préverbal, de l’ordre de l’intuition… de l’émotion… ou encore du souvenir. »
Le souvenir. Qu’avait dit Tavitch, déjà ? Quelque chose sur l’histoire. Et le responsable d’équipe avait parlé d’hypermnésie, un jaillissement involontaire du passé. Pour Oberg, tout cela semblait manifestement, indubitablement sinistre. Le passé était le passé, un cimetière, la tombe des événements, et c’était très bien ainsi. Personne ne se souciait du passé à part les prêtres et les poètes. Une fois une chose faite, on l’abandonnait derrière soi. L’hypermnésie, songea-t-il, l’« histoire » de Tavitch, projetait de la lumière sur des endroits qui se devaient de rester sombres, cachés, enfouis.
Oberg sentit passer une brève vague de ce que les psychofficiers de l’armée appelaient « dépersonnalisation » : le sentiment d’être en dehors de soi, déconnecté. Pendant un instant cristallin, il comprit que cette aversion des pierres extraterrestres pourrait être strictement personnelle, une pathologie, un dégoût de soi aussi profond que celui manifesté devant lui par Tavitch cet après-midi-là. Il regarda le visage neutre et pâle de l’homme assis en face de lui et pensa : si vous aviez vu ce que j’ai vu… si vous aviez fait ce que j’ai fait…
Mais c’était une progression logique qu’il ne pouvait se permettre, aussi se l’arracha-t-il de l’esprit. Les onirolithes étaient le mal, il n’y avait pas d’autre possibilité.
« J’essaie juste de clarifier notre position, conclut le responsable d’équipe.
— Je comprends », lui assura Oberg.
Il sortit de cette réminiscence comme d’un cauchemar.
L’avion effectuait des cercles dans le ciel qu’éclaircissait le jour naissant. La plupart des soldats de la paix s’étaient endormis. Oberg s’imagina la sentir approcher, la source du virus, le centre de l’infection. Il ne trouvait pas cette analogie injuste. Cela se cultivait comme un virus, cela s’insinuait dans le corps, ou du moins dans l’esprit, comme un virus. Et comme un virus, cela servait ses propres buts. Pas ceux des humains.
Il regarda par le hublot et vit, pâle dans la lumière matinale, la poussière de Pau Seco s’élever d’un canyon dans la jungle.
1. « On dirait l’enfer, dit Keller.
— C’est l’enfer, rectifia Ng d’un ton joyeux. Et vous n’avez encore rien vu. »
Ils étaient arrivés de Cuiabá par la grande autoroute à bord du semi-remorque coréen délabré et chargé de viande réfrigérée que conduisait Ng, pour son travail officiel, disait-il. Il fournissait les bidonvilles surpeuplés de foraos optimistes et de formigas malchanceuses. Cela payait bien, d’après lui. Il ne précisa pas la teneur de son travail officieux.
Durant le long voyage depuis Cuiabá, Teresa et Byron sommeillèrent au fond de l’énorme cabine tandis que Keller tenait compagnie à Ng. Celui-ci ne parla guère, mais Keller parvint néanmoins à confirmer son intuition : ils avaient pour chauffeur un ancien soldat, membre de ces commandos vietnamiens engagés dans l’offensive de la Zone Pacifique. Keller avait toujours eu un peu peur des Vietnamiens, ces soldats sélectionnés, repérés dès la naissance puis élevés dans de grandes crèches militaires aux alentours de Danang. Leurs organismes sécrétaient chroniquement d’importantes doses de sérotonine et de norépinéphrine ainsi que de faibles doses de monoamine oxydase. En d’autres termes, ils étaient agressifs, autoritaires et en besoin permanent d’excitation. Cela se sentait à la manière dont Ng conduisait son camion : trop vite, mais avec un sourire tendu et ravi. Et lorsque, dans un tournant, sa manche se releva un peu, Keller reconnut le pâle double X gravé sous la peau : le tatouage de Danang.
Ils atteignirent la région de Pau Seco peu après l’aube. Keller vit le panache de poussière s’élever sur l’horizon au sud. « Pau Seco ? » interrogea-t-il, et Ng confirma d’un hochement de tête. Une heure leur suffit ensuite pour atteindre la banlieue de la vieille ville, la pauvreté endémique du Brésil, mais à plus grande échelle. Des cabanes couvraient chaque versant des collines en miche de pain, toutes quasi identiques, configurations aléatoires de tôle ondulée, de papier goudronné et de carton. Keller regarda, au bord de la route, les groupes d’hommes émaciés qui assistaient sans curiosité au passage bruyant du grand semi-remorque.
Читать дальше