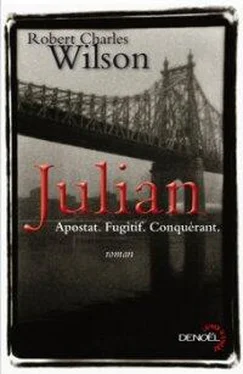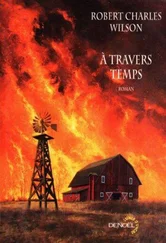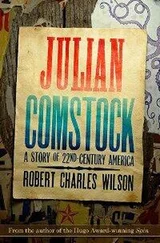Julian est sorti avec une paire de jumelles prise à l’ennemi. Sa position était plus exposée qu’une heure auparavant – les obus hollandais explosaient abominablement près –, mais il est resté immobile dans son uniforme coloré de général de division à observer les eaux ternes du lac Melville.
« De la fumée, nous a-t-il confirmé quand Sam et moi l’avons rejoint. Un vapeur en approche. Il brûle de l’anthracite, apparemment, si bien que c’est sans doute un des nôtres. » Quelques instants de silence, puis : « Un mât. Un pavillon. Le nôtre. » Il s’est tourné vers Sam avec une espèce de satisfaction féroce dans le regard. « Dis aux hommes de tenir leurs positions coûte que coûte.
— Julian…, a objecté Sam.
— Assez de ton pessimisme pour le moment, Sam, s’il te plaît !
— Mais nous ne savons pas avec certitude…
— Nous ne savons rien avec certitude… Tout combat comporte des risques. Donne l’ordre ! »
En serviteur obéissant, Sam a donc donné l’ordre.
Dix minutes plus tard, une fois le navire visible tout entier, nous avons reconnu le Basilisk, le vaisseau de l’amiral Fairfield. Nous nous attendions à voir le reste de l’armada américaine dans son sillage.
Notre espoir a été déçu.
Il n’a pas tardé à devenir manifeste qu’il y avait le Basilisk … et seulement le Basilisk.
Je ne peux décrire à quoi a ressemblé Julian quand il a pris conscience de cette désagréable vérité. Sa peau est devenue encore plus pâle. Son regard s’est fait hagard. Son uniforme bleu et jaune vifs, qu’il portait jusqu’ici avec tant d’audace, a collé comme une admonestation à son dos voûté.
L’amiral Fairfield a fait ce qu’il pouvait avec son seul bâtiment. Son navire était l’un des fleurons de la Marine et il en a usé avec ingéniosité. Il est arrivé à pleine vapeur, toutes voiles rentrées, les cheminées crachant de la fumée comme si la moitié des réserves mondiales de charbon brûlait dans ses chaudières. Il s’est glissé en oblique devant les quais hollandais de Goose Bay en lâchant quelques bordées bien placées. Il a ensuite remonté le littoral en essayant de bombarder les positions mitteleuropéennes sur lesquelles nous nous battions. Ce bombardement nous aurait prodigieusement aidés, s’il avait réussi. Les batteries côtières des Hollandais étaient malheureusement bien servies et bien retranchées. Elles ont pilonné le Basilisk à leur tour. Le navire a subi de nombreuses minutes ce tir de barrage en essayant de s’approcher suffisamment pour nous servir à quelque chose. Mais plus il réduisait la distance, plus il s’exposait. Ses mâts étaient presque complètement broyés et des flammes avaient surgi sur son gaillard d’avant quand il a fini par renoncer. Il n’a pu que s’éloigner tant bien que mal pendant que ses moteurs parvenaient encore à actionner ses hélices. Il a semblé se diriger vers Striver ou un autre endroit protégé en amont sur le lac.
Julian a regardé le navire jusqu’à ce qu’il fût sur le point de passer hors de vue. Il s’est ensuite retourné pour ordonner à Sam d’annoncer la retraite générale. Sa voix était si glacée et sinistre qu’elle semblait provenir d’un trou dans un vieux rondin. Sam, qui broyait tout autant du noir, est sorti sans un mot en secouant la tête.
Une retraite n’est pas aussi glorieuse qu’une attaque, mais on peut l’effectuer bien ou mal, et ce retrait prudent du désastre qu’était devenu Goose Bay est tout à l’honneur de Julian.
La manœuvre était néanmoins coûteuse et humiliante. Le temps d’adopter une formation correcte pour une marche forcée jusqu’à Striver, les Hollandais nous grouillaient sur le dos. Julian a affecté des troupes fraîches (pour autant que nous en disposions) à l’arrière. Leurs minutieuses opérations de feintes et de replis ont contribué à la protection du gros de l’armée.
La majeure partie de notre cavalerie n’était pas revenue de sa vaine incursion derrière les lignes mitteleuropéennes, ce qui nous rendait vulnérables aux tirs des cavaliers hollandais. Leurs détachements s’approchaient de biais en essayant d’isoler des compagnies de soldats américains pour « s’en occuper dans le détail ». Plus d’un fantassin a été perdu de cette manière. Chaque fois que des coups de feu éclataient, Julian allait toutefois à cheval tel un pavillon de guerre humain renforcer le moral de nos hommes, et nous avons participé à ces combats avec une férocité qui a semblé surprendre et déconcerter nos opposants.
Au couchant, la périphérie de Striver était en vue. Des messagers avaient prévenu la garnison que nous arriverions harcelés par les Hollandais, si bien qu’un périmètre défensif, avec des abatis, des ravelins et des lignes de tir dégagées, avait déjà été mis en place. Cela a été un soulagement pour nos survivants mal en point, quand ils s’en sont aperçus. Les chariots du Dominion sont passés devant pour aller livrer leur cargaison de blessés à l’hôpital de campagne.
Julian et Sam, et moi avec eux, avons participé aux combats d’arrière-garde tandis que le gros de nos hommes se réfugiait dans la ville captive. Ces combats se sont tout d’abord assez bien déroulés, car les Hollandais, qui s’étaient quelque peu dispersés en nous poursuivant, ne pouvaient rassembler de quoi lancer une véritable attaque. L’arrivée de leur artillerie nous a toutefois mis aussitôt en délicate situation.
Rien de tel que la chute d’obus explosifs dans une masse compacte d’hommes, tous à courte distance de la sécurité, pour susciter panique et mort. C’est ce qui s’est produit. Nos pertes n’ont pas été si élevées – les défenseurs de Striver ont réduit les canons hollandais au silence dès que ceux-ci se sont retrouvés à leur portée –, mais au cours de ce long crépuscule de froid et d’horreur, le sol moussu devant nos retranchements n’a pas tardé à se gorger d’une importante quantité de sang patriotique et à se retrouver festonné d’organes patriotiques.
Julian sur son cheval formait une cible voyante et cela m’a stupéfait qu’il ne se fît pas aussitôt abattre par un fusilier hollandais à la vue perçante. Tout comme dans la bataille de Mascouche, près de Montréal, il semblait revêtu d’une cape d’invulnérabilité qui détournait le plomb chaud.
Cette protection miraculeuse ne s’étendait pas aux personnes présentes à ses côtés. Notre drapeau de guerre est tombé quand un éclat d’obus explosif a tué le cheval d’un officier d’état-major. Sam a aussitôt mis pied à terre pour le ramasser, mais à peine l’avait-il relevé qu’il s’est écroulé, atteint par une balle hollandaise.
Je ne me souviens plus très bien des événements qui ont suivi, sinon que j’ai pris deux hommes pour m’aider à transporter Sam jusqu’à un chariot du Dominion, dans lequel il a rejoint une dizaine d’autres blessés en attente de soins. Le chauffeur de l’ambulance a fouetté ses mules quand je lui ai dit qu’il avait à bord un membre de l’état-major de Julian et je l’ai accompagné à cheval jusqu’à l’hôpital de fortune dressé dans cette large rue de Striver appelée Portage.
Sam avait été blessé au bras gauche, sous le coude, par une balle ou un éclat, je n’en savais rien. Toujours était-il que cela avait brisé les petits os au-dessus du poignet et arraché une telle quantité de chair qu’il n’en subsistait guère que loques et lambeaux. Sa main gauche, presque entièrement sectionnée, ne restait plus reliée au corps que par un ou deux tendons ensanglantés.
Il était conscient, bien que groggy et pâle, et il m’a dit de lui poser un tourniquet sur le bras pour endiguer la prodigieuse hémorragie. Je l’ai fait. J’étais content de pouvoir me rendre utile et le sang qui éclaboussait mon uniforme déjà déchiré ne me gênait pas. Il y en avait tellement qu’à notre arrivée à l’hôpital un garçon de salle m’a regardé, les yeux écarquillés, en me demandant où j’étais blessé.
Читать дальше