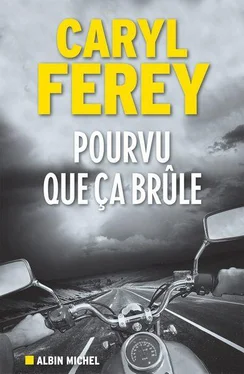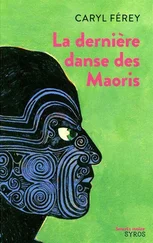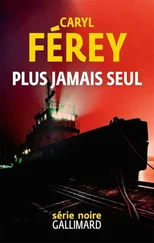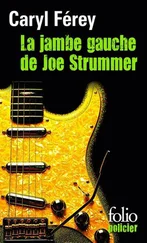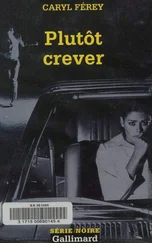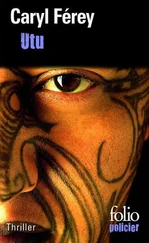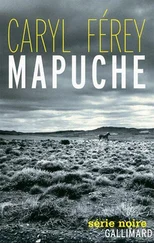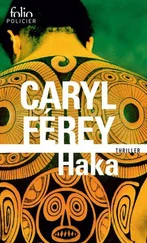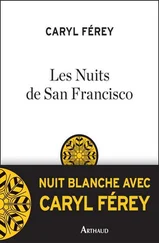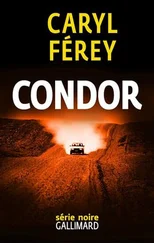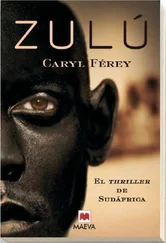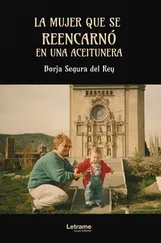« Marcheur, il n’y a pas de chemin. Le chemin se crée en marchant », disait Machado.
La piste indienne que j’avais choisie, celle du roman, demande un temps long, des dizaines d’heures de travail « debout » (en flânant dans la rue, en prenant le métro, le train, la voiture…) avant de s’asseoir pour écrire la première page ; depuis l’escapade motorisée en Espagne, je commençais à réunir des idées concrètes, des scènes, des bribes de personnages qui constitueraient mon premier livre. Plusieurs obstacles s’opposaient encore à mon nouveau projet : la logistique, le financement du voyage, le service militaire.
Logistique : mes parents avaient loué un studio à Rennes pour que je poursuive mes études après le bac, brillamment obtenu par correspondance — avec une moyenne de 10,01, je frôlais la perfection —, mais je n’avais pas fait de vieux os à la fac de psycho-socio, ce qui, aujourd’hui encore, me permet d’évoquer fièrement mon niveau d’études : bac + 2 (heures).
Mettre fin à ma première tentative de cohabitation avec moi-même ne fut pas un crève-cœur. Mon appartement semblait lui aussi s’être suicidé, avec sa porte sortie de ses gonds et posée dans l’entrée, sa table basse fracassée, sa moquette couleur vin rouge et les courants d’air qui flottaient sur cet univers de désolation. Un champ de bataille. Quant à mon ordinateur portable, le seul objet à avoir survécu au carnage, il pesait si lourd que je le consignai à Montfort-sur-Meu : un sac de voyage et de simples carnets suffiraient à mon bonheur.
Financement : ma chère maman célébrant ma fraîche vocation d’écrivain en m’offrant le billet d’avion autour du monde, je fis le machiniste à l’opéra de Rennes pour gagner un peu d’argent de poche. Après trois mois de ce régime, j’économisai en tout deux mille francs — trois cents euros —, soit, pour un séjour au long cours, une rente d’un à deux dollars par jour. Qu’importe, j’étais capable de travailler, comme tout le monde.
Armée : le mur de Berlin n’était pas encore tombé, et les garçons devaient passer leurs « trois jours » avant d’intégrer le contingent. La lame de rasoir ne figurant visiblement pas parmi les armes conventionnelles, j’en ressortis dûment exempté, condition sine qua non pour mon escapade.
J’étais enfin prêt à rejoindre Éléphant-Souriant parti trois mois plus tôt.
Mon père m’accompagna à l’aéroport d’Orly, un jour d’hiver comme les autres, jusqu’au comptoir d’enregistrement de la Pan American, pas mécontent de me voir avec un projet, fût-il celui de déguerpir.
Le billet open prévoyait huit « stops » : Los Angeles, Papeete, Auckland, Nouméa, Sydney, Djakarta, Singapour, Colombo. Libre au voyageur de rester sur place le temps qui lui plaisait. Un baptême du feu que j’abordai sans appréhension particulière. Je ne fus pas long à me mettre dans le bain.
Mon vol vers la Californie transitant par Washington, j’eus pour premier contact avec l’Amérique un douanier patibulaire, qui m’aboya dessus du haut de son mètre quatre-vingt-dix comme sur un chien plus petit.
« What the fuck are you doing here ?
— I am in transit.
— Why ?
— Heu… I go to Los Angeles.
— I asked you : what are you doing here, bastard ?
— Nothing : I am in transit.
— You lie, bloody son of a bitch ! Are you a communist ? Drug addict ? Terrorist ? »
J’avais de bonnes notes en anglais à l’école mais l’Américain n’y comprenait rien. Il me fallut un bon quart d’heure pour me débarrasser du cow-boy urbain, lequel consentit à me laisser filer après avoir précautionneusement vérifié mon billet d’avion, la main sur le flingue au cas où je lui réciterais les œuvres complètes de Lénine.
Je me dirigeai vers le comptoir de la PanAm qui assurait le vol pour Los Angeles, la sueur au front dans le hall de l’aéroport, quand, au hasard d’un tapis roulant déserté, mon œil fut attiré par un bagage qui tournait seul, visiblement depuis un bon moment : bon Dieu, mon sac !… Qu’est-ce qu’il fichait là ? Je comptais le retrouver à Los Angeles, or il était là, abandonné sur le carrousel de l’aéroport de Washington DC, les étiquettes arrachées comme les oreilles d’un vieux nounours, pour ainsi dire déprimé. Je récupérai le malheureux — encore une chance que je passais par là — et ne le lâchai plus jusqu’au comptoir bleu et blanc de la PanAm. Là, une femme fort souriante m’annonça que la compagnie n’assurait plus les vols pour Los Angeles, ni pour nulle part d’ailleurs. Décidément. J’avais failli me faire refouler des États-Unis pour une raison qui m’échappait, perdre mon unique bagage sur un tapis volant, et voilà que la PanAm avait fait banqueroute entre Paris et Washington.
« No problem, guy , s’esclaffa la fille au sourire américain, va voir au comptoir d’American Airlines, ils vont te faire un autre billet !
— Are you choure ?
— Yes we can ! »
De fait, miracle yankee, on me concocta un billet pour Los Angeles sur-le-champ. Il fallait juste crapahuter à pied jusqu’au Terminal 3, traverser des pistes avec des 747 aux fesses pour enregistrer mon foutu bagage avant la clôture et se jeter corps et âme dans un nouvel aéroplane.
Avec mon dollar par jour, je n’avais pas prévu de stop prolongé en Californie : cinq heures, c’était le temps que je m’étais donné pour découvrir l’Amérique. À L.A., une surprise m’attendait, ou plutôt ne m’attendait pas : mon bagage. Il avait de nouveau disparu, parti on ne sait où, comme si lui aussi voulait vivre sa vie… L’American Airlines me conseilla de voir ça à Papeete, ma prochaine destination. Je sortis de l’aéroport, histoire de prendre l’air, et ma première vision fut celle d’un chauffeur noir attendant son maître devant une limousine blanche à six portes avec vitres teintées. La case de l’Oncle Tom était décidément trop grande pour moi.
Je m’allongeai sous les sièges d’un Boeing aux trois quarts vide et dormis tout mon soûl avant mon arrivée à Tahiti, au beau milieu du Pacifique. Il était cinq heures du matin et le jour se levait sur l’île de Bougainville. Les flibustiers qui avaient débarqué là pour la première fois l’avaient qualifiée de paradis sur terre, on les comprend : les survivants, rongés par le scorbut, laids et puants, pour la plupart repris de justice traités à bord comme des esclaves, après avoir essuyé des tempêtes et les coups des officiers, découvraient des plages de sable blanc où les fruits tombaient des arbres et des femmes superbes à demi nues faisant l’amour sous les cocotiers comme une aimable distraction.
Les temps avaient changé : on n’y pratiquait plus l’amour libre mais des essais nucléaires au milieu des coraux. Quand on envahit, on envahit.
Mon unique bagage n’était évidemment pas au rendez-vous, et un orage dantesque me cueillit à la sortie de l’aéroport de Papeete. Les nuages roulaient les uns sur les autres, monstres anthracite aux idées noires qui, tonnant à faire trembler palmiers et cocotiers, déversèrent soudain une pluie diluvienne. Me voyant seul avec mon sac rempli d’appareils photo, une Tahitienne souriante couvrit mon Perfecto d’un collier de fleurs tandis que s’écrasaient sur le bitume des gouttes grosses comme des 103 SP.
Le jour se levait, sombre, et l’air collait à la peau. J’envoyai valdinguer les fleurs, ôtai mon cuir et, l’orage tropical passant, me dirigeai vers l’arrêt de bus, rudement désert. Ça sentait fort la pluie, la mer, les feuilles, c’était étrange de se retrouver seul à l’aube moite, attendant un bus pour Papeete. Il arriva bientôt, du reggae plein les enceintes, conduit par un métis à dreadlocks défoncé à la ganja locale qu’il fumait, hilare, au volant de son engin.
Читать дальше