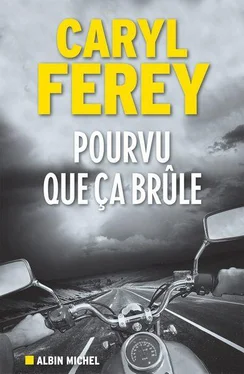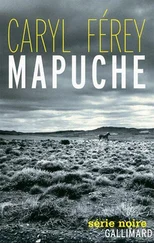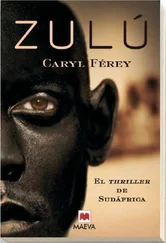Après deux années d’écriture à Paris, tous les feux se mirent au vert pour un retour à Cape Town : mon Utu néo-zélandais m’avait sorti de l’anonymat, je commençais à écrire des fictions radiophoniques, des livres pour la jeunesse, on m’appelait pour des projets de scénarios et une nouvelle bourse finançait une partie du voyage.
L’Afrique du Sud restait cependant un terrain de jeu dangereux : pour m’accompagner là-bas, il me fallait du solide, un équipier qui n’aurait pas froid aux yeux…
Qui d’autre que la Bête ?
*
Hormis nos équipées sauvages sur nos vieilles pétrolettes, je n’étais jamais parti en voyage avec la Bête.
Architecte de formation spécialisé dans la destruction de tout en général et de lui-même en particulier, sorte de Celte avec une hache luisante dans son œil unique (l’autre ayant été empalé sur une branche alors qu’il roulait soûl et à trois sur sa Moto Guzzi dans les rues de Nantes), d’un tempérament nihiliste option comique (il avait notamment fait un grand trou dans le mur qui séparait sa salle de bains et son salon afin de pouvoir regarder la télé depuis sa baignoire), à moitié drogué et sex-addict à plein temps, la Bête avait des arguments pour m’accompagner en Afrique : l’aristocrate ne travaillait pas, réservant cette activité aux manants (sa grand-mère noble avait écrit un livre sur Louis XVI, Plaidoyer pour un roi martyr ), mais ne manquait jamais d’argent, et s’il n’avait guère voyagé dans sa vie d’esthète de la débauche, la Bête n’avait à vrai dire que ça à faire.
Avatar de Mc Cash, mon héros borgne, ami depuis vingt ans, je connaissais ses travers et surtout ses qualités : hormis pour les femmes, qu’il pouvait vous voler pour peu que vous soyez un peu raplapla, la Bête était l’homme le plus droit et honnête que je connaisse, affichant un mépris souverain pour toute forme de bassesses humaines, une âme noble en somme, résumant ses défauts à de simples excès.
Ayant moi-même écrit un Petit éloge de l’excès sous forme d’essai-portrait — où je le mettais déjà en scène —, j’étais mal placé pour lui jeter la pierre. La Bête était mon jumeau négatif, ma part de destruction massive, mon côté punk remis au clou pour cause d’écriture intensive, ce que j’aurais pu devenir si ma famille avait eu assez d’argent pour que je le dépense sans travailler. La Bête n’avait pas eu la chance de trouver une passion susceptible de cannibaliser les démons de l’autodestruction propres à notre punkitude, mais nous nous comprenions d’un regard, sans avoir besoin de parler. Je l’avais ramassé plus d’une fois à la petite cuillère lors de crises de larmes d’autant plus spectaculaires qu’elles étaient rares et irrépressibles, et si sa sensibilité s’avérait parfois brutale, nous riions le plus souvent comme des tordus — au sens propre, je le crains… Enfin, quand il ne s’adonnait pas à ses drogues favorites, la Bête pratiquait le krav-maga — ou comment tuer des gens à mains nues. Un solide garde du corps, non ?
Je profitai d’un apéro au Chatham, un bar de Rennes, pour lui demander si partir en Afrique du Sud sur les traces de mon livre l’intéresserait. Sa réponse fusa aussitôt :
« Y aura de la négresse ? [4] « On se croirait parfois dans SAS ! » commente mon éditrice. À ceux qui seraient choqués par ce type de réflexions, la Bête a l’humour deuxième, voire troisième degré qui, si on le prend au premier, peut le faire passer pour un demeuré raciste, sexiste et inconséquent. Je connais trop les failles de son cynisme pour me laisser berner : on est plus près de Desproges que de Bigard.
»
La Bête est très femmes de couleur. Notamment depuis qu’il s’est rendu au Sénégal, où un de ses oncles toubabs avait une maison. Alléché par les mœurs volages de certaines femmes locales, et bien qu’à moitié aveugle, le borgne n’avait pas hésité à marcher cinq kilomètres dans la brousse en pleine nuit pour rejoindre le bar où, paraît-il, les filles n’attendaient que lui pour s’amuser en arrondissant leurs fins de mois. De fait, après avoir chassé les hyènes à coups de pied au cul, la Bête avait dépensé ce soir-là mille francs CFA, soit l’équivalent de trois cent trente-trois bières, en l’honneur des clients réunis là, si bien que les Sénégalaises l’avaient porté en triomphe jusqu’à leur couche, qu’il n’avait plus quittée.
Autant vous dire que la situation géopolitique de l’Afrique du Sud, la Bête s’en battait l’œil.
Il y avait pourtant de quoi frémir. Vingt-six mille agressions graves par an, dix-huit mille meurtres, soixante mille viols officiels (probablement dix fois plus), cinq millions d’armes à feu pour quarante-cinq millions d’habitants : les chiffres en matière de criminalité étaient effrayants. Comment la première démocratie d’Afrique pouvait-elle être également le pays le plus violent du monde ?
Près de quinze ans après la chute de l’apartheid, l’enjeu était de taille pour le pays, qui s’apprêtait à organiser l’événement le plus médiatique de la planète, la Coupe du monde de foot. Quatre milliards de téléspectateurs, un million de supporters à sécuriser, reportages, rencontres, interviews, le monde entier aurait bientôt les yeux braqués sur le pays, qui ne pouvait pas donner une image si effroyable. Qui aurait envie d’investir dans un pays considéré comme le plus dangereux du monde ?
La nouvelle Afrique du Sud devait réussir là où l’apartheid avait échoué, montrer que la violence n’était pas africaine mais subséquente à la misère et au déclassement racial.
Il reste que, contrairement à ce qu’avait annoncé le président Mbeki, le successeur de Mandela, le crime n’était pas « sous contrôle ». Le pays avait affaire à une déferlante de gangs, petits ou grands, dont les méthodes sophistiquées étaient comparables à celles des USA des années 1930 : corruption de la police, inefficacité de la justice, passivité du gouvernement. À travers ses campagnes anti-crimes, le secteur privé ne s’en prenait pas à la démocratie mais aux hommes qui géraient la poudrière, l’ANC en tête. Mandela n’était plus là : à l’approche de la Coupe du monde, les Blancs pouvaient contre-attaquer.
Nous partîmes, la Bête et moi, en février 2007. Huit ans étaient passés depuis mon premier voyage à Cape Town, Chevalier-Élégant et Planeur-Nerveux étaient revenus vivre en France mais depuis ce séjour inaugural, je savais que l’Afrique du Sud serait un gros morceau de vie à avaler. Apartheid, homicides, vols, viols, sida, il y avait là-bas tous les ingrédients pour écrire un polar émouvant et ultra-violent.
Je ne me trompais pas.
Nous ne fûmes pas longs à nous mettre dans le bain : en transit à Johannesburg, changeant de terminal pour rejoindre Cape Town, nous apprîmes par une série d’affiches qu’entrer dans l’enceinte de l’aéroport était « à nos risques et périls ». Une mesure juridique anglo-saxonne censée empêcher les gens de se retourner contre l’aéroport en cas de grabuge, mais à prendre au sérieux — un touriste italien, fier de braver l’avertissement, était revenu en slip.
Nous arrivâmes sains et saufs à Cape Town, sous un soleil de plomb, cueillis par un vent salvateur qui faisait battre les lanières du bandeau de la Bête — un bandeau de cuir noir, qui depuis vingt ans zèbre son visage de play-boy borgne. Connaissant sa propension à déborder du cadre, j’avais loué une voiture à l’aéroport de Cape Town pour filer directement en Namibie, où je savais l’accès aux bars et boîtes de nuit limité. C’était aussi là que se terminerait mon livre. Mais la route serait longue.
Читать дальше