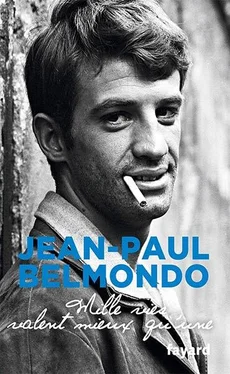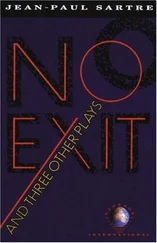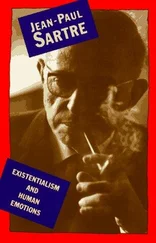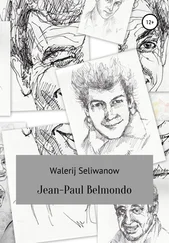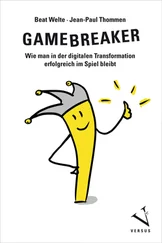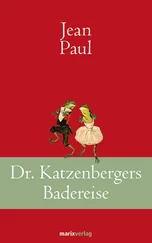Mon personnage est, avant sa chute, le patron de l’équipe de foot locale, ce qui nous a valu de tourner dans un stade et de naviguer un peu dans l’une de mes passions. Largement partagée avec mon pote Charles Gérard, entretenue par les Polymusclés, une équipe de foot amateur qui se produisait avec professionnalisme partout où on l’invitait, comme à Monaco, chaque année, pour le bal de la Croix-Rouge.
Après Peur sur la ville , le constat était qu’on m’aimait autant en flic qu’en voyou. Georges Lautner le résumait quatre ans plus tard dans Flic ou voyou . C’est Michel Audiard, avec qui j’aurai en tout collaboré sur quinze films, qui tenait à faire les présentations. Il s’étonnait que nous n’ayons jamais travaillé ensemble, alors que nous avions respectivement une inclination reconnue pour la comédie et le genre policier. Lautner avait sous le coude un roman de Michel Grisolia, L’Inspecteur de la mer , qui procédait du même mécanisme que l’intrigue de Razzia sur la chnouf , d’Henri Decoin, avec Gabin : un gentil qui infiltre les méchants en se faisant passer pour l’un d’entre eux.
Cette fois, à l’inverse du Casse , j’étais faussement un truand pour mieux être un bon flic. Mon personnage choisissait de passer la frontière du monde des flics à celui des voyous, mais sans hésiter sur sa nature, sans ambiguïté. En plus de mon personnage qui m’allait bien, et de l’agréable facilité avec laquelle Lautner faisait ses films, j’avais le bonheur de tourner dans le Sud, aux Studios de la Victorine, avec plein de vieux camarades : Marie Laforêt, Michel Galabru, Michel Beaune, Charles Gérard, Georges Geret, Jean-François Balmer.
Vu le succès qu’il remportait à sa sortie, Flic ou voyou , nous a disposés, Audiard, Lautner et moi, à prolonger notre trio et à faire dans la foulée, avec la même bande, Le Guignolo . Nous nous sommes un peu hâtés, je crois, et avons commis quelques erreurs.
Notamment de nous être contentés d’un scénario très imparfait et d’avoir osé une affiche de mauvais goût : un homme, en l’occurrence moi, qui se balance sous un hélicoptère en caleçon à pois rouges.
En fait, nous avions surtout favorisé la rigolade et pris le film comme prétexte à une déconnade géante pendant trois mois à Venise. Nous nous permettions toutes les fantaisies, ce qui nous égarait dans un grand n’importe quoi. Le Guignolo a malgré tout eu du succès : il a amusé trois millions de spectateurs. C’était ma première fois en tant que distributeur, et j’étais satisfait.
Le public, lui, se moquait bien de mes rôles divers derrière l’écran. Il m’avait adopté en tant que voyou puis flic et me croyait désormais doté de pouvoirs surnaturels. Comme je réalisais l’impossible à l’image dans des cascades aberrantes, que j’obtenais toujours gain de cause à la fin du film dans ma quête, ou mourais, on a fini par me percevoir comme un héros, voire un demi-dieu. Dans la réalité aussi, sans plus faire la distinction entre mes personnages et moi. Alors qu’avec Laura Antonelli, nous profitions du luxe d’un voyage de trois heures à New York en Concorde, j’ai eu l’occasion d’expérimenter cette confusion.
Nous sommes tranquillement et confortablement assis quand l’avion se met à brinquebaler. Les passagers sont surpris, certains ont peur. Le pilote prend la parole pour expliquer que l’un des quatre moteurs de l’engin supersonique a cassé. Il nous encourage au calme, certifiant que trois suffisent amplement pour assurer le vol, lequel sera seulement un peu plus long puisque nous venons de passer en subsonique.
Malgré cette annonce rassurante, mon voisin de droite ne semble pas se détendre du tout. Il enchaîne les verres d’alcool, frénétiquement. Trente minutes après le premier incident technique, un second se produit. Cette fois, nous décrochons violemment et une odeur de brûlé envahit la cabine. Le pilote se manifeste à nouveau, d’une voix moins sereine que tout à l’heure, afin de nous informer qu’un deuxième moteur a cramé, qui nous obligera peut-être à nous poser quelque part avant New York. Cette fois, mon voisin est au bord de vomir, blême, les yeux écarquillés. Soudain, il se tourne vers moi, m’agrippe le bras et me hurle : « Monsieur Belmondo, faites quelque chose ! »
Je n’ai rien pu faire et nous sommes quand même arrivés sains et saufs à New York. Mais sept heures plus tard !
Lautner m’a encore sollicité pour son film Joyeuses Pâques , nostalgique de Flic ou voyou , puisque tourné aussi à Nice, avec Marie Laforêt dans le rôle de ma femme. Mais dans un genre bien différent, vaudevillesque. Nous formons avec cette dernière et ma jeune maîtresse, interprétée par Sophie Marceau, que je fais passer pour ma fille, un triangle amoureux qui sert de point de départ à une série de péripéties impliquant des cascades. En hors-bord, avec lequel je passe sur une île à travers une cabane à bateaux, et aussi en voiture, avec laquelle je vole à travers une large vitre.
Le ton du film, enlevé et frais, les séquences spectaculaires, la vivacité de jeu de mes deux partenaires féminines, enchantent le public. Un avis infirmé par les critiques, impatients d’annoncer ma chute, contents de conclure à une « spirale de l’échec » en s’appuyant sur le nombre modeste d’entrées pour Les Morfalous , réalisés par Henri Verneuil.
19.
N’écrivez pas le mot « fin »
Impossible. Inenvisageable. Perdu d’avance. Planté. Je ne pourrai pas. C’est trop dur. Tenir trois heures et quart, se souvenir de tout. Ceux qui me déconseillaient de m’y attaquer avaient raison. Je ne suis pas de taille, ce rôle est trop grand pour moi, je vais flotter dedans et me ridiculiser. Je ne sais plus faire, moi ; ça fait vingt-six ans que je ne l’ai pas fait, depuis que j’ai déserté brutalement la pièce de Sagan, Un château en Suède , pour le film de Peter Brook, Moderato cantabile .
Autant se lancer dans une cascade sans l’avoir préalablement réglée. Pire qu’imprudent, suicidaire. Il vaut mieux que je me tire, avant que mes partenaires arrivent et m’empêchent de fuir. Il n’est que dix-huit heures ; le théâtre est calme et silencieux, seuls quelques machinistes sont à l’ouvrage. J’attrape mon manteau, sors de ma loge et file hors de Marigny pour sauter dans ma Ferrari. Je m’extrais de Paris pour pouvoir rouler, reprendre mes esprits dans la vitesse, dissiper mon angoisse sur une route droite et rapide. Je viens de paniquer. L’angoisse a gagné.
Nous sommes le 24 février 1987. Je suis censé entrer en scène dans une heure et demie : ce soir, je fais mon retour au théâtre après une bien longue interruption. C’est Kean qui a été élu pour ces retrouvailles, le rôle que mon cher Pierre Brasseur tenait au théâtre Sarah-Bernhardt en 1953 dans la pièce d’Alexandre Dumas, du même nom, datant de 1853 mais rajeunie par Jean-Paul Sartre.
Le personnage, inspiré de l’histoire d’un homme qui a joué toute sa vie dans les pièces écrites et mises en scène par Shakespeare, et qui a même poussé le vice jusqu’à mourir sur scène dans la peau d’Othello, se prête à toutes les extravagances d’un comédien dont il est la quintessence. Il passe par tous les états, prend tous les masques et glisse d’un répertoire à un autre sans transition — un pur bonheur, un fantasme originel d’acteur. Mais Kean requiert d’être en forme pour endurer la performance physique, et d’avoir la mémoire bien entraînée.
Alors, même si j’ai recommencé à faire du sport quotidiennement et si je me suis isolé avec Maman au Maroc pendant un mois pour me mettre mon texte en tête, je doute. Je risque d’être décevant ; je ne suis pas à l’abri d’un trou, d’une erreur, d’une fatigue.
Читать дальше