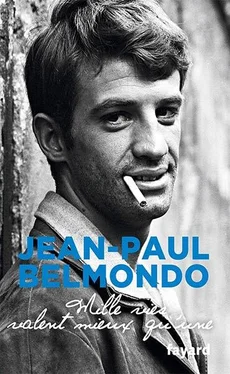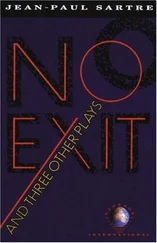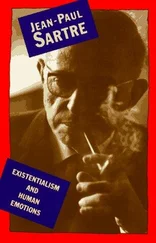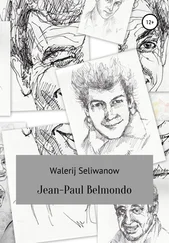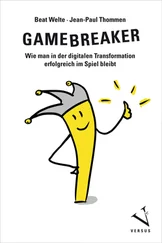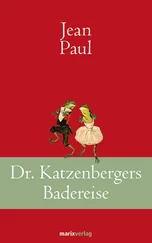Me plonger dans des habits complexes et inédits ne m’interdisait pas de faire l’idiot par ailleurs. Au cinéma et dans la vie. C’est avec Chabrol aux manettes que j’ai produit mon premier film, Docteur Popaul , une farce cynique et improbable, tirée d’un bouquin d’Hubert Monteilhet, Meurtres à loisir , que m’avait fait connaître Lebovici. Je lançais ma société de production, Cerito, avec mon frère que j’avais débauché des pétroles sahariens pour le mettre à la direction. Il était parfaitement compétent pour ce rôle, le seul hic étant son impossibilité de monter dans un avion, après avoir réchappé à deux accidents en l’air. Pour nous rejoindre à temps sur les tournages, il devait parfois partir trois semaines plus tôt, en voiture ou par bateau.
Pour démarrer Cerito, il me fallait une bonne comédie. Celle-ci me semblait adéquate, surtout avec des actrices telles que Mia Farrow et Laura Antonelli, que je retrouvais avec une joie intense après avoir été touché pendant le tournage des Mariés de l’an II . C’est précisément le tournage de Doctor Popaul qui nous a intimement rapprochés, et qui a poussé des journalistes peu scrupuleux à révéler notre amour naissant dans leurs colonnes, alors que Laura était mariée, et moi encore officiellement en couple avec Ursula.
Encore une fois, leurs méthodes de chacals me dégoûtaient et m’ont incité à porter plainte. En attendant, nous coulions des jours heureux de tournage, travaillant le jour, buvant et riant la nuit. Mia Farrow, qu’il avait fallu enlaidir pour son rôle, en lui ajoutant des lunettes et de fausses dents, paraissait très souvent confondre les deux, ou ne vivre que la nuit.
Dans mon nouveau rôle de producteur, j’avoue m’être rongé les sangs. C’était une première pour moi, je n’étais pas sûr du coup. Je craignais d’amorcer ma carrière dans ce fauteuil par un échec cuisant.
Les critiques ont réagi, comme prévu, très négativement, mais n’ont pas influé sur le public, qui s’est déplacé. J’étais sauvé.
Entre deux occupations ou rôles sérieux, il fallait bien que je rattrape ma légèreté. Alors, après L’Héritier , j’ai foncé dans un projet proposé par mes deux acolytes de toujours, Mnouchkine et Broca. Ils avaient récupéré un scénario écrit par Francis Veber (qui a finalement exigé d’être ôté de l’affiche) dont le héros leur semblait taillé sur mesure pour moi.
Il s’agissait d’un écrivain charmant et looser, un peu couillon, François Merlin, qui se transforme en super-héros, double outré de James Bond, dans les fictions qu’il est contraint d’imaginer à la chaîne pour survivre dans des conditions précaires. Remanié par Philippe de Broca et Jean-Paul Rappeneau, ce personnage est devenu Le Magnifique . Et j’ai décidé de le coproduire avec Ariane Films, la boîte de Mnouchkine, et validé l’idée de Philippe d’engager Jacqueline Bisset pour me donner la réplique. Nous avons mis dans le film tous les moyens nécessaires à l’éclat recherché pour la partie Bob Saint-Clar, nous déplaçant dans tout le Mexique, dans des conditions luxueuses. Même si, pour ma part, à l’issue d’un regrettable malentendu, j’ai dû en profiter avec une cheville plâtrée et une élongation du tendon. Je devais me jeter d’une voiture conduite par Jacqueline dans un tas de cartons. Le calcul de la vitesse nécessaire à une chute réussie, amortie par le nombre de cartons adéquat, avait été fait en kilomètres alors que nous utilisions une voiture américaine.
Quand Broca a conseillé à Jacqueline de rouler « à 50/60 », elle a cru qu’il parlait en miles et a lancé la voiture à 110 kilomètres à l’heure. Ce qui était beaucoup trop rapide et rendait le matelas de cartons inefficace à me réceptionner en douceur. Je me suis salement croûté.
Ce petit accident de travail, survenu à cause d’un quiproquo, n’a pas entravé ma propension pathologique à faire des blagues, avec la complicité de Philippe de Broca. Ainsi, nous avons trouvé une vieille ivrogne mexicaine dans la rue et l’avons ramenée dans la chambre de Charly, mon ami maquilleur. Puis nous avons imaginé un prétexte pour l’attirer dans sa chambre, puis l’y enfermer avec sa nouvelle copine. Malheureusement pour la propriétaire du lieu où nous logions, une dame fort charmante, l’anniversaire de mes quarante ans tombait précisément pendant notre séjour chez elle.
Le soir du 9 avril, nous avons passé toutes les limites dans l’hôtel. Cette fois, nous n’avons pas vidé la piscine, mais l’avons remplie. Avec tout ce qui nous tombait sous la main. D’abord les verres, puis les assiettes, puis les chaises, puis les tables, puis les gens — même ce pauvre Charly, qui ne savait pas nager… Un massacre en règle de l’équipement, un Fort Apache du mobilier. Le lendemain matin, encore totalement imbibé des boissons alcoolisées de la veille, j’ai utilisé les deux neurones encore valides dans mon cerveau pour aller présenter mes excuses à la patronne et lui demander la facture de la casse dont je comptais bien m’acquitter. Mais, alors que je l’interrogeais sur le montant qu’il me fallait régler, elle m’a répondu par une question :
« Est-ce que vous vous êtes bien amusé, monsieur Belmondo ?
— Oh oui, comme un fou !
— Alors vous ne me devez rien ! »
Plus de quarante ans après, que cette femme soit remerciée pour la noblesse de son geste.
Quelques années plus tard, un autre miséricordieux au grand cœur m’a gratifié comme elle d’un coûteux pardon. Encore plus coûteux. Car il s’agissait alors de deux lustres en verre de Murano que j’ai brisés en tout petits morceaux ! Je me trouvais alors à l’Élysée-Matignon, un club où je faisais souvent la fête dans les années 1980.
J’ai eu envie de faire l’imbécile pour amuser les potes ; alors, comme dans les films de cape et d’épée, j’ai attrapé un premier lustre, auquel je me suis suspendu et balancé jusqu’à ce que je le sente céder et me récupère sur le deuxième, lequel a lâché à son tour. En chutant, ils n’ont fort heureusement blessé personne, mais ont explosé en mille morceaux.
Quand j’ai tenté de réparer les dégâts que j’avais causés en sortant mon chéquier, Armel Issartel, le maître de la boîte, m’a expliqué que je ne lui devais rien puisque je m’étais bien marré. C’était son but, que je passe chez lui de bonnes soirées, et son plaisir.
La générosité ne s’oublie pas, parce qu’elle est inattendue. Serge Gainsbourg, que j’avais rencontré pendant les années bénies de Saint-Germain-des-Prés, était de ces hommes du beau geste, capables de faire des folies pour les autres, mais raisonnables pour eux. Comme il habitait rue de Verneuil, à deux pas de chez moi, nous étions souvent fourrés ensemble. Nous avions l’habitude de déjeuner en tête-à-tête dans un restaurant qui a disparu depuis, le Vert-Galant. Mais c’est chez Cartier qu’il m’a bouleversé. J’y cherchais un cadeau pour ma mère. Nous regardions les bijoux tout en discutant jusqu’à ce que j’en choisisse un. Alors Serge s’est éclipsé. Au moment où j’ai voulu régler, j’ai appris que c’était déjà fait.
Comme il s’agissait d’une somme importante et que nous avions bu quelques godets avant de faire des emplettes chez le bijoutier de la place Vendôme, j’ai craint que mon ami ne se soit un peu emballé. Je l’ai appelé le lendemain matin pour m’assurer que je n’avais pas profité malgré moi de son ébriété.
Il s’est fâché que j’aie pu l’imaginer. Il était le matin comme la veille, il ne variait pas en fonction de l’heure ou du jour, il était le même artiste génial et le même type adorable.
Читать дальше