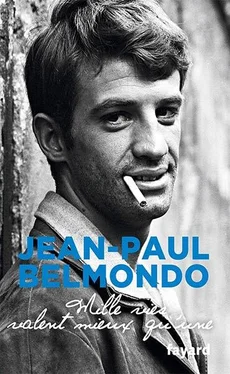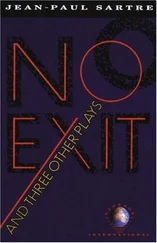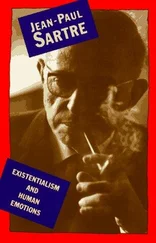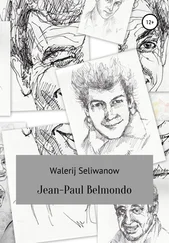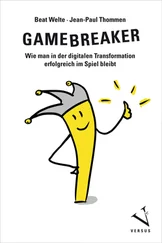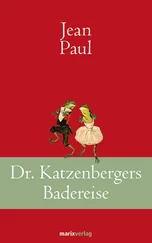Semprun, passionné et érudit, avait osé — avec notre consentement insérer — un autre récit portant sur Trotski, et avait truffé le texte de mises en perspective historique. Peu à peu, le film avait pris de l’ampleur et Stavisky, sublimé par sa légende et les conséquences de son existence, s’était épaissi.
J’avais, en tant que producteur, mon mot à dire sur le recrutement des acteurs. Mais je préférais que Resnais ne sache pas que je produisais, pour qu’il se sente libre sur le tournage. Or, comme nous étions d’accord, je n’avais rien besoin d’avouer. Il tenait à Charles Boyer, avec lequel je me réjouissais de travailler. Je voulais mes potes Beaune et Vernier, Rich, Périer et Duperey ; il les avait repérés depuis longtemps. Et je retrouvais mon ancien professeur du Conservatoire, René Girard. Tout était au poil. L’équipe était parfaite.
On pourrait supposer qu’un tel rôle, pour lequel il fallait me retirer mon hâle et me priver de soleil, avec un tel cinéaste, m’aurait assagi. Mais non. Au contraire, il me fallait compenser le sérieux de Stavisky avec un peu de légèreté en dehors du plateau.
À Biarritz, où mon frère m’avait rejoint, j’ai veillé à laisser des souvenirs dans l’hôtel qui nous logeait, comme la tradition l’exigeait. Un soir, alors que nous rentrions dans un état d’ivresse bénie qui nous donnait des ailes, nous avons fomenté une blague.
Nous avons — je ne sais encore comment, vu la lourdeur de la chose et la maladresse de l’ivrogne — transporté une énorme armoire pourvue d’un miroir devant la chambre de François Périer, qui dormait là avec sa femme. Nous l’avons quasiment collée à la porte, puis avons grimpé dessus pour frapper sans être vus. Notre copain, au bout de quelques secondes, est venu ouvrir, mais n’a vu que lui-même — son reflet dans la glace. Il est retourné se coucher et, quand sa femme l’a interrogé sur cette mystérieuse visite nocturne, il a répondu : « Ne t’inquiète pas, ce n’était que moi. »
Nous pouvions emmener Stavisky à Cannes sans honte au printemps 1974. J’étais même assez fier de revenir monter les marches avec ce film très longtemps après Moderato cantabile . Je n’appréciais toujours pas le cirque inhérent à ce festival, le ballet des photographes et la ronde des badauds. En fait, je ne m’habituais pas aux paparazzis et aux questions pernicieuses des journalistes.
En outre, je faisais alors ma première sortie publique au bras de ma nouvelle fiancée. Séparé en bons termes d’Ursula Andress, que j’avais aimée pendant sept ans, je l’avais rencontrée en participant au tournage épique des Mariés de l’an II . Elle aussi était splendide, et d’être son amoureux excitait la jalousie.
Laura Antonelli était la beauté et la douceur mêmes : un regard ou un sourire, et la guerre reculait, le ciel s’ouvrait, le soleil apparaissait.
Je crois que c’est aussi cela que l’on m’a fait payer à Cannes. D’être l’amoureux de Laura Antonelli. En plus d’avoir prétendu produire et jouer dans un film intello de Resnais. J’osais encore une fois cumuler le cinéma populaire et l’élitiste, me trouver à l’aise partout, sans restriction. J’exagérais.
On me voyait chez Godard, Truffaut, Malle, Melville, Resnais, aussi bien que chez Broca, Verneuil, Oury, bientôt Lautner. J’agaçais. Je voulais le beurre et l’argent du beurre, les entrées par millions et les critiques des Cahiers du cinéma . Alors, non, il n’était pas question de reconnaître sur le moment que Stavisky était un bon film. Après, bien sûr, ça a changé.
Ce soir-là, nous avons monté les marches, Laura et moi, sous les flashs des photographes et les hourras de la foule, mais nous les avons descendues sous les sifflets qui avaient commencé pendant la projection. Comme si l’on m’avait tenu responsable de ce que l’on considérait comme un échec, on m’a largement craché au visage.
Après cette séquence désagréable, devenue un mauvais souvenir, je suis allé dîner avec l’équipe du film. Et personne n’est venu nous voir. Nous étions des pestiférés. J’en étais désolé. Je regrettais d’être venu présenter Stavisky à Cannes. Et la bêtise, aussi.
Par la suite, j’ai estimé qu’il n’était pas nécessaire d’organiser des projections en avant-première réservées aux journalistes. Dorénavant, leur avis m’importerait peu et, s’ils souhaitaient en émettre un, ils n’avaient qu’à attendre comme tout le monde le jour de la sortie, dans la queue du cinéma.
Apparemment, ils ont assez mal encaissé l’indifférence que je leur ai en effet manifestée à partir de ce regrettable épisode Stavisky . Et ils ont continué de me faire grief de mon succès.
Lorsque des années plus tard, en octobre 1982, est sorti le film que j’avais produit, dans lequel je tenais le rôle principal et que Gérard Oury avait réalisé, L’As des as , il a cartonné au box-office dès la première semaine. Ce qui a semblé dégoûtant à ces cinéphiles plumitifs frustrés qui lui ont fait un ridicule procès, voire une cabale, allant jusqu’à signer un manifeste. Ils se figuraient que nous avions détourné d’hypothétiques spectateurs d’un autre long métrage, celui-ci de Jacques Demy, dont ils faisaient des gorges chaudes, Une chambre en ville .
Le bide retentissant de l’un était la faute du triomphe de l’autre. Un raisonnement dont je peinais à discerner le bon sens, mais dont je distinguais clairement les défauts. Comme les types qui avaient lancé cette thèse pour le moins crétine avaient fait des émules un peu partout dans la presse spécialisée, j’ai fini par lui trouver un goût saumâtre.
J’ai levé mon stylo encore une fois, à défaut du poing, pour répondre à cette cohorte d’ahuris, et anéantir une logique purement rhétorique dont ils usaient pour me nuire :
« En parcourant le manifeste dénonçant comme suspect mon film L’As des as , coupable d’avoir volé les “spectateurs potentiels” d’ Une chambre en ville , en examinant la liste de ses signataires, je me pris soudain à baisser la tête… Un mot de Jean Cocteau me revenait à l’esprit : “En France, l’égalité consiste à trancher les têtes qui dépassent.” Ainsi, L’As des as , que j’ai coproduit et interprété en y laissant intégralement mon cachet, parce que j’avais le désir de stigmatiser sur le ton léger de la comédie l’antisémitisme et l’intolérance, n’est pas toléré par ceux qui font profession de tolérance, et Gérard Oury doit rougir de honte d’avoir “préconçu son film pour le succès” ! Jacques Demy a-t-il préconçu le sien pour l’échec ?
Lorsque, en 1974, j’ai produit et “sorti” Stavisky d’Alain Resnais et que le film n’a fait que 375 000 entrées, je n’ai pas pleurniché en accusant James Bond de m’avoir volé mes spectateurs. Ce remue-ménage est grotesque. Aussi ridicule que la conclusion d’un critique, signataire de ce manifeste, qui termine son article en affirmant avoir entendu un enfant expliquer, en sortant de L’As des as , qu’il s’était trompé de salle et qu’il croyait être allé voir Alien . Plus de trois millions de spectateurs français en trois semaines — sans compter les pays étrangers où le film reçoit un accueil triomphal — se seraient donc, eux aussi, trompés de salle, et sont ressortis ahuris, ayant applaudi L’As des as croyant qu’il s’agissait d’un autre film et me prenant pour un autre acteur ! Peut-être serait-il plus honnête d’imaginer avec un autre critique les raisons de l’attrait qu’exerce L’As des as . En ce temps de crise, le public a entrepris une formidable transhumance vers les pâturages du divertissement et de l’évasion. Son ampleur actuelle en fait un phénomène de société ! »
Читать дальше