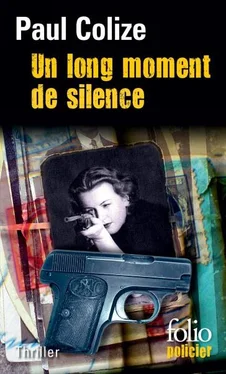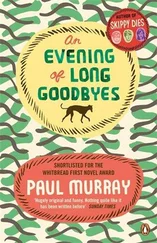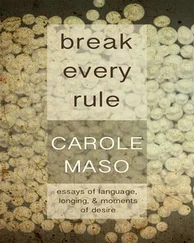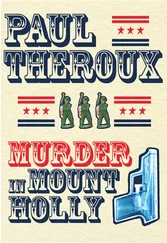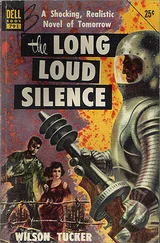Je n’ai pas de scrupule à lui faire bouger son cul, mais sa motivation n’est pas la même que la mienne, il aurait bâclé le boulot et serait passé à côté de ce que je cherche.
J’ai commencé par l’étage, cinq chambres, deux salles de bains, un bureau, un débarras, le tout bourré à craquer, du plancher au plafond.
Je ne savais pas que mon oncle était un amasseur compulsif. Tous les ustensiles, les objets et les papiers qui sont passés dans ses mains durant sa vie se trouvent dans cette maison.
Les garde-robes sont remplies de costumes bouffés aux mites, de chemises trouées, élimées, roussies aux aisselles, de cravates à gerber, de chaussures usées jusqu’à la corde. Dans d’autres armoires, il a entassé les affaires de Barbara : des manteaux qui sentent la naphtaline, des robes d’un autre siècle, des chemisiers délavés, des pulls, des jupes, des foulards, des godasses.
Les tiroirs sont pleins à ras bord d’un tas d’objets pourris, cassés, inutiles : des ressorts, des boules Quies, des mouchoirs en papier, des cartes de visite, des pinceaux, des crayons, des blocs de Post-it, des boutons de manchette.
Dans le débarras, j’ai trouvé une partie de sa collection personnelle : de grands bocaux remplis d’élastiques, de piles usagées, de trombones, de boutons, d’épingles, de pochettes d’allumettes, que sais-je encore.
Pour couronner le tout, il fumait. Les tentures, les tapis et les draps sont imprégnés d’une infâme odeur de nicotine. La maison entière pue le cendrier.
Roland s’assied sur le lit, déballe les victuailles.
— Alors, tu as trouvé quelque chose ?
— Pas ce que je cherche.
Je pensais approcher du but en explorant les rangements du bureau sur lequel traînaient trois ordinateurs des décennies écoulées, un IBM 386 préhistorique, un iMac avec écran translucide et un Sony portable.
Une grande boîte à biscuits métallique était coincée au bout d’une étagère chargée d’albums photos. J’ai rapidement parcouru les albums pour m’assurer de ne rien louper, mais ils ne contenaient que les clichés habituels : naissances, fêtes, vacances, mariages. En une quinzaine de minutes, j’ai parcouru un demi-siècle en Bavière.
Ma mère figurait sur certaines photos, du temps où Barbara était encore en vie. Je m’y trouvais également, en bonne place. Fred, mon oncle, a immortalisé le moment où j’ai flanqué une raclée au judo à Roland, dans leur jardin, en juillet 1962.
La boîte métallique contenait, elle aussi, des photos. Les clichés étaient plus anciens, de grand format, en noir et blanc ou en sépia sur un épais papier.
Je les voyais pour la première fois. Les photos avaient été prises en Pologne, avant la guerre. La plus grande représentait leur prestigieuse résidence d’été, à Radziechow.
Mes grands-parents et leurs trois filles posaient devant une calèche attelée de quatre chevaux, menée par un cocher en redingote, casquette et fouet. Toute l’aristocratie polonaise en une image.
Les filles se tenaient à l’avant-plan, par ordre de grandeur, comme les poupées russes. Mes grands-parents, en élégante tenue de promenade, se tenaient fièrement derrière elles. Les trois gamines avaient un indéniable air de famille. Ma mère devait avoir quatre ou cinq ans, elle était déjà la plus jolie.
Deux autres photos avaient été prises dans la pharmacie de mon grand-père, à Lwów. Le numéro et le nom de la rue où elle se trouvait étaient écrits sur le cliché, 81 Grodeckastrasse .
Mon grand-père officiait derrière le comptoir, l’air professionnel, en blouse blanche immaculée.
Une autre série immortalisait les trois filles en tenue de soirée dans une salle spacieuse entourée de colonnes. Les femmes étaient en long, les hommes en costume strict. Ma mère était resplendissante dans une robe blanche, elle devait avoir seize ans.
Quelques-unes avaient été prises lors d’une chasse. Mon grand-père était sur son cheval, sérieux, impérial, l’allure d’un seigneur, une meute de clebs à ses bottes.
La dernière photo était étrange.
On y voyait mon grand-père, assis sur une chaise à haut dossier, probablement dans une église.
Elle avait été prise à l’improviste, il affichait un sourire ironique que je ne lui connaissais pas.
— Tu as remis ton rendez-vous de ce soir ?
— Ce n’était pas très important.
— Tu veux dormir ici ?
— Non, je vais continuer, je partirai plus tard dans la soirée.
— Tu ne veux pas que je t’aide ? Je sais à quoi ressemblait cette boîte.
— Moi aussi.
Il me dévisage, médusé.
— Tu la connaissais, la boîte ? Tu savais que ta mère l’avait donnée à Marischa ?
— Non, je ne le savais pas.
Ma mère est morte le 19 octobre 1993. Un sale cancer du pancréas l’a tuée à petit feu. Son calvaire a duré plus d’un an. Un an durant lequel elle n’a jamais émis la moindre plainte. Elle est restée digne, exemplaire, jusqu’à la fin.
Une semaine avant sa mort, elle m’a demandé de prévenir Marischa et mon frère. Elle savait qu’elle n’en avait plus pour longtemps.
Ce jour-là, elle m’a parlé de mon père.
C’était la première fois qu’elle m’en parlait depuis des années. Elle se trouvait à l’hôpital Saint-Jean, rue du Marais, elle rentrait d’une ponction. Les toubibs l’avaient gavée de morphine. Nous étions seuls dans la chambre. Elle m’a souri, tant bien que mal.
Ensuite, elle a fermé les yeux.
— Bientôt, je serai à nouveau auprès de ton père.
Je ne savais que répondre.
Elle a rouvert les yeux, m’a regardé, les a refermés. Son visage est devenu dur.
— Je regrette tellement.
J’étais tétanisé, je ne trouvais rien à répondre, je me sentais comme le dernier des cons.
Que voulait-elle me dire ?
J’ai passé et repassé cette phrase mille fois dans ma tête par la suite.
Que regrettait-elle tellement ?
De nous quitter ? De nous laisser seuls ? De ne pas s’être fait opérer plus tôt ?
Regrettait-elle que mon père soit parti ? Que nous ne l’ayons pas connu ? Qu’elle n’ait pu lui dire adieu ? Qu’elle n’ait pas fait quelque chose qu’elle aurait dû faire ou l’inverse ? Aurait-elle pu empêcher ce qui est arrivé ?
J’ai envisagé mille hypothèses, toutes sont restées sans réponse. Ces mots cachaient une douleur sourde, du chagrin, de l’amertume, du dépit, un constat d’échec.
Quelques jours plus tard, elle est partie. Le docteur qui la soignait nous a téléphoné pour nous dire que c’était la fin, qu’il serait bon que quelqu’un reste avec elle la nuit. Je n’ai pas eu ce courage, mon frère non plus. Marischa y est allée, elle l’a accompagnée jusqu’au bout.
Le lendemain après-midi, je suis retourné à l’hôpital pour dire adieu à ma mère avant qu’on ne referme le cercueil. Nous nous sommes retrouvés dans la morgue de l’hôpital, Marischa, mon frère et moi. Il faisait sombre. Le visage de ma mère était apaisé, serein, libéré. Elle était à nouveau belle, belle comme elle l’avait été toute sa vie. Je me suis penché et je l’ai embrassée sur le front. Je me suis figé. Le contact était dur et froid comme de la pierre. Je n’ai compris qu’à ce moment-là qu’elle m’avait abandonné.
Je me suis enfui de la chambre mortuaire. Les croque-morts se trouvaient derrière la porte, ils attendaient qu’on ait terminé nos salamalecs pour charger le corbillard.
Ils fumaient des clopes en se marrant. L’un d’eux, un petit crevé avec des oreilles décollées et un tatouage dans le cou, menait la danse.
Il n’a rien vu venir. Il s’est retrouvé à quatre pattes dans le caniveau, le nez en bouillie, la gueule en sang. Si les autres ne m’étaient pas tombés dessus, je le finissais à coups de pompes.
Читать дальше