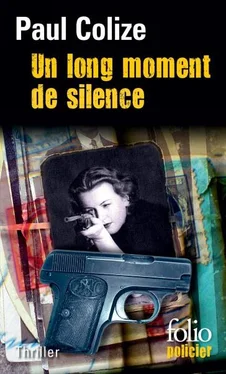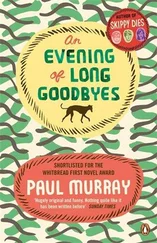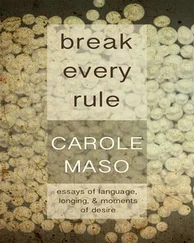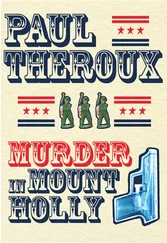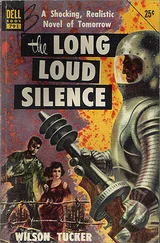Peu à peu, je retrouve mes repères. Je remonte la rue principale. À gauche, le Gasthof Zum Stern et l’ancienne ferme des parents de Carl et Annette. Plus loin, la route qui part à droite, vers Ulm.
L’église est indemne. Elle se dresse en haut de la rue, avec sa tour jaune paille et son clocher à bulbe.
Au carrefour, l’hôtel Die Post .
Une photo de mes parents prise devant la façade de cet hôtel se trouve dans l’un des albums. Ils y logeaient lorsqu’ils partaient en vacances, à Ascona ou à Lugano, avant notre naissance. Ils ne voulaient pas déranger mes grands-parents. J’en ai déduit qu’ils avaient plutôt envie de baiser tout leur saoul.
Je gare ma voiture dans la cour de l’hôtel.
Je vais à la réception et lâche quelques mots d’anglais. Par chance, il leur reste une chambre. Je la prends pour une nuit, peut-être deux, ça dépend.
La réceptionniste insiste, elle aimerait savoir si c’est pour une ou deux nuits. Je lui répète que je ne sais pas, que ça dépend. Elle me contemple avec étonnement durant quelques instants avant de battre en retraite.
La chambre est immense, équipée d’un lit à baldaquin.
La salle de bains est d’époque, la tuyauterie vétuste. Je n’ai emporté que quelques vêtements de rechange et mes affaires de toilette.
Que suis-je venu chercher dans ce trou ?
Je n’y connais plus personne. Tout le monde est mort.
Je ressors de l’hôtel et marche en direction du cimetière. Il se trouve en bas de la route qui part vers Augsbourg, à la sortie du village.
La grille est ouverte. Je parcours les allées. J’erre de gauche à droite avant de trouver le caveau de famille.
Je m’arrête devant la tombe.
Leurs noms sont alignés les uns en dessous des autres, par ordre de disparition.
Barbara, la deuxième sœur de ma mère, celle qui était mariée et habitait dans la banlieue d’Augsbourg l’a inaugurée en août 1968. Elle est morte alors qu’on l’opérait d’une simple appendicite. Son cœur n’a pas supporté l’anesthésie.
Mes grands-parents ont suivi, mon grand-père en 1972, ma grand-mère en 1983, quelques jours après la naissance de Sébastien.
Vient ma mère, le 19 octobre 1993.
J’inspire profondément.
Claudia, en 2000.
Barbara avait deux enfants, une fille et un garçon, Claudia et Roland. Claudia était l’aînée, elle avait l’âge de mon frère, Roland le mien. Claudia est morte d’un cancer du côlon, quand elle avait quarante-neuf ans. Je ne suis pas allé à son enterrement, j’en avais eu mon lot.
Mon frère se trouvait en Belgique à ce moment-là, il a fait le déplacement. Il a revu Roland à cette occasion, mais nous avons perdu le contact depuis. Je sais que Roland a continué à voir ma tante jusqu’à sa mort. Il faisait le déplacement de Munich pour lui rendre visite toutes les deux semaines.
Maria, 2004.
Elle a conservé son nom de jeune fille. Elle ne s’est jamais mariée. J’ai appris sur le tard qu’elle était la maîtresse d’un des chirurgiens de l’hôpital où elle travaillait, un homme marié qui était fou d’elle.
Je n’ai pas assisté à son enterrement et mon frère était en Afrique, sur un nouveau chantier.
Le dernier venu est Fred, le mari de Barbara, mort en 2007, à l’âge de quatre-vingt-neuf ans.
Une gerbe de fleurs dépérit au pied de la dalle funéraire.
Qui l’y a mise ? À quoi ça sert ?
Je n’ai jamais déposé de fleurs sur une tombe.
Lors d’un dîner mondain auquel un client m’avait convié, un hôte bien-pensant en quête de compassion racontait qu’il était allé se recueillir sur la tombe de son père le matin même et qu’il y avait déposé un bouquet de fleurs.
Je lui ai posé la question.
— À quoi ça sert ?
Il y a eu un blanc.
Les invités ont échangé des regards outrés. Quand l’ange a terminé sa course et que les conversations ont repris, j’ai reposé la question.
— Je vous le demande, à quoi ça sert de mettre des fleurs sur une tombe ?
Hormis quelques mimiques, je n’ai reçu aucune réponse. Mon client est resté mon client, mais il ne m’a plus invité à ces dîners à la con.
L’étiquette du fleuriste est accrochée à l’une des fleurs. Je me penche et la saisis.
Blumen Rosenblatt
Thyssenstr. 1
86368 Gersthofen
Gersthofen se trouve dans la banlieue d’Augsbourg. C’est là que vivaient Barbara et son mari.
Il ne peut s’agir que de Roland. Aux dernières nouvelles, il vivait pourtant à Munich.
S’il avait passé une commande récurrente, il aurait choisi un fleuriste du coin. J’en déduis qu’il a fait un crochet par son ancienne adresse avant de venir déposer ces fleurs. Ou qu’il est retourné vivre là-bas.
Au point où j’en suis, autant être fixé sur la question.
18
Quelque part dans la maison
Gersthofen est au nord d’Augsbourg. J’y suis allé une ou deux fois quand je passais l’été chez mes grands-parents et que ma tante Barbara vivait encore.
Je garde le souvenir d’un quartier flambant neuf, de rues aérées, de maisons colorées, de jardins animés. Nous y croisions des couples à la mine épanouie, le sourire aux lèvres, un tas de mioches empêtrés dans les jambes.
J’entre dans Annastrasse.
Les rues ont rétréci, la végétation a envahi les jardins, les façades ont perdu leurs couleurs. Une vieille femme claudique sur le trottoir.
Je n’ai eu aucun mal à trouver l’adresse, elle se trouvait dans l’annuaire en ligne. J’ai composé le numéro. Roland a décroché à la quatrième sonnerie, alors que j’allais abandonner.
J’ai annoncé qui j’étais. Il y a eu un silence, il devait replacer mon nom dans sa biographie. Il a ensuite émis un oh oh affecté.
J’ai prononcé deux mots en allemand pour manifester ma bonne volonté et j’ai embrayé en anglais ; j’étais de passage dans le coin, je n’étais là que pour un jour ou deux, je m’étais dit que ce serait bien si on se voyait.
La phrase sonnait faux. J’escomptais que la langue de Shakespeare travestirait mon manque d’entrain. À ma surprise, il m’a répondu en français. J’étais le bienvenu, ça faisait longtemps, il m’expliquerait tout.
Je me gare devant le 25. Je ne reconnais pas la maison, je ne la voyais pas aussi grande.
Mon oncle Fred était graphiste. Quand il ne travaillait pas, il peignait. Ses toiles étaient disséminées dans la maison. Certaines étaient achevées, d’autres en cours. Il y en avait dans chaque pièce.
Ma tante peignait également. Ses toiles s’ajoutaient à celles de mon oncle. Au final, la maison ressemblait à un musée en cours d’aménagement. Je n’ai jamais su s’ils avaient du talent, s’ils étaient reconnus ni si leur passion commune était rémunératrice.
Je parcours l’allée. Une enfilade de nains pâlissent dans le jardin.
Mon cousin m’attend sur le pas de la porte.
Il ouvre les bras.
— Stanislas, je me réjouis.
Je lui tends la main.
— Moi aussi.
J’ai mal dormi, ça joue sur mon humeur.
Je le remets sans peine. Il a gardé son look d’artiste inspiré ; il est aussi maigre qu’avant, ses longs cheveux noirs sont devenus de longs cheveux blancs. Il porte un bouc et un anneau dans l’oreille.
Son corps se perd dans une chemise blanche trop large et un pantalon de toile orange. Aux pieds, il traîne les traditionnelles Birkenstock.
— J’ai calculé le temps qu’on ne s’est pas vus. C’est dix-neuf années.
Une façon élégante de me dire qu’il a assisté aux funérailles de ma mère et que je lui ai fait faux-bond pour sa partie.
Читать дальше