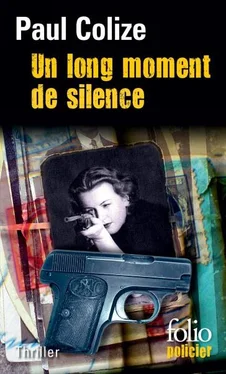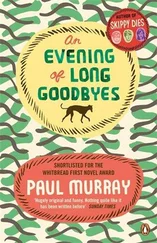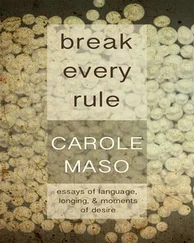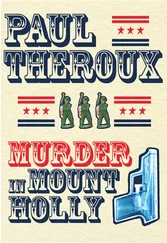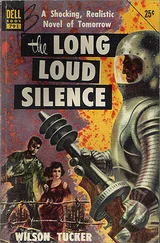À leur tour, les Polonais l’ont conquise en 1918. Le traité de Riga l’a reconnue terre polonaise, ce qu’elle est restée jusqu’en 1939.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, deux semaines après que les Allemands ont eu envahi la Pologne par l’ouest, l’Armée rouge est entrée par l’est et a occupé Lwów.
Deux ans plus tard, en 1941, quand la lune de miel entre Hitler et Staline avait pris fin, les Allemands en ont repris le contrôle.
De par les aléas de l’Histoire, les mères de ses parents respectifs étaient nées autrichiennes, ce qui leur a permis d’être considérés comme Volksdeutsche , un statut censé les mettre à l’abri de la disgrâce, un statut que les Allemands accordaient aux personnes qui avaient du sang allemand dans les veines, mais qui vivaient hors des frontières, tels que les Alsaciens ou autres minorités germanophones de l’ancien empire d’Autriche.
L’étude de cet épisode m’a permis de comprendre pourquoi ma mère parlait couramment allemand, alors qu’elle n’avait vécu que peu de temps en Allemagne et qu’elle ne s’y rendait qu’une fois par an.
En juillet 1944, les Russes ont lancé une nouvelle offensive et ont repris la ville. C’est à ce moment que sa famille a fui.
Un membre de leur personnel était également Volksdeutscher . Lors de l’intervention russe, il leur a donné un coup de main pour préparer leur fuite et les a aidés à s’installer en Allemagne, à Gabelbach, un hameau voisin de Zusmarshausen, où vivait sa propre famille.
Quant à ma mère, elle ne s’est pas sentie chez elle en Allemagne et ne supportait plus l’autorité parentale. Elle n’avait alors que dix-huit ans. Elle était la plus jeune des trois filles, mais elle voulait voler de ses propres ailes.
Un soir, lors du dîner, elle a annoncé qu’elle les quittait. Le lendemain, elle a pris un train pour la Hollande. Elle y a vécu quelques semaines, puis est allée en Belgique.
Après avoir participé à quelques concours de beauté, elle a trouvé du travail à Bruxelles, chez une modiste, où elle confectionnait des chapeaux. La modiste, une certaine Blanche, était mariée à mon père, mais leur couple battait de l’aile.
L’arrivée de ma mère a bouleversé mon père. Il est tombé follement amoureux d’elle. Il voulait vivre avec elle et lui faire des enfants. Il lui a fait quitter l’atelier et lui a trouvé un job dans la maison de couture de sa mère. Peu après, il a divorcé et ils se sont mariés.
Elle m’avait lâché l’information comme s’il s’agissait du bulletin météo.
J’étais ravi d’en savoir plus. En même temps, j’étais déçu. Je pensais détenir une information-clé, mais il ne s’agissait que d’un tuyau crevé, un fait anodin que l’on nous avait caché pour la seule raison qu’il n’était pas bon d’être enfant de veuve et fils de divorcé.
J’ai pensé un moment lui parler du pistolet que j’avais trouvé, mais elle m’aurait servi une explication tout aussi banale et mon rêve aurait été anéanti.
Je me suis abstenu, je ne voulais pas qu’elle tue mon héros.
À proximité de la maison, je lui ai posé une dernière question.
Pourquoi ma mère ne parlait-elle jamais de mon père ?
Elle a continué à marcher et m’a répondu sans me regarder.
— Ton père allait au Caire pour son travail. Ce qui est arrivé est très triste. Ta mère en a beaucoup souffert et en souffre encore aujourd’hui. Il ne faut pas lui reparler de cela.
Elle avait changé de ton. Ses phrases sonnaient comme un message enregistré. J’ai eu le sentiment que cette réponse était préparée de longue date, qu’elle savait qu’un jour elle viendrait et s’était programmée pour l’affronter.
Je n’ai pas insisté.
Ces phrases sont restées gravées dans ma mémoire. La première me revient aujourd’hui, avec un éclairage nouveau.
Pourquoi a-t-elle mentionné d’entrée de jeu que mon père allait au Caire pour son travail ? Pourquoi était-il nécessaire de le préciser, puisque cela tombait sous le sens ?
Savait-elle, elle aussi, ce qu’il allait y faire ?
Sur le moment, je me suis senti mal à l’aise. Je ne voulais pas qu’elle parle de notre conversation à ma mère. Il fallait surtout qu’elle oublie cette dernière question. Pour noyer le poisson, je lui en ai posé une autre avant d’entrer dans la maison, la première qui me venait à l’esprit.
Comment avait-elle réussi à décrocher cette place de chef de laboratoire alors qu’elle n’avait pas le diplôme requis ?
À ma surprise, la question a semblé la perturber davantage que la précédente. Elle a blêmi, s’est mise à bafouiller. Dans le désordre, elle m’a dit qu’elle avait dû interrompre ses études pendant la guerre, que personne ne détenait ses compétences quand elle est arrivée dans le village, qu’elle avait saisi une opportunité.
Comme elle ne trouvait pas les mots justes, elle a déclaré qu’on en reparlerait plus tard.
Elle ne m’en a reparlé que quarante ans plus tard, sur son lit de mort. La réponse tenait en une phrase énigmatique.
J’ai dû faire des choses que ma conscience réprouvait.
15
Un chien aboie dans un jardin voisin
J’ouvre les yeux.
Il est quatre heures.
Je suis trempé des pieds à la tête. Le drap me colle à la peau.
La maison est calme. Laetitia me tourne le dos. Elle dort en chien de fusil, les jambes repliées contre le ventre, la respiration paisible.
Je me lève, m’habille à la hâte.
Mon rêve récurrent est revenu me hanter. Je n’ai jamais su si c’était un effet de mon imagination ou la résurgence d’un fait enfoui dans mon inconscient. La forme varie, le fond est immuable.
Je suis assis dans le salon, je joue avec mes cubes de bois. Le téléphone sonne. Ma mère entre dans la pièce, me regarde, sourit, décroche, écoute quelques instants, dit non, s’effondre.
Cette nuit, le rêve ne s’est pas arrêté à ce moment-là.
Ma mère a rouvert les yeux.
Elle a articulé quelques mots, mais aucun son n’est sorti de sa bouche. J’ai délaissé mes jouets et j’ai marché vers elle, à quatre pattes.
J’ai posé mon oreille contre sa bouche.
Les yeux dans le vide, elle répétait la même phrase, d’un ton monocorde, à l’infini.
Je regrette tellement.
Je descends l’escalier. Je prends mes clés, mon portefeuille et mon téléphone sur la commode du hall. Je sors de la maison et referme la porte sans bruit.
Le jour se lève.
Mes pas crissent sur le gravier de l’allée.
Un chien aboie dans un jardin voisin.
16
Un acte de vengeance personnelle
Le jeudi 4 mai 1950, l’agent de garde de la police de Neuhof, une petite ville de dix mille habitants située non loin de Fulda, reçut un appel téléphonique peu avant six heures du matin.
Un homme l’informa qu’un cadavre se trouvait sur le parvis de l’église Saint-Laurent. Il refusa de dévoiler son identité, ne donna aucun renseignement complémentaire et raccrocha.
Une voiture de patrouille fut aussitôt envoyée sur les lieux.
Les policiers découvrirent le corps d’Otto Kallweit, un bibliothécaire au chômage, âgé de cinquante ans, domicilié à Neuhof depuis quatre ans.
Le médecin légiste estima que Kallweit était mort vers vingt-deux heures, tué d’une balle dans la tête tirée à bout portant.
L’autopsie, réalisée plus tard dans la journée, permit de récupérer le projectile. Il s’agissait d’une balle de 9 mm, provenant vraisemblablement d’un Luger Parabellum, un pistolet très répandu en Allemagne.
Читать дальше