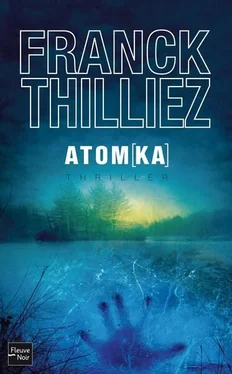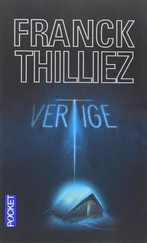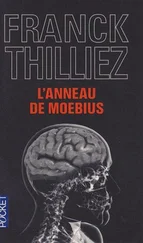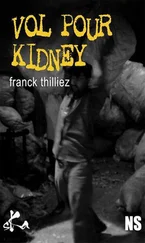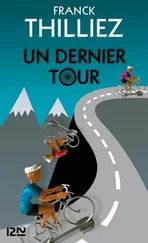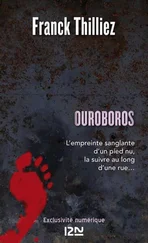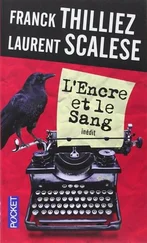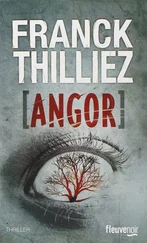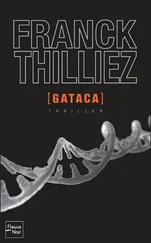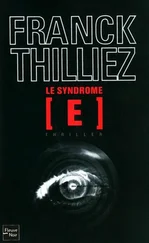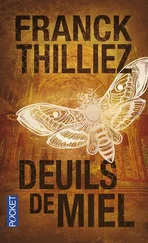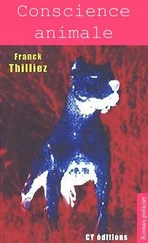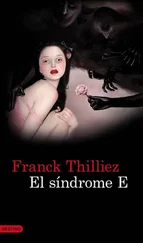— C’est elle, souffla Madère. Alors c’est toi, le fameux flic qu’elle connaît bien ? Ça me revient maintenant. Elle m’a déjà parlé de toi. Shark…
Le commissaire se frotta les lèvres, inquiet et terriblement nerveux. Gloria Nowick était une ex-prostituée qu’il avait arrachée à la rue, une dizaine d’années plus tôt, parce qu’elle l’avait aidé à résoudre une affaire d’homicide et s’était mise en danger. Avec Suzanne, ils l’avaient retapée jusqu’à ce qu’elle trouve un job et soit capable de s’assumer. Suzanne et elle étaient alors devenues amies. Même s’il ne l’avait plus revue depuis la mort de sa femme — Gloria était venue à l’enterrement —, Sharko avait toujours gardé une affection particulière pour elle, comme celle que l’on peut ressentir à l’égard d’une petite sœur.
Il considéra Madère dans les yeux. Il n’y comprenait rien.
— Ce serait elle qui aurait transporté ton sperme là-bas ? Pourquoi ?
— Qu’est-ce que j’en sais ?
Madère se releva, incapable de tenir en place.
— On est allés dans l’unité de visites familiales, rien qu’à deux, mercredi dernier. On nous a laissés un quart d’heure ensemble, on a baisé à la va-vite. Elle est repartie juste après. Mon sperme n’était pas dans un tube, il était en elle.
Il se pencha et agrippa Sharko par le col.
— C’est quoi, ce bordel ?
— Remarquable. Cette vieille photo est remarquable.
Lucie se tenait aux côtés de Fabrice Lunard, l’un des chimistes du laboratoire de police scientifique. Elle était exténuée, elle avait mal dormi, et elle pensait encore évidemment à ce qui s’était passé la veille au soir, dans les bois : droite comme une tombe, sans chaussures dans la neige. Elle ne se rappelait pas les avoir enlevées, elle n’avait même pas ressenti le froid.
Comme si elle avait été ailleurs. En dehors de son corps.
Perturbée, elle essaya néanmoins de se concentrer. Lunard attendait pour expliquer. Le scientifique avait à peine la trentaine, des airs d’adolescent, mais était un technicien érudit, encyclopédique, capable de réciter des formules chimiques incompréhensibles du bout des doigts. Il venait de jeter un œil aux photocopies des feuilles volantes et du cahier trouvés dans la cave de Philippe Agonla, ainsi qu’à une reproduction d’excellente qualité de la photographie en noir et blanc à demi brûlée.
— Albert Einstein, père de la théorie de la relativité, l’un des plus brillants physiciens de tous les temps. Marie Curie, seule femme à avoir reçu deux prix Nobel. Elle a été récompensée pour la physique en 1903 et pour la chimie en 1911, au sujet de ses travaux sur le radium et le polonium. Elle inventera et construira les « Petites Curies », des unités chirurgicales mobiles qui sauveront de nombreux soldats durant la Première Guerre mondiale, et je ne te parle pas de l’institut Curie, ainsi que de tout le bienfait qu’elle apporta à l’humanité tout au long de sa carrière. Une grande, grande femme.
— Je n’en doute pas une seconde. Et le dernier individu ?
— Svante August Arrhenius, un chimiste suédois, Nobel de chimie en 1903, également prodige en mathématiques et en de nombreux autres domaines. Dans son genre, un sacré visionnaire.
Lucie observa plus attentivement ce troisième personnage, au cou serti d’un nœud papillon sombre. Arrhenius, un chimiste suédois. Que venait-il faire dans l’équation ?
— Et ces trois-là se rencontraient souvent ? demanda Lucie.
— Probablement lors des grands congrès scientifiques de l’époque. Ces congrès permettaient des avancées dans des univers comme la mécanique quantique, la physique relativiste, la physique nucléaire, et, globalement, tous les domaines en relation avec l’infiniment petit. Du beau monde qui se regroupait assez souvent dans diverses villes d’Europe. Certains scientifiques se détestaient, comme Einstein et Bohr, ou Heisenberg et Schrödinger. Lors de ces congrès, les différents clans démontaient les théories des uns et des autres à grand renfort de monstrueuses démonstrations mathématiques, mais tous se connaissaient, sans exception. On a souvent vu, par exemple, les photos d’Einstein, chapeau de feutre et pipe, discutant avec Marie Curie en pleine campagne.
Lunard orienta une loupe vers la photo.
— Einstein a une quarantaine d’années, je dirais, et Curie, la cinquantaine. Je pense que la photo a été tirée autour des années 1920, mais pas au-delà, car Arrhenius est mort en 1927. On est au début des théories quantiques, on commence à décortiquer la matière et à accéder de façon assez remarquable à l’atome.
Il désigna ses collègues dans les autres bureaux.
— Les infos circulent vite ici. Dans les labos, on est tous au courant, évidemment, de l’affaire brûlante sur laquelle vous bossez à la PJ. Cette histoire de manuscrit, de lacs gelés et d’« animation suspendue ». C’est assez effroyable et extraordinaire, d’ailleurs, votre enquête.
— Extraordinaire dans le mauvais sens du terme.
— C’est ce que je voulais dire.
Il reposa la loupe et écrasa son index sur le visage d’Arrhenius.
— Il y a quelque chose qui pourrait t’intéresser concernant ses travaux.
— Vas-y.
— Le froid le fascinait. Il a beaucoup voyagé dans les pays nordiques, il a longtemps étudié les glaciations, les effets du grand froid sur les réactions chimiques et sur les divers organismes.
Il désigna à présent des livres de chimie posés sur une étagère. Lucie était tout ouïe.
— Ouvre n’importe quel ouvrage de chimie, et l’on parlera de ses travaux. Arrhenius est à l’origine d’une loi très connue dans la communauté scientifique, permettant de décrire la variation de la vitesse d’une réaction chimique en fonction de la température. Pour faire très simple, la loi raconte que plus les températures sont basses, plus les réactions chimiques entre les composés soumis à ces températures sont lentes.
— Comme les cadavres, qui se décomposent moins vite par grand froid.
— Exactement, ça découle directement de la loi d’Arrhenius. À des températures proches de celle de l’azote liquide par exemple, on peut dire que les réactions chimiques sont inexistantes : toutes les molécules sont figées. Rien ne se crée, rien ne disparaît, si tu veux. Comme si Dieu avait arrêté le temps.
Lucie hocha la tête lentement, essayant de remettre de l’ordre dans ses idées.
— Le froid, la chimie : on est en plein dans notre sujet, là.
— On dirait, oui. J’ignore s’il y a vraiment un rapport, mais Arrhenius a passé des mois du côté de l’Islande en plein hiver pour mener des recherches sur le froid. Il carottait des morceaux de glace qu’il rapportait en Suède afin de les analyser et de faire des datations. Et en Islande, qu’est-ce qu’on trouve en grand nombre ?
— Des volcans ?
— Et, donc, beaucoup de sulfure d’hydrogène, piégé dans la glace. La glace, le sulfure d’hydrogène, les deux éléments essentiels de votre enquête, à ce que j’ai compris.
— Ces trois scientifiques seraient à l’origine du fameux manuscrit qui a causé tant de morts ?
— Les trois, ou l’un d’eux exposant ses travaux aux autres. Oui, c’est bien possible qu’ils soient à l’origine du manuscrit, sinon, on n’aurait eu aucune raison de trouver cette photo entre les pages dudit manuscrit.
— Rien d’autre ?
— Là, maintenant, non. Mais je vais essayer de creuser un peu cette histoire de carottage en Islande, il doit forcément y avoir des traces, des comptes rendus scientifiques dans de vieilles archives. Laisse-moi quelques jours.
Читать дальше