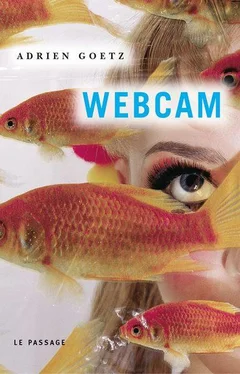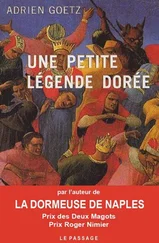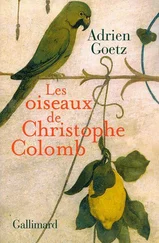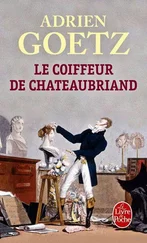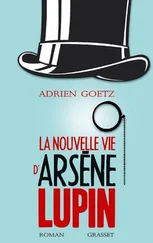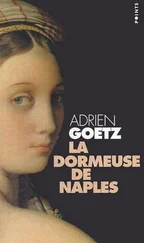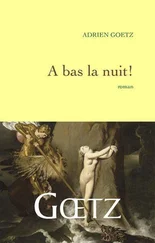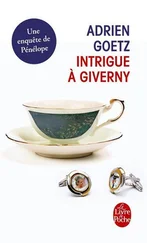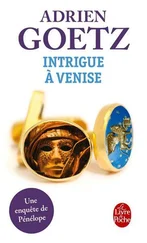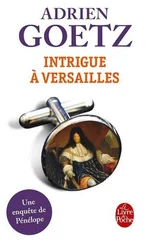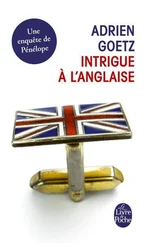Ma chance, ce fut la Première Guerre mondiale et les trois ans que Mustapha Djerbi passa en camp de prisonniers à regretter ma mère, d’où dérivent ses plus belles pages, ses souffrances, ses clairs de lune sur le Bosphore perdu et ensuite son Nobel. Grand homme de la Turquie libre et moderne, il fut jusqu’à sa mort une de ces « hautes consciences du siècle » dont se régalent les journalistes qui ne lisent jamais rien. J’en ai fait des bons dîners grâce à lui. Maman couchait avec un sens aigu de l’utilité par-delà les années, un vrai flair, et par-dessus tout, sans en avoir conscience, l’amour de son seul fils. Elle fut en ce sens une mère exemplaire.
Après la Victoire, mon petit livre sur la goutte d’eau donna des espérances de recyclage à la France exsangue mais glorieuse. La patrie se réconcilia autour des dessins du petit prodige alors que la femme turque se libérait grâce à Mustapha, qui affichait ses trente kilos de moins, et devenait montrable. Pourquoi l’avait-on mis dans un camp de redressement pour prisonniers politiques et pas avec les prisonniers de guerre ? J’appris plus tard que c’était comme homosexuel. Je ne crois pas que ma mère s’en soit doutée. Lui en avait tellement honte qu’il ne cessait de s’inventer de nouveaux faits de résistance et de nouvelles histoires de filles qui n’avaient pas résisté. J’appris comment on truque une biographie, comment on s’invente une histoire. Si l’on veut être un génie, il faut reprendre les événements en main. Mais sa ligne retrouvée et ses succès littéraires facilitèrent beaucoup les choses pour ce cher Moustache dans les bars spécialisés du Paris de Clémenceau. C’est Rex, qui l’avait croisé, des années plus tard, au Fiacre, qui m’a expliqué tout cela. Je n’en revenais pas. À dix-sept ans, je fis ma première exposition et je me voyais bien en Radiguet de la peinture. Depuis, je n’ai pas cessé de peindre et de créer.
Racontées ainsi, les choses s’enchaînent rapidement. Il faut bien comprendre que cela prit des années. Jusqu’à cinquante ans, je suis resté presque inconnu, sauf ces quinze dessins pour le petit livre du Nobel turc que tout le monde avait offert en cadeau de Noël. J’avais mes collectionneurs attitrés, mon cercle d’admirateurs. Leur médiocrité me comblait : un professeur de piano semi-aveugle qui m’acheta huit toiles en huit ans, le concierge du lycée qui avait installé un paysage dans sa loge, le beau monde que hantait ma mère entre deux offices, avec ses chapelets de cousines et de cousins fauchés pour lesquels je privilégiais les petits formats, la chroniqueuse « arts » de Jardin des modes, ou un journal équivalent, je ne me souviens plus de ce qui faisait autorité alors — était-ce encore La Gazette du bon ton ? — , qui s’enticha un soir de mes mauves et m’emporta deux bouquets. Je revois passer de temps à autre des toiles de cette époque, certaines anonymes, d’autres que j’avais eu la bêtise de signer de mon nom. Manette les fait systématiquement racheter discrètement et nous les brûlons. À chacun sa cour des miracles. Les autres artistes m’aimaient, me considéraient comme un amateur un peu doué. Je faisais peu d’ombre. Aucune presse, aucun écho, ni « commandes publiques » ni musées. On ne m’a pas vu venir.
J’ai durant tout ce temps vécu d’autres métiers secrets dont personne n’a jamais parlé. Mes biographes officiels ont eu fort à faire avec mes années de longue jeunesse, ma vie à Nazareth sans Marie ni Joseph. Comme je sais écrire dans un beau style classique qui ne mange pas de pain, avec de temps à autre une de ces formules syncopées qui plaisent bien, je suis devenu nègre dans une maison d’édition : j’ai rédigé les mémoires d’hommes politiques et de vedettes, écrit les discours du président du Sénat qui passait sa vie à en faire sur tous les sujets. Certaines années, j’ai écrit sept cents discours. C’était un défilé de motards officiels dans mon petit appartement qui venaient apporter la documentation et rechercher la ponte du jour. J’accueillais du même ton les sénateurs belges, les délégués de l’Albanie, les comices agricoles du Limousin, je présidais des congrès, j’ouvrais des colloques de trois jours, je prenais la parole dans une école pilote, je racontais la Constitution à un groupe de femmes du Cameroun, j’inaugurais à tour de bras… Ma concierge n’en revenait pas. J’avais alors une haute conscience de ma médiocrité et j’aurais mangé mon bras pour en sortir. Patience.
J’avais de vraies crises de solitude et de rage. Je me souviens d’avoir disparu un jour dans les rues de Paris, piéton sans refuge durant une bonne semaine. Je n’écrivais pas, je ne dessinais rien. J’étais l’homme d’un seul livre. Le garçon qui avait illustré le conte pour enfant du prix Nobel, un pas-grand-chose. On ne construit pas une vie avec ça. Je ne savais pas quoi faire d’autre, quoi faire de mieux. J’allais être un raté.
Mon biographe patenté, Louis Rex, qui a pu s’acheter un château dans le Lubéron avec la vente de ma plus grande toile, que je lui avais donnée pour bons et loyaux services, le misérable, a écrit à propos de cette époque de ma vie :
Peintre secret, Gossec passa trente années de sa vie à ne rien montrer tant son souci de perfection était grand et haute l’exigence en laquelle il tenait son art. Les expériences qu’il tenta durant ces années sont pourtant fondamentales pour le développement ultérieur de sa manière. […] Proche par l’esprit des surréalistes, sans pourtant faire jamais partie de leur groupe, il inventa une création faite d’idées pures qui constitue, avec des années d’avance, un premier pas vers l’art conceptuel. Ces années furent aussi d’intenses années de voyage, qui lui permirent, entre Arezzo et Assise, d’admirer les maîtres de la Renaissance. La rigueur d’une architecture chez Piero della Francesca, la noblesse d’un drapé dans une fresque de Giotto furent définitivement pour lui la seule école qui lui parut digne de ses intuitions. C’est en eux qu’il se retrouvait.
Rex m’aime, le brave garçon, il a sans doute été amoureux de moi au moment où nous nous sommes connus. Face à Picasso, si entouré, j’étais libre : génie à prendre. Il ne savait pas sur qui écrire, il n’écrivait pas mal, dans le genre sauce blanche un peu épaisse, bien liée à la farine et qui colle un peu. Du beau style d’historien d’art années quarante. J’ai embobiné Rex. Il porte bien son nom de chien. Il est fidèle, intelligent, il donne la patte. Je ne suis peut-être pas assez gentil avec lui. Maintenant, il est vieux lui aussi. Physiquement, il a moins bien vieilli que moi, son profil d’empereur s’est empâté. Il est passé d’Auguste à Vitellius. Je plains les gigolos, s’il s’en paye encore. J’ai été pour lui la Providence, la manne dans le désert, le tocard sur lequel il n’en revient toujours pas d’avoir misé. Il me doit sa graisse, son suif au ventre, ses bourrelets. Il m’expliquait dans quelle direction je devais aller, il se répandait partout, à la fondation Carrier, à la donation Lannelongue, à l’École du Louvre, dans les ateliers de la Ville de Paris, dans une infinité de cours du soir et de conférences gratuites, de forums dans les écoles et de débats dans les librairies.
Il était la madone des rombières. Des nuées de vieilles éblouies et d’étudiantes un peu revêches ont été endoctrinées. Même à moi, il détaillait mes propres œuvres, emporté par son élan pédagogique. Il tonnait contre Picasso. Je peignais des paysages quand il se sentait en veine d’écrire sur l’art du paysage, je m’inspirais d’Ingres quand il avait inscrit « les portraits d’Ingres » à son programme du trimestre. Et dans Le Soir, il me comparait à Ingres dans une grande double page. Ses articles n’étaient qu’un cri d’amour. Je le méprisais, il le sentait, mais je le rendais célèbre, je l’enrichissais. Je lui étais indispensable — autant qu’il l’était lui, pour ma cause. Il me doit d’abord ses meilleurs livres. Je lui dois mes meilleures critiques et quelques-unes de mes meilleures ventes. Il aurait voulu plus. J’ai préféré me laisser désirer. M’aimait-il d’ailleurs ? Au début, sans doute, mais ensuite je n’ai été que la pièce maîtresse dans le jeu de sa rivalité minable avec ses collègues — il était mon champion décidé à faire bisquer le champion de Matisse et celui de Picasso — qui seraient toujours plus lus et mieux en cours que lui. Mes œuvres, il s’en moquait, il fallait que son pouvoir soit aussi grand que celui de ces quelques éternels rivaux. Cela se mesurait en places dans les jurys (concours d’entrée de l’école des beaux-arts, prix du Livre d’art du mois de mai, attribution de la commande pour le plafond de tel théâtre…), en nombre d’articles parus, en ventes de livres, en présence à la radio puis à la télévision. Il serait mort plutôt que de n’avoir pas ses vingt minutes si son collègue matissien avait tenu le crachoir la semaine d’avant, fût-ce à une heure du matin. Pour passer à l’antenne, il relançait, téléphonait, faisait jouer ses relations, se plaçait sur le passage du directeur de chaîne à l’heure du déjeuner. La servilité et l’ambition de ce pauvre Rex m’ont fait autant de bien que son amour. Il ne défendait pas une idée de l’art, il ne s’est jamais demandé s’il appréciait ce que je faisais, il n’était pas non plus foncièrement vénal, c’était juste un brave intrigant, comme il s’en rencontre en tout milieu. Ma chance, ce fut de le trouver à ma dévotion, prêt à marcher sur tout le monde avec mes armes à la main. Mon œuvre existait sous sa plume, j’avais le sentiment de me comprendre. Delacroix a été défendu par Baudelaire, Manet par Zola, moi je n’aurai eu que ce pauvre Rex, mais il a déployé une telle énergie, un tel carriérisme, une telle ténacité, qu’il est aujourd’hui au plus haut et moi avec lui. Baudelaire est mort comme un clochard et Zola intoxiqué par ceux qui le traitaient de paria et de métèque — Rex, lui, est florissant. Moi, je vais triompher, mes cent ans seront le couronnement de notre travail.
Читать дальше