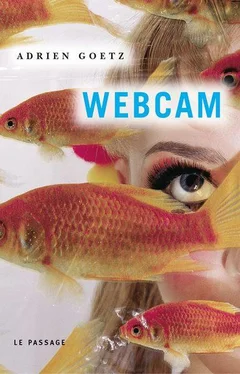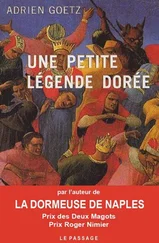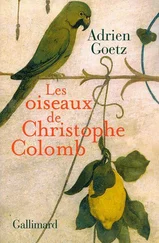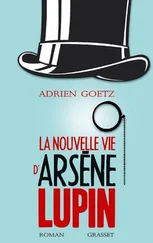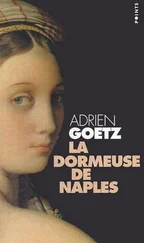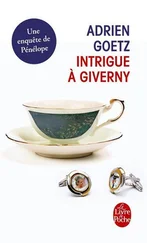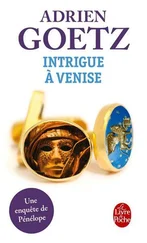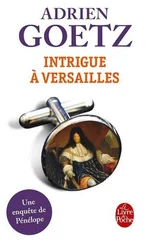Natacha Idric
Relire ce torchon me met hors de moi. C’est cela, le journalisme qui compte aujourd’hui ? Je vais la réduire en bouillie, avec amabilité, elle ne s’en apercevra que plus tard. Je n’en ferai qu’à ma tête. Qu’elle marine un peu. Je vais d’abord noircir une page ou deux de souvenirs d’enfance, parler de ma sainte mère, cela me fera du bien. Je vais écrire à la plume, pour sentir ma main glisser sur le papier. Pour que mon cahier me caresse et m’apaise. J’ai des terreurs de vieillard comme on a des peurs d’enfant. Cela ne dure pas. Puis je recevrai dans l’ordre inverse, la « journaliste », en une, la gueuse catalogueuse ensuite, pour que l’une ne soit pas prête et l’autre agacée. Je donne des ordres à Jacques d’une voix grave : qu’elles patientent dans deux antichambres séparées. Qu’elles ne se rencontrent pas. Prudence élémentaire. Et ce soir, devant l’écran, mes petits s’endormiront doucement en sentant le parfum de leur mère.
CHAPITRE 4.
Le palais de Dioclétien
Ma mère ne se parfumait pas. Elle sentait le savon à l’huile de palme. Je suis né dans le palais de Dioclétien, un squelette de dinosaure, une carcasse bâtie au troisième siècle, un petit cercle de cailloux dressés entre l’Empire romain d’Orient et l’Empire romain d’Occident. Je ne me suis jamais consolé de l’avoir abandonné, et j’ai choisi Cérisoles, citadelle abandonnée, comme un remords.
Autour du cercle de moellons, un grand carré de murailles au centre du monde antique — un coffre de marin posé devant la Méditerranée. La fracture visible de deux univers, la faille des tremblements de terre. Le palais tient. Les pierres énormes barrant la ligne de la mer, quelques îles à l’horizon, les bruits du port. Ce sont les parfums les plus doux que je connaisse, les arbres de Split, l’harmonie et le désordre. Ma ville. Les serviettes de bain en éponge qui sèchent au soleil au retour de la plage. J’entends encore les sons de cette époque. Mon père qui explique qu’il possède une voix très rare, celle du baryton Martin. Je ferme les yeux. Je les vois. Je retrouve l’odeur des papiers sur les murs.
Le quadrilatère construit par les géants de Pannonie est devenu une ville au Moyen Âge, cité tour à tour riche et pauvre, aujourd’hui assez misérable. Notre maison était bâtie dans l’ancien réfectoire des prétoriens.
Quand mille gaillards se jugeaient bien ivres morts, ils élisaient en tapant sur les tables avec leurs gantelets de fer un nouveau maître du monde, un enfant de dix ans qui descendait de Vénus et d’Hercule, le pantin qu’ils mèneraient.
Cet enfant, ils finissaient par l’immoler, comme la petite fille violée et égorgée dans ma chambre, dans ce film horrible envoyé à Nahoum. Je me demande si je dois prévenir la police, porter plainte. Je vais d’abord demander conseil à Jacques — lui saura si c’est une méchante blague des « amis » interlopes de cette fripouille de Virgile, s’il y a des traces de sang derrière les barrières du musée national d’Art moderne. Je ne veux tout de même pas croire que l’on égorge vraiment des fillettes pour le plaisir de faire peur à ma femme. Je vais aussi consulter Manette. Qui sait à quel point Nahoum est passionnée par ces nouvelles images ? Virgile ? Petit salaud immature. Si c’est lui qui a fait ça, je le crève.
Des murs de six mètres d’épaisseur, un linteau de porte en marbre sculpté, une frise de petits amours en cuirasse, des socles de colonnes pris dans les cloisons de séparation, pas de gaz, pas d’eau courante, le linge de ma mère à la fenêtre. Notre bastion indestructible. Triste comme la grandeur. Méchant et joyeux comme un empereur enfant du Bas-Empire, je courais sur les dalles polies des rues. Pas la décadence : l’oubli des siècles qui viennent après.
Je possède encore cette maison, je n’y vais jamais. Celle-là aussi n’existe plus que dans mes rêves et je la rendrai au réel au moment où je fermerai les yeux, quand mes enfants feront tout vendre. Je leur conseille d’attendre pour la liquider que les agences immobilières pour milliardaires aient compris la beauté de Split. Ce sont les demeures de mes souvenirs, ils y vivent entre eux, ce qui ne me regarde plus. Je les loge bien. Je vois la photographie de mon père en uniforme, dans la grande pièce. L’uniforme des miliciens nationalistes, le milieu d’extrême droite qui donnera naissance, avant la Seconde Guerre mondiale, aux oustachis.
J’écris ce malheur en toutes lettres après l’avoir caché comme un secret de famille honteux. Je détache la phrase du paragraphe, pour qu’elle saute à l’œil sur le blanc du papier. Mon pauvre père, avec ses deux médailles gagnées, l’une au mérite et l’autre à l’ancienneté. Je les ai aussi, ces rubans passés au soleil, dans un tiroir qui ferme à clef. Comme il serait heureux, mon père ce salaud au sourire si doux, de me voir en colonel comte de comédie, avec le cordon de la Légion d’honneur brochant sur celui de Charles III d’Espagne. Il avait toujours rêvé de ce genre de breloques. Et mes faux ordres certifiés par des parchemins d’un mètre de haut, mes étranges décorations étrangères dans une vitrine en loupe d’orme qui occupe tout un mur de mon dressing, c’est à cause de lui, de ces deux rubans pâles trouvés dans un tiroir, que je me suis cru obligé, l’âge venant, de les accepter. Jean-Paul Sartre, un autre qui aimait bien jouer les génies — nous avions osé en parler une fois au Flore —, lui qui a refusé le Nobel et la Légion d’honneur, est mort, sans que personne n’en sache rien, commandeur dans l’ordre national du Mérite. Les seules vraies joies, celles du lit de mort, sont mesquines. Voilà toute la France que j’aime, mon second pays, petit, peureux, puant, qui ne m’a jamais déçu.
Refuser les honneurs aurait mieux correspondu à mon image, je n’en disconviens pas, mais en mémoire de mon père et de ses galons gagnés du mauvais côté, du côté des préfachos, des ligues, des amis d’Ante Pavelitch, des cervelles brûlées et des lecteurs de la mauvaise presse, j’ai accepté. Bien sûr, je n’ai jamais vraiment porté tous ces rubans. J’ai dit que je n’avais rien demandé, pas rempli un seul formulaire, que c’était venu tout seul comme la couperose et les taches d’eau de Cologne. On indiquera mes décorations sur mon faire-part. J’ai lu aussi quelque part que je suis chevalier de Malte. C’est faux, par bonheur, je n’aurais jamais pu attester devant leur commission des preuves de l’authenticité de notre « comté », et pour cause. Ni voulu aligner assez de billets pour siéger avec les Américains chevaliers de grâce et de mérite. Assez de mérite. De grâce, juste de l’honneur, rien d’autre. J’en riais avec mes deux complices, le cher Yves Klein, qui s’était marié en grand uniforme, cape et croix sur l’épaule et voûte d’acier à la sortie de l’église, en chevalier dans l’ordre de je ne sais trop quoi. Et le vieux Balthus, la dernière fois que je me suis rendu chez lui, qui avait fini par croire sur parole les domestiques qui lui donnaient, comme à moi, du « monsieur le comte » et qui, tout gâteux, n’oubliait jamais de dire « la comtesse » en parlant de sa femme. Lui, je ne suis pas sûr qu’il en riait encore. Marquis, cela sonnait faux, baron ce n’est pas assez, duc, cela se vérifie dans un dictionnaire : il avait fait comme moi, il avait choisi comte, vrai ou faux peu importe, pour aller dîner en fauteuil roulant chez le président de la République.
De mon côté, tout est inventé : l’origine de ce beau récit légendaire et fondateur, c’est le rôle de comédie que tenait mon père, dans notre bout de palais de Dioclétien envahi par la marmaille et les odeurs de soupe. Monsieur le colonel comte est servi. Les titistes ne l’ont pas massacré à Maribor, il était mort avant, à Paris. Je sens encore le fumet du chou sans lard et des pommes de terre. J’ai découvert très tard l’odeur de la chair cuite, les différentes viandes, j’ai grandi aux légumes et à l’huile. La tomate frottée sur du pain. La poiscaille frite les dimanches de fête. C’est ainsi qu’on fait les centenaires, mademoiselle Idric.
Читать дальше