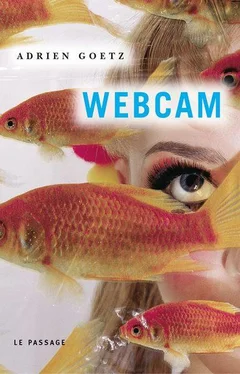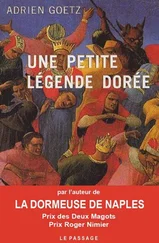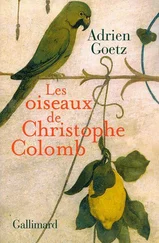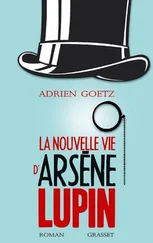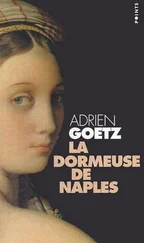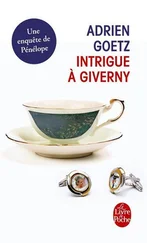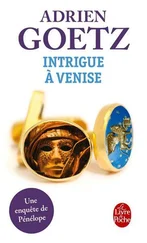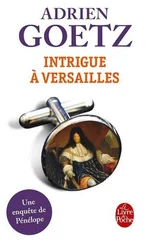La nuit, enfant, j’allais sur la place du Péristyle. La salle du trône abandonnée de Diocletianus Imperator. Derrière la muraille, dans l’axe monumental, je vois encore la salle ronde, si connue dans les livres d’architecture — le premier cercle, un Saint des Saints que le catholicisme n’a pas osé transformer en église. Vide. Au centre de la cella, l’oculus, un cercle de ciel que je regardais, la nuit, couché à terre en observant les étoiles. Je les comptais. J’en faisais une carte dans ma mémoire. Je me sentais l’empereur du monde. J’avais huit ans. Je voulais reconstruire Split. Que ma mère soit l’impératrice et mon père le général des armées, le chef des prétoriens. Les étoiles prisonnières dans un cercle de pierres, je les retrouve ici, à Cérisoles. Le pigeonnier est aussi beau pour moi que le Panthéon de Rome ou le sanctuaire circulaire du palais de Split. Je m’y endors, en été, dans une couverture. Je me déshabille à midi pour bronzer seul, pour me chauffer comme un enfant qui aime l’été, les veilles de séances de photos. Un sac d’ossements qui se tanne et se chauffe, en attendant la fin. J’y ai fait l’amour avec Nahoum et une de ses copines. C’est là aussi que j’ai appris à la radio, dans l’herbe, la fin du siège de Sarajevo. Je crois entendre sous l’oculus, qui s’ouvre comme un diaphragme, la pulsation de l’Empire qui lutte entre l’Orient et l’Occident. Mon œuvre double.
Nous sommes arrivés à Paris quand j’avais neuf ans. Rue Charles-Dickens, au dernier étage d’un immeuble sans ascenseur, avec des glaces blanches entourées de perles Louis XVI-1900. J’enverrai Nahoum filmer cette maison un jour prochain, afin d’expliquer aux enfants ces lieux qui ont été le théâtre de ma vie et que je n’ai plus la force d’aller leur montrer. C’est une des trois adresses où, pour ma « chambre-poubelle », j’enjoignais Charles de Noailles de trouver chaque matin un sac à ordures — il ne l’a pas fait lui-même très longtemps. Les deux autres adresses de mon formulaire mystérieux, affiché désormais au musée national d’Art moderne, sont la maison de mes premières amours, près des Halles, et la galerie de Manette dans l’île Saint-Louis. Mais tout commence, le ramassage des souvenirs comme l’autre, devant cette maison blanche que la fumée a noircie, dans ce quartier de Passy où les artistes ne viennent guère, mais qui fut mon château des brouillards, ma maison de petit garçon, mon rocher, ma cabane, la petite chambre où j’ai lu dans la fièvre mes premiers livres de poésie. Un loyer modeste, les derniers étages ne valaient rien, mais nous avions du mal à le payer. Ma mère a immédiatement trouvé de quoi nourrir toute la famille. Son mari, le colonel comte incapable, mon bon à rien de père, l’aida du point de vue logistique et détermina notre stratégie — un ou deux jours avant de mourir.
Ma mère était faite pour être lieutenant d’artillerie. Née et élevée pour être veuve. Elle ouvrit un cours de dessin pour jeunes filles du XVI earrondissement qui offrait toutes les garanties de moralité : un nom sonore et oriental, une dévotion affichée, à la croate, avec des chapelets et des bonnes Vierges partout, jamais de modèle nu bien sûr, seulement des fruits, des fleurs, des arbres et des branches, des draperies jetées sur des fauteuils en forme de robes d’archanges et les plumes de tous les saints du Paradis récupérées en faisant les poubelles du Jardin des Plantes. De la nature morte, du comestible. Ma mère en robe noire et en bijoux de jais trônait sur ce jardin d’Éden ; je jouais parmi les dessins chiffonnés et les boîtes de couleurs.
Le génie de ma mère fut de séduire deux vrais génies.
Bien différents : le peintre Maurice Lebourg, qui avait entrepris de rénover l’art sacré en mélangeant les symbolistes et les nabis, et le poète turc Mustapha Djerbi qui allait, quelques années plus tard, devenir la plus haute conscience intellectuelle de sa patrie et chanter la libération de la femme. Maurice faisait faire leur première communion à toutes ces demoiselles dans la chapelle de sa maison du prieuré à Meudon, Mustapha avait pris l’habitude de les dépuceler avant leurs dix-sept ans révolus. Celui qui croyait au voile et celui qui n’y croyait pas. Ils ne s’entendaient pas trop mal. J’ai des photos où ils sont tous les deux à boire de l’orangeade, avec les mêmes mocassins bicolores, sous un grand parasol blanc. L’un et l’autre se penchèrent sur moi et décidèrent de mon destin. À dix ans, j’apprenais à dessiner avec Maurice Lebourg et je me débrouillais mieux que ses autres élèves qui étaient tous bien plus âgés. Je n’ai compris que plus tard qu’il me surnotait et m’encourageait parce qu’il était, depuis le début, l’amant de ma chère mère. Il avait donc compris combien elle était vaniteuse et à quel point elle m’aimait. L’affirmation de mon génie était indispensable à la réussite de ses fins d’après-midi du samedi. Il venait me reconduire à la maison après les goûters du prieuré. Il était censé donner aussi à ma mère des cours de dessin, et il devait bien en effet se passer quelque chose de cet ordre-là, à un moment ou à un autre, puisqu’elle m’apprenait ensuite à distribuer les ombres et à construire des perspectives. J’assimilais ces bons trucs assez vite, mais les carnets que j’ai gardés, et que je ne montrerai jamais à la bourrique qui établit mon catalogue raisonné, ne laissent absolument pas prévoir l’éclosion du futur génie du XX eet du XXI e siècle. Encore des feuilles qu’il faut que je pense à détruire. J’hésite : si Virgile a besoin un jour de les vendre, s’il a mangé tout le reste, il y aura bien des gogos pour acheter ça. L’enfance d’un aigle.
Je souris en pensant aux deux petits lots que je fais attendre de l’autre côté de la porte et à l’étage : si elles savaient le dixième de tout ce que je résume ici. Il y a deux ans, une étudiante a essayé de creuser un peu cette époque, de regarder mes tableaux de jeunesse en cherchant ce qu’ils pouvaient avoir de commun avec le style de Maurice Lebourg. J’ai flairé le danger immédiatement : sur le moment, sa thèse aurait été jugée intéressante et nouvelle, et oubliée aussitôt. Mais ce genre de machines, ce sont des bombes à retardement. Cinquante ans plus tard, quand mes œuvres seront au creux de la vague, à moitié en réserve, à moitié en restauration, on ressortira ces quatre cents pages idiotes pour conclure que je me situais finalement dans la tradition des petits maîtres, que j’ai été une sorte de Maurice Lebourg monté en neige. J’ai reçu cette fille plusieurs jours. Grâce au ciel, je n’étais plus d’âge à coucher avec elle pour la réduire au silence. En regardant la verrue qu’elle avait au coin de la bouche, je lui ai offert un dessin. Elle sait ce que ça vaut. Elle ne l’a pas vendu. Il doit trôner encore dans son misérable salon à Belleville. Elle a changé son sujet et soutenu une thèse sur La Persistance de la référence à Michel-Ange dans la démarche créatrice du jeune Gossec. Tout le monde a été bien content. Parlez-moi de Michel-Ange, de Piero della Francesca, de Vermeer. Elle enseigne aujourd’hui à l’École du Louvre.
Ma coquille fut longue à se fendiller. Mon second parrain, Mustapha Djerbi, couchait de même, malgré son goût pour les très jeunes filles, avec ma vieille mère. Son dévouement, à lui aussi, était extrême. Je ne saurai jamais qui elle préférait, l’extase pieuse et ascétique des ouvroirs d’art sacré bénis par le Vatican ou la poésie grasse de la Corne d’Or nobélisable, Maurice ou Mustapha. La meilleure idée qu’eut jamais celui que j’appelais Moustache, pour mes quinze ans, fut de rédiger un recueil de contes en vers qu’il me demanda d’illustrer. Le contrat avec l’éditeur était mirobolant. C’était l’histoire d’une petite goutte d’eau qui naît dans une source, fricote avec un moulin et va se perdre dans la mer. Enchanteur. Universel. L’éditeur était sûr de vendre et j’ai appris à cette occasion comment on monte un coup. J’écoutais Mustapha discuter avec le vieux monsieur en nœud papillon bleu marine qui était l’éditeur et je me souviens encore de ma fascination. Tout avait l’air si simple. Je donnais toutes mes larmes pour ces quinze dessins, que le brave Maurice Lebourg acheva, corrigea, refit complètement. On ne dit rien à personne. Le livre ne parut pas. La France était en guerre. Ma vie d’artiste commençait mal. Je ne savais pas alors à quel point j’avais tout mon temps. Quatre-vingts années encore pour devenir un grand homme.
Читать дальше