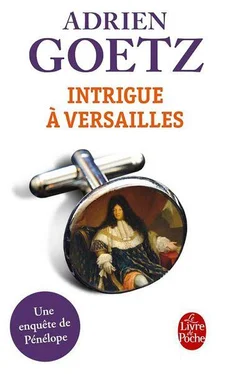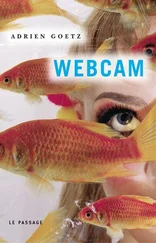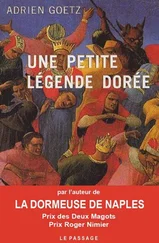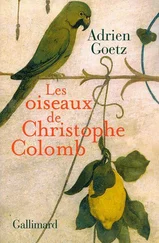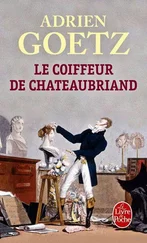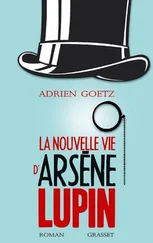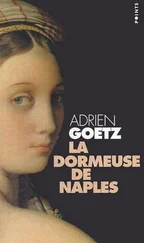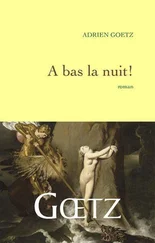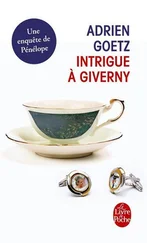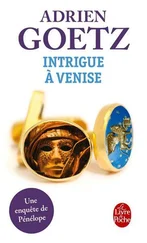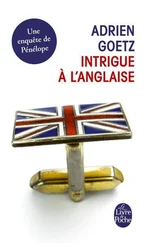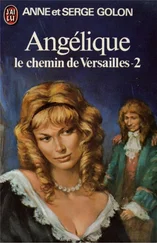En revanche, les historiens de Versailles et de Mansart désapprouveront sans doute l’interprétation qui est donnée à la fin de ce roman de l’architecture de l’Orangerie. Pour une explication canonique de ce grand chef-d’œuvre de l’architecture française, voir Bertrand Jestaz, Jules Hardouin-Mansart , Picard, 2008, vol. I, p. 231–237.
La perspective des jardins vus de la terrasse de l’Orangerie, telle qu’elle est décrite dans le chapitre «Où Wandrille renverse les perspectives», est reproduite notamment dans le texte célèbre, et teinté d’humour, d’un grand historien de l’art à qui rien n’échappait, Erwin Panofsky, Les Origines idéologiques de la Calandre Rolls Royce , dans Trois essais sur le style , traduction de Bernard Turle, Gallimard, Le Promeneur, 1996, p. 148.
Sur le carrosse du sacre de Charles X et le corbillard de Louis XVIII, voir Béatrix Saule, Visite du musée des Carrosses , Art Lys, 1997.
Sur les films tournés à Versailles, voir dans les actes du colloque organisé par Béatrix Saule, L’Histoire au Musée , Actes Sud-Château de Versailles, 2004, l’article d’Antoine de Baecque, «Versailles à l’écran, Sacha Guitry, historien de la France», p. 145–162.
Les prouesses de ceux qui sont ici appelés les Ingelfingen sont librement inspirées de l’histoire des Untergunther, un groupe d’action clandestin qui s’est donné pour but de restaurer à ses frais et dans le respect absolu des règles quelques éléments du patrimoine national. Ils s’introduisent clandestinement dans les monuments historiques là où ils estiment que l’État n’assure pas assez bien son devoir de sauvegarde. À l’occasion de leur restauration de l’horloge du Panthéon en 2007, Le Monde et Le Figaro se sont fait l’écho de leurs exploits. C’est de cette aventure, transposée en 1999, que s’inspire l’action des «Ingelfingen» — du nom d’une branche de la famille princière des Hohenlohe, qui n’a rien à voir avec tout cela.
Nancy Regalado, de même, n’est pas réalisatrice de films à Hollywood, mais professeur de littérature française à New York University. L’auteur lui demande pardon.
Quant au voyage secret des jansénistes vers la Chine, il est peut-être possible d’en trouver des échos dans le volume publié sans nom d’auteur par Simon Tyssot de Patot, Voyages et aventures de Jacques Massé , Jacques Kainus, Cologne [La Haye], 1710, dont une édition, malheureusement sans préface ni notes, a été procurée par les Éditions Amsterdam (Bibliothèque des Lumières radicales) en 2005. Le narrateur, lecteur de Pascal et d’Arnauld, familier de Descartes et du père Mersenne, s’embarque vers des terres lointaines et rencontre un Chinois. Sinon, il faudra se résoudre à voir dans cette histoire, comme pour les lectures de jeunesse du président Mao, un épisode imaginaire…
La meilleure description de la tempête de 1999 à Versailles se trouve dans le livre d’Alain Baraton, qui en a été témoin, Le Jardinier de Versailles , Grasset, 2006, p. 7–36.
Tous les passionnés de Versailles consultent le site Internet Connaissances de Versailles, que l’on trouve à l’adresse www.versailles.forumculture.net. On peut même jouer à y reconnaître, sous divers pseudonymes, tel célèbre conservateur ou tel grand jardinier, que démasque leur science des détails. Ce site mérite d’être recommandé chaleureusement.
L’Association des croqueurs de pommes, citée en passant dans le roman, existe bien. Didier Huet, jardinier, membre très actif de cette association vouée à la sauvegarde des variétés anciennes de fruits, intervient parfois pour des conférences dans la salle Champaigne des Petites Écoles de Port-Royal, le verger historique créé par Arnauld d’Andilly vers le milieu du XVII e siècle et reconstitué en 1999.
L’auteur a lu, après avoir écrit cette aventure de Pénélope, Le Désert de la Grâce de Claude Pujade-Renaud (Actes Sud, 2007), roman qui raconte la profanation du cimetière de Port-Royal et le très distrayant Meurtre à la française d’Alain Germain (Éditions du Masque, 2006), dont l’action se déroule à Versailles au lendemain de la tempête de 1999. Sur deux sujets proches du sien, ces deux auteurs ont inventé des intrigues qui n’offrent aucun rapport avec celle qu’on vient de lire, ce qui n’a rien de surprenant, mais a tout de même été, sur le moment, une rassurante constatation.
En 1999, Versailles avait des conservateurs, des jardiniers, des membres du personnel de surveillance et des guides conférenciers, Port-Royal-des-Champs était un musée en pleine expansion. Comme dans le volume précédent des «Enquêtes de Pénélope», Intrigue à l’anglaise , l’auteur tient à affirmer clairement que ceux qui, cette année-là, occupaient des fonctions qui sont celles de ses personnages, n’ont rien à voir avec ces derniers. Si certains ont pu inspirer telle ou telle scène, tel ou tel trait, le résultat est, à l’évidence, de pure fiction.
Si tout ce qui relève de la sécurité du château est volontairement très vraisemblable, certains éléments ont été transformés ou empruntés à d’autres palais nationaux ou musées, afin de ne pas perturber le travail de ceux qui, dans la réalité, assurent la garde de Versailles.
Dans un ordre alphabétique qui abolit joyeusement tout protocole versaillais, figurent ici ceux qui, par leurs conseils, leur conversation ou leurs écrits ont — parfois malgré eux — contribué à telle ou telle scène et méritent d’être vivement remerciés, même s’ils n’approuvent pas tout ce qui est dit de Versailles dans ce roman. Tous sont de grands défenseurs du château:
Jean-Jacques Aillagon, Benedikte Andersson, Pierre Arizzoli-Clémentel, Pierre Bonnaure, Violaine et Vincent Bouvet, Laurence Castany de Bussac, Guillaume Cerruti, Jean-Christophe Claude, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Sylvain Cordier, Michel Delon, Béatrice de Durfort, Côme Fabre, Christine Flon, Dominique de Font-Réaulx, Bruno Foucart, Élisabeth et Cyrille Goetz, Christine et Jean Gouzi, Michaël Grosmann, Valérie Guillot, Valentine et Markus Hansen, Nicolas Henry-Stoltz, Nicolas Idier, Pierre Jacky, Dominique Jacquot, Helena et Martin Jahan de Lestang, Olivier Josse, Karen Knorr, Jacques Lamas, Laurent Le Bon, Frédéric Lecointre, Marjorie Lecointre, Ariane de Lestrange, Philippe Luez, Antonin Macé de Lépinay, Raphaël Masson, Jean-Christophe Mikhaïloff, Nadège et Hélie de Noailles, Christophe Parant, Valérie et Jérôme Pécresse, Alexandre Pradère, Nicolas Provoyeur, Jean-François Quemin, Aude Révillon d’Apreval, François Reynaert, Laurella et Bruno Roger-Vasselin, Bertrand Rondot, Brigitte et Gérald de Roquemaurel, Philippe Sage, Béatrix Saule, Thierry Serfaty, Jean-Hugues Simon-Michel, Anne-Louise et Jacques Taddei, Jean-Yves Tadié, Farid Tali, Simon Thisse, Sara Wilson.
* * *
Au moment de fermer ce livre, une figure ne peut s’effacer de mon esprit. C’est un profil dessiné «au physionotrace», procédé du XVIII e siècle qui garantissait une grande ressemblance, avant l’invention du portrait-carte photographique. Il est accroché devant moi, dans un cadre en bois doré un peu mal en point. Rien d’inquiétant en apparence dans le visage grave de Louis-Adrien Le Paige, avocat au Parlement de Paris et bailli du Temple, né sous Louis XIV en 1712, mort sous Bonaparte en 1802. Tout ce qui est dit de lui dans ces pages est réel. Il n’a pas encore trouvé son biographe.
Puissent son esprit, là où il se trouve, et son âme peut-être, trouver enfin la paix et le repos. Ce roman est dédié, avec piété, à la mémoire méticuleuse et agitée de ce mémorialiste des convulsions.
Читать дальше