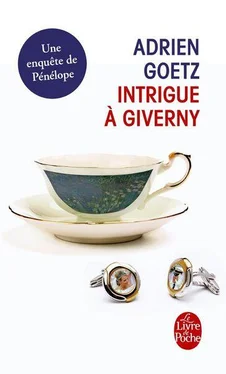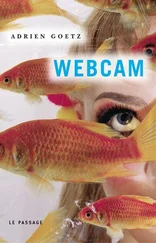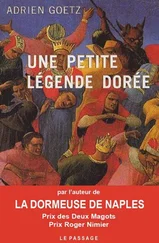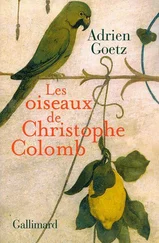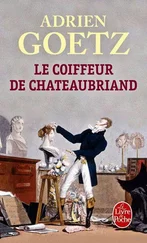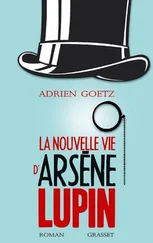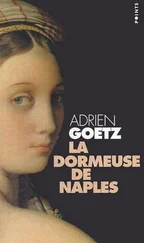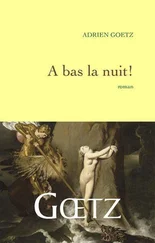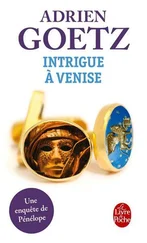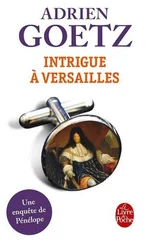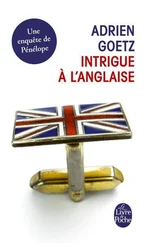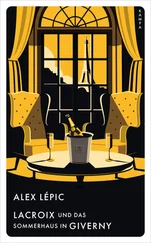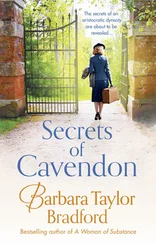— Monet avec des minets ? Tu divagues, il n’aimait que les femmes…
— Mais la Pépinière c’était peut-être un établissement discret où il y avait des femmes et des hommes, c’était le quartier des maisons closes, vers Saint-Lazare, avec les petites bécassines qui arrivaient toutes fraîches des provinces de l’Ouest…
— Avant de salir mon cher Monet, trouve-moi un début de preuve ! Je te défends de continuer sur ce sujet.
— Que tu es moralisatrice, “salir” ! Je dis qu’il allait s’amuser là-bas ! Tu deviens puritaine ? Tu veux du poivre ? C’est du Malabar moulu, premier choix. Si tu veux que je te trouve une preuve, je vais devoir continuer mon enquête dans cette direction.
— Je t’interdis. Je l’aime. Je te plaque pour lui. Mon fiancé, c’est Claude Monet ! »
INTERMÈDE
Soleil levant
Paris, 25 avril 1874
_______
Claude Monet rentre content, avec Le Charivari sous le bras. Ce critique, ce Louis Leroy, quel génie ! Il vient de lui rendre le plus grand des services : il l’a éreinté. Il sifflote sur les boulevards, main dans les poches, heureux.
C’est son meilleur tableau qu’il a pris en exemple pour tourner en ridicule leur exposition. En plus son papier est très drôle. Il met en scène deux personnages, lui-même et un certain père Vincent, paysagiste à l’ancienne mode, qui devient fou en regardant sa vue du port du Havre, celle qu’il a titrée à la dernière minute, parce qu’il ne savait pas quoi écrire dans le petit catalogue, Impression, soleil levant .
Tout a commencé avec Frédéric Bazille, l’ami généreux, affectueux, passionné, attentif, Alfred Sisley, Pierre Auguste Renoir. Puis il y a eu la rencontre avec Pissarro, puis cet étrange ami misanthrope et élégant, Degas. Ils ne s’aimaient pas tant que ça, mais ils avaient décidé de faire parler d’eux — et surtout ils méprisaient les vieux maîtres, avec leurs vues du paradis terrestre fabriquées avec des palmiers en zinc et des ciels comme des ciels de lit en soie bleue, on en avait assez vu.
Ils avaient compris que les paysagistes de la forêt aux environs de Barbizon avaient réussi parce que c’était une petite troupe d’artistes, que le public regardait comme un tout. Mais ils n’étaient pas allés assez loin, ces braves fabricants de sous-bois, cette petite famille de gardes-champêtres, il fallait montrer la vraie vie, les jardins, les maisons, les boulevards. Il fallait marcher ensemble, mais à Paris d’abord. Montrer aux Parisiens les paysages accessibles par le chemin de fer, du port du Havre à la campagne aixoise — la spécialité d’un autre misanthrope, qui avait été au collège avec Zola, Paul Cézanne.
Au groupe il manquait un local et un nom. L’atelier de Nadar boulevard des Capucines pourrait bien leur fournir l’un et l’autre : on s’appellerait « la Capucine » ce serait poétique et étrange. Degas aimait bien. Un nom de fleur, Monet n’a rien contre, il aime les couleurs des capucines.
Monet peint vite. Il lance des couleurs sur la toile, rattrape au vol des coulées de peinture, il n’a pas d’argent pour acheter autant de toiles qu’il voudrait, sinon il en couvrirait des mètres !
Du 15 avril au 15 mai, l’exposition n’allait peut-être pas attirer grand monde, on avait bouclé à la hâte. Monet avait improvisé : cette rade bleue avec une petite barque ne pouvait décidément pas s’appeler « Vue du port du Havre ». Il avait inscrit le premier mot qui lui était venu : Impression . Corot intitulait ses derniers tableaux « Souvenirs », pour montrer qu’il ne représentait pas un paysage réel. « Impression » ce serait un peu la même chose : un paysage peint devant la réalité, mais qui serait une interprétation personnelle, pas grâce au souvenir, mais plutôt à travers le filtre de ses sensations personnelles. Les étangs de Corot, la surface de l’eau au Havre, c’est cela le souvenir, une autre réalité qui est faite de reflets. Le vieux Gleyre disait qu’il fallait avoir un style, et ne pas regarder les choses telles qu’elles sont, lui il regarderait tout, mais imprimerait sa vision. D’où ce mot, simple et presque banal… Les autres s’intituleraient de la manière la plus simple : Déjeuner, Coquelicots, Boulevard des Capucines .
Grâce à ce Leroy, le nom était trouvé. Ils n’avaient pas grand-chose en commun. Beaucoup de paysagistes ne faisaient pas de bien grands efforts de nouveauté, tant pis, ils seraient « les impressionnistes » — et Monet devenait, par ce tour de passepasse imprévu, le parrain du mouvement. Un jour il serait riche, célèbre, adulé par les femmes, ami des ministres et des princes, et il s’en ficherait complètement. Il aura un jardin avec des roses, des capucines et des tulipes. Il pourra envoyer tout le monde promener. Ce Louis Leroy, ils auraient dû le payer !
Le soleil se levait.
_______
TROISIÈME PARTIE
Le Nautilus du capitaine Monet
« Peu à peu, la brume se dissipa sous l’action des rayons solaires. L’astre radieux débordait de l’horizon oriental. J’admirais donc ce joyeux lever de soleil, si gai, si vivifiant, lorsque j’entendis quelqu’un monter vers la plate-forme. Je me préparais à saluer le capitaine Nemo… »
JULES VERNE,
Vingt Mille Lieues sous les mers , 1869
1
Vernochet vole, les carabiniers arrivent trop tard
Maître Vernochet vole vers Monaco. L’hôtesse, à bord, l’a reconnu. Elle le voit à la télévision. Elle a repéré tout de suite son pantalon de velours orange et sa veste verte à carreaux bleus, ses grosses lunettes d’écaille.
Elle le dévore des yeux. Elle n’a pas encore lu son dernier livre, Comme un marteau sans maître, mémoires d’un commissaire-priseur , mais c’est décidé, elle va se l’offrir. Elle aurait tant aimé faire l’École du Louvre. Visiter les expositions avec un homme comme lui, ce doit être passionnant. Il n’a pas d’alliance. Elle rêve. Vivre avec maître Vernochet, entre Monaco et Gstaad, la grande vie.
Il doit connaître une foule de gens intéressants, entrer dans les collections les plus secrètes, celles qu’il nous révèle parfois le samedi après-midi sur France 3. Il a sorti son ordinateur, mis un casque — quelle musique un homme comme lui peut-il bien écouter ? Des raretés classiques, c’est sûr, des live de concerts privés des Stones, du Chopin, il a l’air si romantique — et il a transformé sa tablette en bureau. Il y a devant lui deux gros carnets, son agenda, plein de photos découpées, il doit travailler tout le temps. Il a un gros catalogue sur les genoux, elle jette un coup d’œil : « Musée océanographique de Monaco ». Que va-t-il faire à Monaco ? On entend souvent parler de grandes ventes en principauté… Il a comme un air de gourmandise au coin des lèvres, comme un homme qui va réussir une belle affaire… Ou alors il est invité pour le mariage. Il va rencontrer Charlène et Albert, et Caroline, et Stéphanie peut-être. Elle n’osera pas le lui demander. Ah, si le vol était plus long, avec un déjeuner, elle engagerait la conversation en lui disant : « Viande ou poisson ? », ou peut-être même : « Et pour vous, maître, viande ou poisson ? » Elle le regarde. Elle le trouve beau, avec ses cheveux blancs impeccables. Un bel homme de soixante ans, un peu plus peut-être, avec ce sourire chaleureux, protecteur. C’est quelqu’un comme lui qu’elle aimerait avoir dans sa vie.
Il a l’air agité, pas tranquille, il regarde sa montre, une jolie montre ancienne en or. Il fait des calculs sur son téléphone, note des chiffres au crayon dans un joli petit carnet en cuir qu’il a sorti de sa poche. Elle va juste s’arranger pour quitter rapidement la cabine à l’atterrissage, pour voir qui l’attend à Nice. Il n’a qu’un bagage à main, une petite valise à roulettes de Vuitton, en toile damier anthracite, ce qu’on fait de plus discret — il a dû réserver la navette d’hélicoptère pour Monte-Carlo, ou alors il y aura un hélicoptère envoyé par le palais princier, pour lui tout seul…
Читать дальше