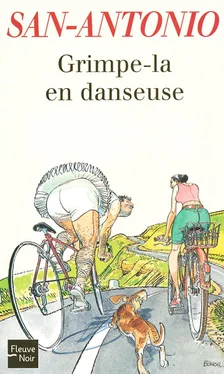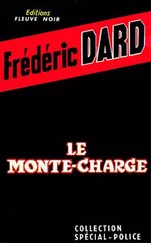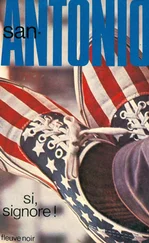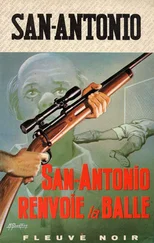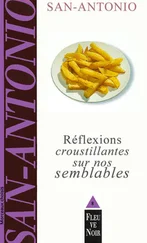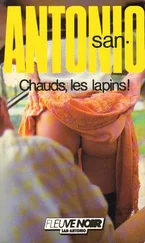La personne d’à côté se nomme Troussot-Déclez.
Elle répond sans tarder à mon coup de sonnette.
— Monsieur ? s’enquiert-elle avec son bel accent qui ne sera jamais napolitain, quand bien même tu le recouvrirais de sauce tomate.
— Mes respects, dis-je. Je viens récupérer mon chien…
Par une enculade de portes ouvertes, je l’avise en train de gloutonner un reste de gratin inidentifiable vu d’ici.
La dabuche est une personne si gentille que j’en chierais dans sa culotte !
— Pardonnez-moi, fait-elle, mais ce pauvre animal semblait si exténué, si affamé… Vous boirez bien une tasse de café avec moi pendant qu’il se restaure ?
— Volontiers ! accepté-je.
Et si tu savais comme j’ai raison !
C’est une personne bien agréable, Mme Troussot-Déclez. Le genre d’octogénaire (et mèche) proprette, aimable, contente d’être encore de ce monde, toujours prête à rendre service à ses semblables, surtout quand ils ne lui demandent rien.
Elle volubilise dans sa cuisine-salle à manger où trône une photo-portrait, retouchée au crayon, de feu son mari. Il l’a quittée y a lulure, Emile, mais il semblait déjà gâteux (le con sert tôt en sol mineur, qu’on disait à la communale, inoubliable). Sa dame s’est engagée dans le veuvage, comme d’autres à Médecins Sans Frontières. Elle trottine entre un vieux passé vermoulu et un futur dont tu ne donnerais pas trois balles.
Me raconte qu’elle est née dans la maison où nous sommes. Elle y a eu ses premières règles, ses premières amours, ses premiers défunts.
Ensuite, ça s’est mis à fonctionner tout seul. La vie, quand elle a pris ses marques, t’as plus qu’à la laisser faire. Tout se met en place, s’agence, naît, croît, disparaît au rythme convenable. Les Quatre Saisons de Vivaldi !
Moi, ni une ni l’autre, je la branche sur la demeure voisine !
Alors là, changement à vue. Elle devient grave, voire soucieuse, se signe, regarde la pendule de Brel, qui dit oui, qui dit non…
J’attends. Ne jamais brusquer une femme âgée. Les cols du fémur volent bas à cet âge-là.
Elle soupire :
— Ah ! monsieur, vous mettez le doigt sur un sujet douloureux.
M’abstiens de rétorquer qu’il vaut mieux le mettre là que dans sa minouche mitée.
Je la file en aiguille, l’ancêtre. J’y vais aux questions innocentes, donc insidieuses. Cette situation a-t-elle toujours existé ?
— Non, non, mon « pauvre » monsieur, ça remonte à une bonne vingtaine d’années, Astrid Degueulmann était petite fille. Je vous parle de cette enfant parce que c’est en sa présence que tout a débuté.
« Un matin, sa mère se trouvait au marché. Il s’est produit un grand bruit, comme au cours d’un bombardement, le sol vibrait, les murs tremblaient. On eût dit que la villa “Look” allait s’écrouler. La fillette est sortie en hurlant ; je l’ai rattrapée et amenée chez moi. La police est venue, les pompiers aussi. Ils ont visité la maison, tout exploré de fond en comble et n’ont rien détecté d’anormal. On a conclu a une légère secousse tellurique. Et la chose a été oubliée.
« Mais voilà que, quelques mois plus tard, un phénomène de ce genre se reproduit. Nouvelles visites techniques. Ils ont pratiqué des sondages, mais “woatt !”. Sans obtenir le plus léger résultat. L’existence s’est organisée avec ces manifestations étranges, rarement les mêmes. Les bruits diffèrent, la violence aussi. Parfois, beaucoup de temps s’écoulait entre deux vacarmes avant qu’ils deviennent quotidiens. Ils n’ont jamais causé d’accident. Si je vous disais qu’on en prend l’habitude. »
Elle se tait, me sourit gentiment.
Puis, j’ignore pourquoi, me déclare tout de go :
— Je me prénomme Gwendoline ; ma mère était irlandaise.
Brave chérie, va ! Elle sent la violette.
— Vous pouvez me parler de vos voisins Degueulmann ? demandé-je.
Mémère esquisse une moue qui, sans être dubitative, manque toutefois d’enthousiasme.
— Il n’y a qu’Astrid de sympathique dans ce lot de femmes. La grand-mère Mina était franchement mauvaise, toujours à dire du mal de tout le monde ; quant à Blanche, la mère d’Astrid, elle ne valait guère mieux. Le genre geignarde. Elle rendait la terre entière responsable de ses problèmes.
— Elle ne vivait pas avec son époux ?
— Très peu : quelques mois l’hiver, à Bruxelles. Puis elle a fini par résider complètement à Ostende. Il faut dire que la ville est prenante ; pour rien au monde je ne voudrais habiter ailleurs.
— Pendant l’occupation allemande, qui demeurait dans leur maison ?
Elle réfléchit :
— Mais… Mina, avec Siméon, son époux. On le déplaçait en chaise roulante parce qu’il était devenu hémiplégique à la suite d’un accident. Il est mort avant la fin de la guerre. Un homme bizarre, un peu rustre. Maçon de son état.
Elle demande qu’à jacter, ma brave perruche. Les interlocuteurs ne doivent pas se bousculer à son portillon ; plus tu as de souvenirs à raconter, moins tu trouves de gens pour les écouter. Ce morninge, je constitue son aubaine.
Salami a torché sa gamezoule et pourlèche des babines en nous écoutant d’une longue oreille distraite.
La maison de la mémé renifle comme dans les bouquins de Simenon : la bouffe et l’encaustique.
Je lui souris, ce qui la comble.
— Dites-moi, madame Gwendoline, ça s’est passé comment, la guerre, par ici ?
Elle sourcille et réfléchit.
— Ç’a été dur : nous étions en plein dans la zone de défense des Allemands. Il ne fallait pas broncher.
— Dans les débuts, vous n’avez pas remarqué un changement d’habitudes chez votre voisine Mina ? Mettons en quarante et un ?
Le front de mémé bandonéone.
— Je ne me souviens pas.
— Autre chose, chère amie irlando-flamande : les Degueulmann ont-ils procédé à des travaux dans leur maison ?
Elle opine presque aussitôt.
— C’est tout à fait exact. Juste avant son accident, Siméon a construit un conduit de ventilation pour sa cheminée qui tirait mal. Il l’a dressé en quarante-huit heures, et tout seul, sans même l’aide d’un de ses compagnons.
Tout à coup, ma question l’intrigue :
— Pourquoi me demandez-vous cela ?
— J’enquête sur les bruits insolites du quartier, fais-je, et j’amasse le plus de renseignements possible sur le pavillon d’à côté.
Je me lève, alourdi par le pollen que je viens de butiner.
— J’ai pris un grand plaisir à votre conversation, assuré-je-t-il, sincère. Dans le cas où il vous reviendrait en mémoire quelques détails susceptibles de m’intéresser, soyez gentille de me prévenir : je suis au Miramar , M. San-Antonio.
* * *
Ma conviction de retrouver Béru à l’hôtel est tellement ancrée dans ma tronche que je suis anéanti quand le personnel m’affirme ne pas l’avoir vu de la matinée.
Sa disparition m’avait troublé, mais pas terriblement inquiété. D’esprit cartésien, comme tous les gens de ma race, je conservais la certitude qu’il y avait « un truc ». Qu’une explication rationnelle me surviendrait en moins de jouge.
Mon accablement de la veille me rebiche. Afin de ne pas naufrager dans mes angoisses et autres redoutances, je compose le numéro de Mathias à la Grande Cabane.
C’est lui qui me répond.
— J’allais t’appeler pour te donner de nos nouvelles, me déclare le Feu-de-brousse. Tout s’est passé normalement.
— Vos passagers ?
— Bien rangés et étiquetés sous chiffre dans la morgue de la maison mère. De votre côté, quid novi ?
Читать дальше