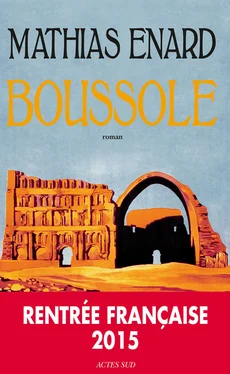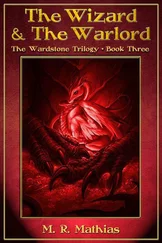Je suis arrivé à l’heure convenue, vers 20 heures, après avoir marché un quart d’heure dans la neige parce que la Paykan du taxi patinait et refusait de monter plus haut. Je parviens au portail, je sonne, j’attends, je sonne à nouveau : rien. Je décide donc de profiter de l’occasion pour faire un petit tour dans la nuit glacée, surtout, je dois l’avouer, parce que rester immobile signifiait m’exposer à une mort certaine. Je déambule quelques minutes au hasard et, repassant devant la demeure, je croise l’employée de maison qui en sort : je me précipite, l’interroge, et elle me dit :
— Ah, c’est vous qui avez sonné. Monsieur joue de la musique avec ses amis, et il ne répond jamais quand il joue.
Sans doute parce que le salon de musique est de l’autre côté de la villa et qu’on n’y entend pas la sonnette. Bien bien bien. Je me précipite à l’intérieur et m’avance dans le vestibule aux imposantes colonnes doriques, aux éclairages classiques comme la musique qui y parvient, clavecin, flûte, Couperin ? Je traverse le grand salon en prenant bien soin de ne pas marcher sur les tapis précieux. Je me demande si je dois attendre là, et tu me connais, je suis plutôt poli, j’attends donc, debout, une pause pour entrer dans le salon de musique, comme au Musikverein. J’ai le temps de bien regarder les tableaux, les sculptures d’éphèbes en bronze et, horreur ! les traces de boue neigeuse qu’ont laissées partout sur le marbre mes chaussures mal essuyées. Honte. Un Teuton débarque dans ce havre de beauté. On suivait très bien mon parcours hésitant qui faisait le tour des tapis, allait d’une statue à l’autre. Honte plus grande encore. Qu’à cela ne tienne : j’avise une boîte nacrée qui a l’air de contenir des mouchoirs, je m’en saisis, espérant que la sonate dure suffisamment longtemps pour que j’aie le temps de ma basse besogne, je m’agenouille la boîte à la main et j’entends :
— Ah, vous êtes là ? Que faites-vous donc, vous voulez jouer aux billes ? Mais entrez, voyons, entrez.
Effectivement, la boîte contenait des billes de porcelaine, ne me demande pas comment j’ai pu la confondre avec une boîte de mouchoirs, je ne saurais pas répondre : l’émotion esthétique sans doute, on se dit que dans un tel décor une boîte de kleenex ne peut qu’être nacrée. Ridicule, je me suis ridiculisé, me voilà soupçonné de vouloir jouer aux billes sur le tapis pendant qu’on fait de la grande musique. Un béotien. Le musicologue autrichien joue aux billes sur les tapis d’Orient plutôt que d’écouter Couperin.
Je soupire, repose précieusement la boîte et suis le conseiller vers le salon de musique susdit : un canapé, deux fauteuils, quelques tableaux orientalistes, d’autres sculptures, une épinette, les musiciens (le claveciniste conseiller, un flûtiste iranien) et le public, un jeune homme avec un sourire très sympathique.
— Je vous présente : Mirza, Abbas. Franz Ritter, musicologue autrichien, élève de Jean During.
Nous nous serrons la main ; je m’assois, et ils se remettent à jouer, ce qui me laisse le temps d’oublier un moment ma honte et de rire de moi-même. Le conseiller chantonnait un peu en jouant, les yeux fermés pour se concentrer. Une belle musique, ma foi, vibrante profondeur de la flûte, fragile cristal du clavecin.
Au bout de cinq minutes, ils achèvent le morceau, j’applaudis. Le conseiller se lève :
— Bon, il est temps de se mettre à cette fondue. Par ici, les gourmets.
Ah oui, j’ai omis de te préciser que j’étais invité pour une fondue savoyarde, mets suffisamment rare à Téhéran pour qu’on ne rate pas l’occasion. Quand le conseiller me l’avait proposé, j’avais répondu :
— Une fondue ? Je n’en ai jamais mangé.
— Jamais ? Il n’y a pas de fondue en Autriche ? Eh bien, c’est l’occasion de vous initier. C’est bien meilleur que la raclette, même suisse. Plus raffiné. Oui, plus raffiné. Et avec cette neige, c’est le plat idéal.
Le conseiller culturel s’intéresse à tous les arts, y compris la cuisine.
Donc, nous voilà partis tous les quatre à l’office. Je pensais arriver, malgré les précautions du conseiller et sa fortune du pot, dans un dîner un peu snob avec grands et petits plats servis à table, et je me retrouve un tablier sur les hanches, “à la bonne franquette”, comme vous dites.
Il m’incombe la tâche de couper le pain. Bien. Je coupe, sous la surveillance du chef, qui contrôle la taille de mes morceaux. Le chef est Mirza, aussi président du Club des gourmets dont j’apprends qu’il se réunit une fois par semaine chez le conseiller.
— La semaine dernière, oh, des cailles, des cailles sublimes, me raconte-t-il. Succulent. Bien sûr, ce soir c’est la simplicité, rien à voir. Fondue, charcuterie, vin blanc. Toute l’originalité réside dans le pain iranien et les sabzi , évidemment. On va se régaler.
Le conseiller observe ses convives s’affairer avec un air ravi, il aime l’animation dans sa cuisine, on le sent. Il tranche délicatement le jambon et la rosette, en dispose les rondelles sur un grand plat de faïence iranienne bleue. Je n’ai pas mangé de cochon depuis des mois, et j’ai l’impression d’une transgression extraordinaire. Nous mettons le couvert, discutons en finissant les apéritifs, et il est temps de passer à table. On sort les piques, prépare les sabzi qui donnent, avec le sangak , un air multiculturel à ce dîner païen. Et là le conseiller s’exclame, d’un air très peu diplomatique :
— Bon, strip-fondue, celui qui perd son morceau de pain enlève sa chemise. Et il part d’un grand éclat de rire, qui lui fait lever les yeux au ciel en secouant la tête de droite à gauche. Choqué, je m’accroche à ma pique.
On sert le vin, délicieux d’ailleurs, un graves blanc. Mirza inaugure, plonge son pain dans le fromage fondu, et le ressort sans encombre, en tirant de petits filaments. J’essaye à mon tour : il faut reconnaître que c’est excellent.
La conversation tourne autour du vin.
Le conseiller lance, avec un air satisfait :
— Je vous annonce que je suis maintenant actionnaire dans les côtes-du-rhône. Oui mes chers amis.
Je peux lire l’envie sur le visage des deux autres sybarites.
— Ah, c’est bien, ça. Ils hochent la tête de concert. Les côtes-du-rhône !
Ils parlent pèse-moûts, cuves et fermentation. Je suis plutôt occupé à me battre avec la fondue, dont je m’aperçois que, lorsqu’elle refroidit, ce n’est pas du gâteau, si tu me passes l’expression, surtout avec un morceau de pain iranien, car mou et perméable, et donc ne supportant pas une immersion prolongée dans le jus tiède sans se désagréger dangereusement. J’ai failli à plusieurs reprises y laisser ma chemise.
Bref, je n’ai pas beaucoup mangé.
Enfin, la fondue se termine sans incident, personne ne perdant autre chose que ses illusions dans la marmite. Viennent dessert, café, digestif et discours sur l’art, précisément dans l’ordre marrons glacés de Provence, expresso italien, cognac, et “le fond et la forme”. Je bois les paroles du conseiller, qui passent toutes seules avec le cognac VSOP :
— Je suis un esthète, dit-il. L’esthétique est dans toute chose. Parfois, même la forme fait sens, au fond.
— Ce qui nous ramène à la fondue, dis-je.
Je reçois un regard noir des deux esthètes adjoints, mais le conseiller, qui a de l’humour, fait un petit hoquet nerveux, hoho, avant de reprendre, l’air inspiré :
Читать дальше