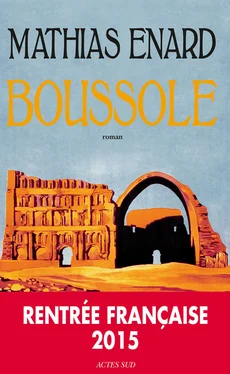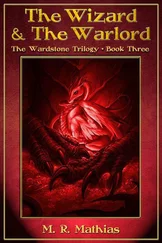Il zigzaguait sur l’autoroute, pied au plancher, doublait par la droite, klaxonnait, tout en secouant son cerceau comme un damné ; il se tournait pour me regarder et la vieille Paykan profitait de sa distraction pour dériver dangereusement vers la gauche.
“Vous êtes musulman ?
— Non, chrétien.
— Moi je suis musulman, mais j’aime beaucoup les putes. Celle d’hier, elle voulait vingt dollars.
— Ah.
— Vous trouvez ça cher aussi ? Ici, elles sont putes parce qu’elles ont besoin d’argent. C’est triste. Ce n’est pas comme en Europe.
— En Europe ce n’est pas très gai non plus, remarquez.
— En Europe elles y prennent du plaisir. Ici non.”
Je l’ai lâchement laissé à ses certitudes. Le vieillard s’est interrompu un moment pour passer en contrebande entre un autobus et un énorme 4×4 japonais. Sur les plates-bandes, au bord de l’autoroute, des jardiniers taillaient les rosiers.
“Vingt dollars c’était trop cher. J’ai dit « Fais-moi un prix ! J’ai l’âge d’être ton grand-père ! »
— Ah.
— Je sais m’y prendre, avec les putes.”
En arrivant à l’institut j’ai raconté cette histoire extraordinaire à Sarah, qu’elle n’a pas fait rire du tout, et à Faugier, qui l’a trouvée hilarante. C’était peu de temps avant qu’il soit agressé par des Bassijis ; il avait pris quelques coups de trique, sans que le motif de l’algarade ne soit réellement clair — attentat politique visant la France ou “simple affaire de mœurs”, on n’en savait pas plus. Faugier soignait ses bleus par le rire et l’opium, et s’il se refusait à entrer dans les détails de l’affrontement, il répétait à qui voulait l’entendre que “la sociologie était vraiment un sport de combat”. Il me faisait penser au Lyautey du récit de Morgan — il refusait de prendre acte de la violence dont il avait été l’objet. Nous savions que l’Iran pouvait être un pays potentiellement dangereux, où les sbires du pouvoir, officiels ou occultes, s’embarrassaient de peu de gants, mais nous pensions tous être protégés par nos nationalités et nos statuts d’universitaires — nous nous trompions. Les remous internes au pouvoir iranien pouvaient bien nous atteindre, sans que l’on sache réellement pourquoi. Le principal intéressé ne s’y trompait pourtant pas : ses recherches étaient ses mœurs, ses mœurs participaient de ses recherches, et le danger était une des raisons pour lesquelles ces sujets l’attiraient. Il soutenait qu’on avait plus de chances de prendre un coup de couteau dans un bar louche à Istanbul qu’à Téhéran, et il avait sans doute raison. De toute façon son séjour en Iran touchait à sa fin (au grand soulagement de l’ambassade de France) ; cette trempe, cette raclée, disait-il, sonnait comme un sinistre chant de départ et ses ecchymoses un cadeau en souvenir de la République islamique. Les goûts de Faugier, sa passion du trouble, ne l’empêchaient pas d’être terriblement lucide sur sa condition — il était son propre objet d’études ; il admettait que, comme beaucoup d’orientalistes et de diplomates qui ne l’avouent pas facilement, s’il avait choisi l’Est, la Turquie et l’Iran, c’était par désir érotique du corps oriental, une image de lascivité, de permissivité qui le fascinait depuis l’adolescence. Il rêvait aux muscles d’hommes huilés dans les gymnases traditionnels, aux voiles de danseuses parfumées, aux regards — masculins et féminins — rehaussés de khôl, aux brumes de hammams où tous les phantasmes devenaient réalité. Il s’imaginait en explorateur du désir, et il l’était devenu. Cette image orientaliste de l’almée et de l’éphèbe, il en avait fouillé la réalité, et cette réalité l’avait passionné au point de se substituer à son songe initial ; il aimait ses vieilles danseuses prostituées, ses entraîneuses des cabarets sinistres d’Istanbul ; il aimait ses travestis iraniens outrageusement maquillés, ses rencontres furtives au fond d’un parc de Téhéran. Tant pis si les bains turcs étaient parfois sordides et crasseux, tant pis si les joues mal rasées des éphèbes grattaient comme des étrilles, il avait toujours la passion de l’exploration — de la jouissance et de l’exploration, ajoutait Sarah, à qui il avait fait lire son “journal de terrain”, comme il disait : l’idée que Sarah puisse se plonger dans une pareille lecture m’était bien évidemment odieuse, j’étais atrocement jaloux de cette relation étrange, par journal interposé. Même si je savais que Sarah n’avait aucune attirance pour Faugier, ni Marc pour elle, imaginer que Sarah puisse ainsi percevoir son intimité, les détails de sa vie scientifique qui en ce cas précis correspondaient à ceux de sa vie sexuelle m’était insupportable. Je voyais Sarah à la place de Louise Colet lisant le journal d’Égypte de Flaubert.
“Almées — ciel bleu — les femmes sont assises devant leurs portes — sur des nattes de palmier ou debout — les maquerelles sont avec elles — vêtements clairs, les uns par-dessus les autres qui flottent au vent chaud.”
Ou, bien pire.
“Je descends avec Sophia Zoughaira — très corrompue, remuant, jouissant, petite tigresse. Je macule le divan.
Second coup avec Kutchuk — je sentais en l’embrassant à l’épaule son collier rond sous mes dents — son con me polluait comme avec des bourrelets de velours — je me suis senti féroce.”
Et ainsi de suite, toute la perversion dont les orientalistes sont capables. Penser à Sarah en train de savourer la prose (infâme, cela va sans dire) de ce bellâtre érotomane dont j’étais certain qu’il était capable d’écrire une horreur du genre son con me polluait était une pure torture. Comment Flaubert a-t-il pu infliger ce supplice à Louise Colet, c’est incompréhensible ; il fallait que le styliste normand soit bien persuadé de son génie. Ou peut-être pensait-il, comme Faugier au fond, que ces notes étaient innocentes , que l’obscénité qui s’y mettait en scène n’était pas du domaine du réel, mais d’un autre ordre, de la science ou du voyage, une enquête qui éloignait ces considérations pornographiques de son être, de sa propre chair : lorsque Flaubert écrit “coup, recoup plein de tendresse”, ou “sa motte plus chaude que son ventre me chauffait comme avec un fer”, quand il raconte comment, une fois Kutchuk endormie dans ses bras, il joue à écraser des punaises sur le mur, punaises dont l’odeur se mêle au santal du parfum de la jeune femme (le sang noir des insectes dessine de jolis traits sur la chaux), Flaubert est persuadé que ces observations suscitent l’intérêt, et non le dégoût : il s’étonne que Louise Colet soit horrifiée par ce passage sur la ville d’Esna. Il cherche à se justifier dans une lettre au moins aussi atroce : “En entrant à Jaffa, raconte-t-il, je humais en même temps l’odeur des citronniers et celle des cadavres.” Pour lui, l’horreur est partout ; elle se mêle à la beauté ; la beauté et le plaisir ne seraient rien sans la laideur et la douleur, il faut les ressentir ensemble. (Louise Colet sera à ce point frappée par ce manuscrit qu’elle se rendra elle aussi en Égypte, dix-huit ans plus tard, en 1869, à l’occasion des cérémonies de l’inauguration du canal de Suez, alors que toute l’Europe se presse au bord du Nil — elle verra les almées et leurs danses, qu’elle trouvera vulgaires ; elle sera choquée par deux Allemands à ce point hypnotisés par les grelots de leurs colliers qu’ils disparaîtront, manqueront le bateau et réapparaîtront quelques jours après, “honteusement épuisés et souriants” ; elle s’arrêtera elle aussi à Esna, mais pour contempler les dégâts du temps sur le corps de cette pauvre Kutchuk Hanim : elle aura sa revanche.)
Читать дальше