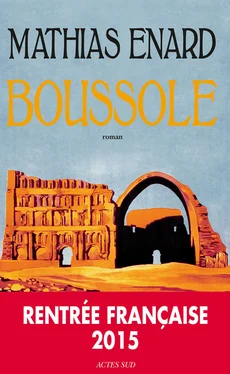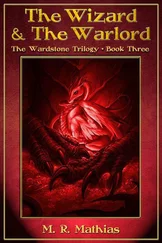Azra se rendait compte que son père ne rentrerait vraisemblablement jamais. Tous les prisonniers du shah étaient déjà libérés, vite remplacés dans les prisons par les partisans et soldats de l’ancien régime. Le sang coulait — on exécutait à la hâte les militaires et les hauts fonctionnaires. Le Conseil révolutionnaire de Khomeiny voyait maintenant Mehdi Bazargan, son propre Premier ministre, comme un obstacle à l’instauration de la République islamique. Ces premiers affrontements, et plus tard la transformation des Comités en « Gardiens de la Révolution » et « Volontaires des Opprimés » préparaient le terrain pour la confiscation du pouvoir. Tout à l’exubérance révolutionnaire, les classes moyennes et les formations politiques les plus puissantes (parti Toudeh, Front démocratique, Moudjahidin du Peuple) paraissaient ne pas se rendre compte de la montée des périls. Le tribunal révolutionnaire itinérant dirigé par Sadegh Khalkhali dit le Boucher, à la fois juge et bourreau, était déjà en marche. Malgré tout cela, dès la fin mars, à la suite d’un référendum promu entre autres par les communistes et les moudjahidin, l’empire d’Iran devint la République islamique d’Iran, et se lança dans la rédaction de sa Constitution.
Azra avait apparemment abandonné les thèses de Shariati pour se rapprocher du Toudeh communiste. Elle continuait à militer, participait aux manifestations et publiait des articles féministes dans les journaux proches du Parti. Elle avait aussi rassemblé certains des poèmes de Farid Lahouti, les plus politiques, en un petit recueil qu’elle avait confié rien de moins qu’à Ahmad Shamlou lui-même — déjà le poète le plus en vue de l’époque, le plus novateur, le plus puissant, qui l’avait trouvé (alors qu’il n’était pas tendre pour la poésie de ses contemporains) magnifique : il fut abasourdi d’apprendre que ce Lahouti était en réalité un orientaliste français et fit publier quelques-uns de ces textes dans des revues influentes. Ce succès me rendit fou de jalousie. Même interné à des milliers de kilomètres, Lyautey s’arrangeait pour me rendre la vie impossible. J’aurais dû détruire toutes ces maudites lettres au lieu de me contenter d’en jeter seulement quelques-unes aux flammes. En mars, au moment où le printemps revenait, où le Nouvel An iranien consacrait l’an 1 de la Révolution, au moment où l’espoir de tout un peuple grandissait avec les roses, espoir qui brûlerait aussi sûrement que les roses, alors que je faisais des plans pour épouser l’objet de ma passion, ce stupide recueil, à cause de l’estime de quatre intellectuels, renforçait le lien entre Azra et Fred. Elle ne parlait plus que de cela. À quel point un tel avait apprécié ces poèmes. Comment l’acteur machin allait lire ces vers dans une soirée organisée par tel ou tel magazine à la mode. Ce triomphe donnait à Azra la force de me mépriser. Je sentais son mépris dans ses gestes, dans son regard. Sa culpabilité s’était transformée en une haine méprisante envers moi et tout ce que je représentais, la France, l’Université. J’étais en train d’intriguer pour lui obtenir une bourse de thèse, afin que, à la fin de mon séjour en Iran, nous puissions rentrer ensemble à Paris. Je voulais l’épouser. Elle envoyait tout promener avec mépris. Et pire encore : elle se refusait à moi. Elle venait jusqu’à mon appartement pour me narguer, pour me parler de ces poèmes, de la Révolution et me repoussait. Deux mois plus tôt je la tenais contre moi et à présent je n’étais plus qu’un déchet abject qu’elle rejetait avec horreur.”
Gilbert renversa son verre en chassant d’un geste trop ample les oiseaux qui s’étaient enhardis à picorer les miettes de sucreries jusque sur la table. Il se resservit aussitôt, et sécha son petit godet d’une lampée bien sentie. Il avait des larmes dans les yeux, des larmes qui ne paraissaient pas provenir de la violence de l’alcool. Sarah s’était rassise. Elle observait les deux oiseaux voleter jusqu’au couvert des arbustes. Je savais qu’elle balançait entre la compassion et la colère ; elle regardait ailleurs, mais ne partait pas. Morgan restait silencieux, comme si l’histoire était terminée. Nassim Khanom a soudain réapparu. Elle a retiré les tasses, les sous-tasses, les coupelles de candi. Elle portait un roupouch bleu foncé noué fort sous le menton, une blouse grise à motifs bruns ; elle n’a pas adressé un regard à son employeur. Sarah lui a souri ; elle lui a rendu son sourire, lui a proposé du thé ou de la limonade. Sarah l’a gentiment remerciée de ses efforts, à l’iranienne. J’ai réalisé que je mourais de soif, j’ai vaincu ma timidité pour demander à Nassim Khanom un peu plus de limonade : ma phonétique persane était si terrifiante qu’elle ne m’a pas compris. Sarah est venue à mon secours, comme d’habitude. J’ai eu l’impression, ô combien vexante, qu’elle répétait exactement ce que je venais de dire — mais cette fois-ci, Nassim Khanom comprit instantanément. J’imaginai sur-le-champ un complot, par lequel cette dame respectable me rangeait du côté des hommes, du côté de son terrifiant patron, qui restait toujours silencieux, les yeux rougis de vodka et de souvenir. Sarah perçoit mon désarroi vexé, l’interprète mal ; elle me fixe un moment, comme si elle me prenait la main pour nous extraire de la boue tiède de cette fin d’après-midi, et cette tendresse soudaine tend si fort les liens entre nous qu’un enfant pourrait jouer à l’élastique avec, au milieu de ce jardin sinistre, brûlé par l’été.
Morgan n’avait plus rien à ajouter. Il remuait son verre, encore et encore, les yeux dans le passé. Il est temps de partir. J’ai tiré sur ces fameuses cordes invisibles et Sarah s’est levée en même temps que moi.
Merci, Gilbert, pour ce magnifique après-midi. Merci. Merci.
J’engloutis le verre de limonade que Nassim Khanom vient d’apporter. Gilbert ne se lève pas, il marmonne des vers persans auxquels je n’entends goutte. Sarah est debout ; elle place son voile de soie violette sur ses cheveux. Je compte machinalement les taches de rousseur de son visage. Je pense Azra, Sarah, presque les mêmes sons, les mêmes lettres. La même passion. Morgan lui aussi regarde Sarah. Assis, il a les yeux fixés sur ses hanches dissimulées par le manteau islamique qu’elle vient d’enfiler malgré la chaleur.
“Qu’est devenue Azra ?” je pose la question pour détourner son regard du corps de Sarah, bêtement, jalousement, comme on rappelle à un homme le prénom de sa femme pour que ses phonèmes le fouettent, avec le bon Dieu et la Loi morale.
Morgan se tourne vers moi, un air de peine sur le visage :
“Je ne sais pas. On m’a raconté qu’elle avait été exécutée par le régime. C’est probable. Des milliers de militants ont disparu au début des années 1980. Hommes et femmes. La Patrie en danger. L’agression irakienne, au lieu d’affaiblir le régime comme prévu, l’a renforcé, lui a donné une excuse pour se débarrasser de toute l’opposition intérieure. Les jeunes Iraniens qui avaient vécu entre le shah et la République islamique, cette classe moyenne (horrible expression) qui avait crié, écrit, lutté en faveur de la démocratie, tous ont fini pendus dans une obscure prison, tués sur le front ou contraints à l’exil. J’ai quitté l’Iran peu après le début de la guerre ; j’y suis revenu huit ans plus tard, en 1989. Ce n’était plus le même pays. L’université était pleine d’anciens combattants incapables d’aligner deux mots devenus étudiants par la grâce du Bassij. Étudiants qui deviendraient professeurs. Professeurs ignares qui formeraient à leur tour des élèves destinés à la médiocrité. Tous les poètes, tous les musiciens, tous les savants étaient en exil intérieur, écrasés par la dictature du deuil. Tous à l’ombre des martyrs. À chaque mouvement de cil, on leur rappelait un martyr. Leurs rues, leurs impasses, leurs épiceries portaient des noms de martyrs. Des morts, du sang. De la poésie de mort, des chants de morts, des fleurs de mort. La lyrique devenait des noms d’offensives : Aurore I, Aurore II, Aurore III, Aurore IV, Aurore V, Kerbela I, Kerbela II, Kerbela III, Kerbela IV et ainsi de suite jusqu’à la parousie du Mahdi. J’ignore où et quand est morte Azra. Dans la prison d’Evin, sans doute. Je suis mort avec elle. Bien avant. En 1979, l’an 1 de la Révolution, l’année 1357 du calendrier hégirien solaire. Elle n’a plus souhaité me voir. C’est aussi simple que cela. Elle s’est dissoute dans sa honte. Alors que Khomeiny se débattait pour consolider son pouvoir, Azra, forte de son amour pour les poèmes de Lahouti, me quittait définitivement. Elle avait appris la vérité, disait-elle. Une vérité — de quelle façon j’avais intrigué pour éloigner son amant, comment j’avais menti à propos de son père — pas la vérité. La vérité, c’est mon amour pour elle, qu’elle avait pu constater à chaque instant où nous étions ensemble. C’est la seule vérité. Je n’ai jamais été entier qu’à ces moments où nous étions réunis. Je ne me suis jamais marié. Je n’ai jamais fait de promesse à quiconque. Je l’ai attendue toute ma vie.
Читать дальше