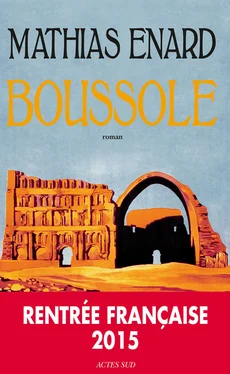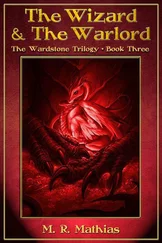J’ai moi aussi fait quelques pas dans le petit jardin. La villa de Morgan à Zafaraniyé était un endroit magique, une maison de poupée, sans doute construite pour le gardien d’une grande demeure disparue depuis, ce qui expliquerait son emplacement bizarre, presque au bord de l’avenue Vali-Asr. Morgan l’avait louée à un de ses amis iraniens. La première fois que j’y suis allé, à l’invitation du maître, en hiver, peu de temps avant notre voyage à Bandar Abbas, alors que la neige recouvrait tout, que les rosiers nus brillaient de givre, il y avait un feu dans la cheminée — cheminée orientale, dont le linteau arrondi et le manteau en pointe rappelaient celles du palais de Topkapi à Istanbul. Partout, des tapis précieux aux couleurs vives et pourtant nuancées, des violets, des bleus, des orangés ; aux murs, des faïences de l’époque qadjare et des miniatures de grand prix. Le salon était petit, bas de plafond, il convenait à l’hiver ; le professeur y récitait des poèmes de Hafez dont il tentait, depuis des années, d’apprendre l’ensemble du Divan par cœur, comme les savants d’autrefois : il affirmait qu’apprendre Hafez par cœur était la seule façon de comprendre intimement ce qu’il appelait l’espace du ghazal, l’enchaînement des vers, l’agencement des poèmes, le retour des personnages, des thèmes ; savoir Hafez, c’était faire l’expérience intime de l’amour. “J’ai peur que mes larmes trahissent mon chagrin et que ce mystère fasse le tour du monde. Hafez, toi qui tiens le musc de ses cheveux dans ta main, retiens ton souffle, sinon le zéphyr va éventer ton secret !” Pénétrer le mystère, ou les mystères — mystères phonétiques, mystères métriques, mystères de métaphores. Las, le poète du XIV esiècle rejetait le vieil orientaliste : malgré tous ses efforts, retenir l’ensemble des quatre cent quatre-vingts ghazals qui composent le Divan s’avérait impossible. Il mélangeait l’ordre des vers, en oubliait certains ; les règles esthétiques du recueil, et notamment l’unité de chacun des distiques, parfaits comme des perles enfilées une à une sur le fil de la métrique et de la rime pour produire le collier du ghazal, faisaient qu’il était facile d’en oublier. Sur les quatre mille vers que contient l’œuvre, se lamentait Morgan, j’en sais peut-être trois mille cinq cents. Il m’en manque toujours cinq cents. Toujours. Ce ne sont jamais les mêmes. Certains apparaissent, d’autres s’en vont. Ils composent un nuage de fragments qui s’interpose entre la Vérité et moi.
Ces considérations mystiques au coin du feu, nous les prenions pour l’expression d’une lubie littéraire, la dernière tocade d’un érudit — les révélations de l’été leur donneraient un tout autre sens. Le secret, l’amour, la culpabilité, nous entrevoyions leur source. Et si j’ai écrit ce texte grave et solennel en rentrant à Vienne c’est sans doute pour les consigner à mon tour, autant que pour retrouver, par la prose, la présence de Sarah partie, endeuillée, bouleversée, affronter la tristesse à Paris. Quelle sensation étrange de se relire. Un miroir vieillissant. Je suis attiré et repoussé par ce moi ancien comme par un autre. Un premier souvenir, intercalé entre le souvenir et moi. Une feuille de papier diaphane que la lumière traverse pour y dessiner d’autres images. Un vitrail. Je est dans la nuit. L’être est toujours dans cette distance, quelque part entre un soi insondable et l’autre en soi. Dans la sensation du temps. Dans l’amour, qui est l’impossibilité de la fusion entre soi et l’autre. Dans l’art, l’expérience de l’altérité.
Nous n’arrivions pas plus à partir que Morgan à achever son récit — il poursuivait sa confession, peut-être aussi surpris par sa capacité à parler que par la nôtre à l’écouter. Malgré tous mes signes, Sarah, quoique révoltée, restait accrochée à sa chaise de jardin de métal ajouré.
“Azra a finalement accepté de revenir chez moi. Et même plusieurs fois. Je lui racontais des mensonges sur son père. Le 16 janvier, suivant les conseils de son état-major, le shah quitta l’Iran, soi-disant « pour des vacances » et laissa le pouvoir à un gouvernement de transition dirigé par Shahpur Bakhtiar. Les premières mesures de Bakhtiar furent la dissolution de la Savak et la libération de tous les prisonniers politiques. Le père d’Azra n’a pas réapparu. Je crois que personne n’a jamais su ce qu’il était devenu. La Révolution semblait accomplie. Un Boeing d’Air France ramena l’ayatollah Khomeiny à Téhéran deux semaines plus tard, contre l’avis du gouvernement. Des centaines de milliers de personnes l’accueillirent comme le Mahdi. Je n’avais qu’une peur, c’est que Lyautey soit dans l’avion. Mais non. Il viendrait très bientôt, annonçait-il à Azra dans ces lettres que je lisais. Il s’inquiétait de la tristesse, du silence, de la froideur d’Azra. Il l’assurait de son amour ; plus que quelques jours, disait-il, et nous serons bientôt réunis, courage. Il ne comprenait pas cette douleur et cette honte dont elle lui parlait, disait-il, sans lui en donner les raisons.
Azra était si triste, lors de nos rencontres, que petit à petit je finissais par être dégoûté de moi-même. Je l’aimais passionnément et je la voulais heureuse, joyeuse, passionnée elle aussi. Mes caresses ne lui tiraient que des larmes froides. Je possédais peut-être sa beauté, mais elle m’échappait. L’hiver était interminable, glacial et sombre. Autour de nous, l’Iran basculait dans le chaos. Nous avions cru un instant la Révolution achevée, et elle ne faisait que commencer. Les religieux et les partisans de Khomeiny luttaient contre les démocrates modérés. Quelques jours après son retour en Iran, Khomeiny avait nommé son propre Premier ministre parallèle, Mehdi Bazargan. Bakhtiar était devenu un ennemi du peuple, le dernier représentant du shah. On commençait à entendre crier des slogans en faveur d’une « République islamique ». Dans chaque quartier, un comité révolutionnaire était organisé. Enfin organisé si l’on peut dire. Les armes fleurissaient. Les gourdins, les matraques, puis, après le ralliement d’une partie de l’armée, le 11 février, les fusils d’assaut : les partisans de Khomeiny occupèrent tous les bâtiments administratifs et même les palais de l’empereur. Bazargan devint le premier chef de gouvernement nommé non plus par le shah, mais par la Révolution — en réalité par Khomeiny. On avait la sensation d’un danger, d’une catastrophe imminente. Les forces révolutionnaires étaient si disparates qu’il était impossible de deviner quelle forme pourrait prendre un nouveau régime. Les communistes du parti Toudeh, les marxisto-musulmans, les Moudjahidin du Peuple, les religieux khomeynistes partisans du velâyat-e faqih , les libéraux pro-Bakhtiar et même les autonomistes kurdes s’affrontaient plus ou moins directement pour le pouvoir. La liberté d’expression était totale et on publiait à tour de bras, des journaux, des pamphlets, des recueils de poèmes. L’économie était dans un état catastrophique ; le pays était si désorganisé que les produits de base commençaient à manquer. L’opulence de Téhéran semblait avoir disparu en une nuit. Malgré tout, nous nous retrouvions entre camarades et nous mangions des boîtes et des boîtes de caviar de contrebande aux gros grains verdâtres, avec du pain sangak et de la vodka soviétique — nous achetions tout cela en dollars. Certains commençaient à avoir peur d’un effondrement total du pays et cherchaient des devises étrangères.
Je savais depuis peu pourquoi Lyautey ne rentrait pas en Iran : il était hospitalisé dans une clinique de la banlieue parisienne. Grave dépression, hallucinations, délire. Il ne parlait plus que persan et était persuadé de s’appeler réellement Farid Lahouti. Les médecins pensaient qu’il s’agissait d’un surmenage et d’un choc lié à la Révolution iranienne. Ses lettres à Azra devenaient encore plus nombreuses ; plus nombreuses et chaque fois plus sombres. Il ne lui parlait pas de son hospitalisation, uniquement des tourments de l’amour, de l’exil, de sa douleur. Des images revenaient souvent, la braise devenue anthracite, dure et friable, dans l’absence ; un arbre aux branches de glace tué par le soleil d’hiver ; un étranger face au mystère d’une fleur qui ne s’ouvre jamais. Comme lui-même ne le mentionnait pas, je n’ai pas révélé à Azra l’état de santé de Lyautey. Mon chantage et mes mensonges me pesaient. Je voulais qu’Azra soit à moi entièrement ; posséder son corps n’était qu’un avant-goût d’un plaisir plus complet encore. J’essayais d’être attentionné, de la séduire, et de ne plus la contraindre. Plus d’une fois j’ai été sur le point de lui révéler la vérité, toute la vérité, mon ignorance quant à la situation de son père, l’état de Lyautey à Paris, mes manigances pour le faire expulser. Mes mystifications étaient en réalité des preuves d’amour. Je n’avais menti que par passion, et j’espérais qu’elle comprendrait.
Читать дальше