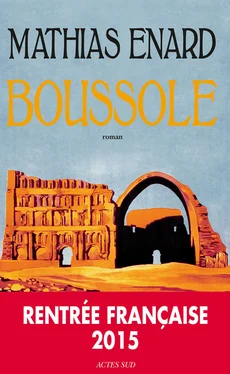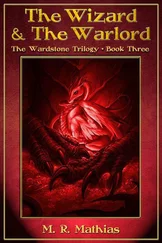Nous autres jeunes scientifiques français, nous suivions les événements de plus ou moins loin, avec nos camarades iraniens ; mais personne, je dis bien personne (à part peut-être nos services de renseignement à l’ambassade, mais j’en doute) ne pouvait imaginer ce qui nous attendait l’année suivante. Sauf Frédéric Lyautey, bien sûr, qui non seulement imaginait ce qui pouvait se produire, le renversement du shah, la Révolution, mais le souhaitait. Il était révolutionnaire. Nous le voyions de moins en moins. Je savais par Azra qu’il militait, comme elle, dans un groupuscule « islamiste » (le mot avait un autre sens à l’époque) progressiste qui voulait l’application des idées révolutionnaires d’Ali Shariati. J’ai demandé à Azra si Lyautey s’était converti — elle m’a regardé avec un air tout à fait surpris, sans comprendre. Pour elle, bien évidemment, Lahouti était tellement iranien que son chiisme allait de soi et que, s’il avait dû se convertir, c’était il y a bien longtemps. Bien sûr, et je tiens à insister là-dessus, des religieux plus ou moins illuminés il y en a toujours eu et il y en aura toujours dans l’iranologie et l’islamologie en général. Un jour je vous raconterai l’histoire de cette collègue française qui au moment du décès de Khomeiny en 1989 pleura toutes les larmes de son corps en criant « Emâm est mort ! Emâm est mort ! » et faillit mourir de chagrin à Béhesht-e Zahra, au milieu de la foule, aspergée d’eau de rose par les hélicoptères, le jour de l’enterrement. Elle avait découvert l’Iran quelques mois plus tôt. Ce n’était pas le cas de Lyautey. Ce n’était pas un dévot, je le sais. Il n’avait ni le zèle des convertis, ni cette force mystique que l’on ressent chez certains. C’est incroyable, mais il était simplement chiite comme n’importe quel Iranien, avec naturel et simplicité. Par empathie. Je ne suis même pas sûr qu’il fût réellement croyant. Mais les idées de Shariati sur le « chiisme rouge », le chiisme du martyre, de l’action révolutionnaire face au « chiisme noir » du deuil et de la passivité l’enflammaient. La possibilité que l’Islam soit une force de renouveau, que l’Iran puise en lui-même les concepts de sa propre révolution l’enthousiasmait. Tout comme Azra et des millions d’autres Iraniens. Ce que je trouvais amusant (et je n’étais pas le seul) c’est que Shariati avait été formé en France ; il avait suivi les cours de Massignon et de Berque ; Lazard avait dirigé sa thèse. Ali Shariati, le plus iranien ou du moins le plus chiite des penseurs de la Révolution, avait construit sa réflexion auprès des orientalistes français. Voilà qui devrait vous plaire, Sarah. Une pierre de plus pour votre concept cosmopolite de « construction commune ». Est-ce qu’Edward Saïd mentionne Shariati ?
— Euh, oui, je crois, dans Culture et impérialisme . Mais je ne me souviens plus en quels termes.”
Sarah s’était mordu la lèvre avant de répondre ; elle détestait être prise en défaut. Dès notre retour, elle allait se précipiter à la bibliothèque — et hurler si d’aventure les œuvres complètes de Saïd ne s’y trouvaient pas. Morgan profita de ce détour de la conversation pour se resservir un petit verre de vodka, Dieu merci sans insister pour que nous l’accompagnions. Deux oiseaux voletaient autour de nous et se posaient parfois sur la table pour essayer de picorer des graines. Leur poitrine était jaune, leur tête et leur queue, bleutées. Morgan faisait de grands gestes plutôt comiques pour les effrayer, comme s’il s’agissait de mouches ou de frelons. Il avait beaucoup changé depuis Damas et même depuis Paris et la soutenance de la thèse de Sarah où je l’avais vu avant d’arriver à Téhéran. C’est à cause de sa barbe, de ses cheveux collés par plaques, de ses vêtements d’un autre âge, de son cartable, en skaï bleu et noir, cadeau promotionnel d’Iran Air dans les années 1970, de son blouson couleur crème, noirci aux coudes et au long de la fermeture éclair ; c’est pour son haleine, chaque fois plus chargée, c’est pour tous ces détails fragiles accumulés sur son corps que nous pensions qu’il tombait, qu’il était en chute libre. L’aspect un peu négligé que présentent parfois certains universitaires, par nature savants et distraits, n’était pas ici en cause. Sarah imaginait qu’il avait contracté une de ces maladies de l’âme qui vous dévorent dans la solitude ; à Paris, disait-elle, il soignait cette affection au vin rouge, dans son petit deux-pièces, où les bouteilles s’alignaient devant la bibliothèque, sous les respectables divans des poètes classiques persans. Et ici, à Téhéran, à la vodka arménienne. Ce grand professeur était d’une prodigieuse amertume, alors que sa carrière me paraissait brillante, tout à fait enviable, même ; il était respecté internationalement ; il gagnait des sommes sans doute mirobolantes grâce à son nouveau poste à l’étranger et pourtant, il tombait. Il tombait, et cherchait à se rattraper dans sa chute, à se rattraper aux branches, surtout aux femmes, aux jeunes femmes, il cherchait à s’accrocher aux sourires, aux regards qui lui taraudaient l’âme blessée, des baumes douloureux sur une plaie à vif. Sarah le connaissait depuis plus de dix ans, et elle redoutait de se retrouver seule avec lui, surtout s’il avait bu : non pas que le vieux savant fût un redoutable tigre, mais elle voulait lui éviter une humiliation, et un sentiment de rejet qui n’aurait qu’accentué sa mélancolie si elle avait été obligée de le remettre à sa place. Je pensais quant à moi que l’éminent professeur, grand spécialiste de poésie lyrique persane et européenne, qui connaissait sur le bout des doigts aussi bien Hafez que Pétrarque, Nima Youshidj que Germain Nouveau présentait juste tous les symptômes du démon de midi, ou plutôt du démon de 3 heures, vu son âge ; ce climatère, chez un séducteur invétéré, un homme dont les ruines montraient qu’il avait été beau et charismatique, me semblait propre à déclencher une morosité certaine, morosité entrecoupée de phases maniaques désespérées, comme celle à laquelle nous assistions, au milieu des roses et des oiseaux, de la bergamote et du nougat, dans la chaleur qui pesait plus lourd sur Téhéran que tous les voiles de l’Islam.
“Après notre rencontre, nous nous sommes croisés régulièrement, avec Azra, au long de l’année 1978. Elle était officiellement la « fiancée » de Frédéric Lyautey, ou plutôt de Farid Lahouti, avec qui elle passait son temps à militer, à manifester, à discuter de l’avenir de l’Iran, de la possibilité puis de la réalité de la Révolution. Le shah fit pression, pendant l’été, sur le gouvernement irakien voisin pour qu’il expulse Khomeiny de Nadjaf, pensant ainsi le couper de l’opposition interne. Khomeiny se retrouva en banlieue parisienne à Neauphle-le-Château, avec toute la puissance des médias occidentaux dans les mains. Certes beaucoup plus loin de Téhéran, mais infiniment plus près des oreilles et des cœurs de ses compatriotes. Une fois encore, la mesure prise par le shah se retournait contre lui. Khomeiny appela à la grève générale et paralysa le pays, toutes les administrations, et surtout, plus grave pour le régime, l’industrie pétrolière. Farid et Azra participèrent à l’occupation du campus de l’université de Téhéran, puis aux affrontements avec l’armée qui allaient conduire aux émeutes du 4 novembre 1978 : la violence devenait générale, Téhéran était en flammes. L’ambassade de Grande-Bretagne brûla en partie ; des boutiques, des bars, des banques, des postes brûlèrent — tout ce qui représentait l’empire du shah ou l’influence occidentale fut attaqué. Le lendemain matin, le 5 novembre, j’étais avec Azra chez moi. Elle était passée sans prévenir vers 9 heures du matin, plus belle que jamais, malgré son air attristé. Elle était absolument irrésistible. Elle flottait dans le vent brûlant de liberté qui soufflait sur l’Iran. Elle avait un visage si harmonieux, sculpté d’ombres, fin, les lèvres couleur grains de grenade, le teint légèrement bistre ; elle exhalait le santal et le sucre tiède. Sa peau était un talisman de baume, qui faisait perdre la raison à tous ceux qu’elle effleurait. La douceur de sa voix était telle qu’elle aurait consolé un mort. Parler, échanger des paroles avec Azra était si hypnotique que très vite vous vous laissiez bercer sans répondre, vous deveniez un faune, assoupi par le souffle d’un archange. En ce milieu d’automne, la lumière était encore splendide ; j’ai préparé un thé, le soleil inondait mon minuscule balcon, qui donnait sur une petite koutché parallèle à l’avenue Hafez. Elle était venue une seule fois chez moi, avec une partie de la petite bande du Naderi, avant l’été. La plupart du temps, nous nous croisions dans des cafés. Je passais ma vie dehors. Je hantais ces bistrots dans l’espoir de la voir. Et voilà qu’elle débarquait chez moi, à 9 heures du matin, après avoir traversé à pied une ville livrée au chaos ! Elle s’était souvenue de l’adresse. La veille, me raconta-t-elle, elle avait été témoin des affrontements entre les étudiants et l’armée sur le campus. Les soldats avaient tiré, des jeunes étaient morts, elle était encore tremblante d’émotion. La confusion était si grande qu’elle avait mis des heures à quitter la fac et à rentrer chez ses parents, qui lui avaient formellement interdit de retourner à l’université — elle avait désobéi. Téhéran est en guerre, disait-elle. La ville sentait l’incendie ; un mélange de pneus et d’ordures brûlés. Le couvre-feu allait être déclaré. Couvrir le feu, voilà la politique du shah. Il annoncerait l’après-midi même la formation d’un gouvernement militaire en disant : « Peuple d’Iran, vous vous êtes soulevé contre l’oppression et la corruption. En tant que shah d’Iran et Iranien, je ne peux que saluer cette révolution de la Nation iranienne. J’ai entendu le message de votre révolution, peuple d’Iran. » J’avais vu moi aussi, de ma fenêtre, la fumée des émeutes, entendu les cris et les bruits de vitrines brisées sur l’avenue Hafez, vu des dizaines de jeunes hommes courir dans mon impasse — cherchaient-ils un bar ou un restaurant au nom occidental à attaquer ? Les consignes de l’ambassade étaient claires, il fallait rester chez soi. Attendre la fin de l’orage.
Читать дальше