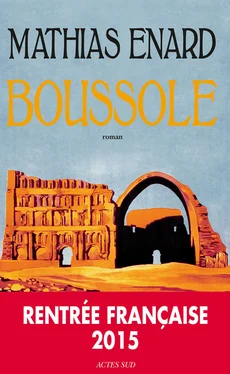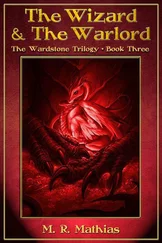“Nous n’avons plus rien su de Fred Lyautey pendant quelques semaines — il apparaissait de temps en temps à l’institut, prenait un thé avec nous sans rien dire de spécial et repartait. Son aspect physique était redevenu normal ; il ne participait pas à nos discussions sur l’agitation sociale et politique ; il nous regardait juste en souriant, avec un air vaguement supérieur, peut-être un rien méprisant, en tout cas tout à fait irritant, comme s’il était le seul à comprendre les événements en cours. La Révolution était en marche, même si, début 1978, dans les cercles que nous fréquentions, personne ne pouvait croire à la chute du shah — et pourtant, la dynastie Pahlavi n’avait plus qu’un an devant elle.
Vers la fin février (c’était peu de temps après le « soulèvement » de Tabriz) j’ai revu Lyautey au café Naderi, par hasard. Il était en compagnie d’une jeune femme magnifique, pour ne pas dire sublime, une étudiante en lettres françaises appelée Azra, que j’avais déjà vue une ou deux fois et, pourquoi le cacher, remarquée pour sa grande beauté. J’étais estomaqué de la retrouver en compagnie de Lyautey. À l’époque, il parlait si bien persan qu’il pouvait passer pour iranien. Même ses traits s’étaient légèrement transformés, son teint avait un peu foncé, me semblait-il, et je pense qu’il teignait ses cheveux, qu’il portait mi-longs, à l’iranienne. Il se faisait appeler Farid Lahouti, parce qu’il trouvait que cela ressemblait à Fred Lyautey.”
Sarah l’a interrompu : “Lahouti comme le poète ?
— Ou comme le marchand de tapis du bazar, allez savoir. Toujours est-il que les serveurs, qu’il connaissait tous, lui donnaient du Agha-ye Lahouti par-ci, Agha-ye Lahouti par-là, à tel point que je me demande s’il n’avait pas fini lui-même par croire que c’était son vrai nom de famille. C’était absolument ridicule et cela nous énervait au plus haut point, par jalousie sans doute, car son persan était vraiment parfait : il maîtrisait tous les registres, la langue parlée aussi bien que les méandres du persan classique. J’ai su plus tard qu’il avait même réussi à obtenir, Dieu sait comment, une carte d’étudiant au nom de Farid Lahouti, une carte avec sa photographie. Il faut que je l’avoue, j’étais choqué de le découvrir là, en compagnie d’Azra, au café Naderi — qui était un peu notre repaire. Pourquoi l’avait-il amenée précisément à cet endroit ? À l’époque il y avait beaucoup de cafés et de bars à Téhéran, rien à voir avec aujourd’hui. J’ai imaginé qu’il voulait qu’on la voie avec lui. Ou peut-être était-ce une simple coïncidence. Toujours est-il que je me suis assis avec eux, soupira Morgan, et qu’une heure après je n’étais plus le même.”
Il regardait son verre, concentré sur la vodka, sur ses souvenirs ; peut-être voyait-il un visage dans le liquide, un fantôme.
“J’étais ensorcelé par la beauté, la grâce, la finesse d’Azra.”
Sa voix avait baissé d’un ton. Il parlait tout seul. Sarah m’a jeté un coup d’œil du genre “il est complètement soûl”. J’avais envie d’en savoir plus, d’apprendre ce qui avait bien pu se produire ensuite, au café Naderi, en pleine révolution — j’y suis allé, dans ce café où Sadegh Hedayat avait ses habitudes, Sarah m’y a traîné ; comme tous les cafés du Téhéran postrévolutionnaire, l’endroit était un peu déprimant, non pas parce qu’on ne pouvait plus y boire d’alcool, mais parce que les jeunes qui y vidaient leurs faux Pepsi en se regardant dans les yeux ou les poètes qui y lisaient le journal une cigarette aux lèvres avaient tous l’air un peu tristes, abattus, écrasés par la République islamique ; le café Naderi était un vestige, une trace du jadis, une mémoire du centre-ville d’autrefois, ouvert et cosmopolite, et donc prompt à propulser ses clients dans une profonde nostalgie.
Sarah attendait que Gilbert de Morgan poursuive son histoire ou s’effondre, vaincu par la vodka arménienne, sur le gazon bien ras du petit jardin devant la terrasse ; je me demandais si nous ne ferions pas mieux de partir, de redescendre vers le bas de la ville, mais la perspective de nous retrouver dans un immense embouteillage par cette chaleur n’était pas très encourageante. Le métro était suffisamment éloigné de la petite villa de Zafaraniyé pour que, à pied, on soit sûr de l’atteindre trempés de sueur, surtout Sarah, sous son manteau islamique et son roupouch . Il valait mieux rester encore un peu dans ce jardin si iranien, à savourer les nougats d’Ispahan offerts par Nassim Khanom, voire à jouer une petite partie de croquet dans l’herbe tendre, restée verte grâce aux soins du locataire et à l’ombre des grands arbres, jusqu’à ce que la température baisse un peu, que les hautes montagnes semblent aspirer, autour du coucher du soleil, la chaleur des vallées.
Morgan marqua une longue pause un peu embarrassante pour l’auditoire. Il ne nous regardait plus ; il observait, dans son verre vide, les reflets des rayons du soleil transformer les glaçons en diamants fragiles. Il finit par relever la tête.
“Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout cela, excusez-moi.”
Sarah se retourna vers moi, comme pour chercher mon approbation — ou s’excuser de l’hypocrite platitude de sa phrase suivante :
“Vous ne nous ennuyez pas du tout, au contraire. La Révolution est une période passionnante.”
La Révolution tira immédiatement Morgan de sa rêverie.
“C’était un grondement qui enflait, chaque fois plus sourd, chaque fois plus puissant, tous les quarante jours. Fin mars, pour la commémoration des morts de Tabriz, il y eut des manifestations dans plusieurs grandes villes d’Iran. Puis d’autres encore le 10 mai, et ainsi de suite. Arbein . Le deuil des quarante jours. Le shah avait pourtant pris des mesures pour contenter l’opposition — remplacement des chefs les plus sanglants de la Savak, fin de la censure et liberté de la presse, libération de nombreux prisonniers politiques. À tel point qu’en mai la CIA transmettait à son gouvernement une note célèbre, dans laquelle ses agents en poste en Iran affirmaient que « la situation était en passe de redevenir normale et que l’Iran n’était pas dans une situation prérévolutionnaire, encore moins révolutionnaire ». Mais le grondement s’est encore amplifié. Sommé de lutter contre l’inflation, la principale revendication du peuple, le Premier ministre Djemshid Amouzegar avait appliqué une politique draconienne : il avait systématiquement refroidi l’activité, coupé net les investissements publics, arrêté les grands chantiers d’État, mis en place des systèmes d’amendes et d’humiliations contre les « profiteurs », principalement les commerçants du bazar qui répercutaient les hausses de prix. Cette politique rigoureuse avait été couronnée de succès : en deux ans, il avait organisé la crise économique, et magistralement réussi à remplacer l’inflation par un chômage massif, urbain, et à s’aliéner non seulement les classes moyennes et les ouvriers, mais aussi la bourgeoisie commerçante traditionnelle. C’est-à-dire qu’en fait, à part son immense famille qui dépensait ostensiblement les milliards du pétrole un peu partout dans le monde et quelques généraux corrompus paradant dans les conventions d’armement et les salons de l’ambassade des États-Unis, Reza Shah Pahlavi n’avait plus aucun soutien réel en 1978. Il flottait au-dessus de tous. Même ceux qui s’étaient enrichis grâce à lui, ceux qui avaient profité de l’éducation gratuite, ceux qui avaient appris à lire grâce à ses campagnes d’alphabétisation, bref tous ceux dont il pensait naïvement qu’ils auraient dû lui être reconnaissants souhaitaient son départ. Ses seuls partisans l’étaient par défaut.
Читать дальше