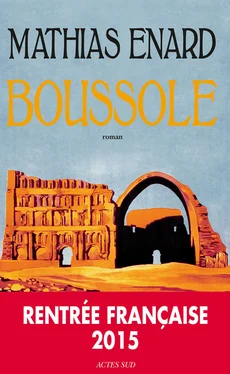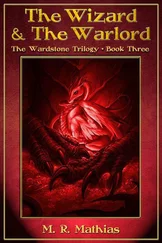Le temps a passé.
Depuis le château de Hainfeld, les promenades viennoises, Istanbul, Damas, Téhéran, nous sommes allongés chacun de notre côté séparés par le monde. Mon cœur bat trop vite, je le sens ; je respire trop souvent ; la fièvre peut provoquer cette légère tachycardie, a dit le médecin. Je vais me lever. Ou prendre un livre. Oublier. Ne pas penser à ces saloperies d’examens, à la maladie, à la solitude.
Je pourrais lui écrire une lettre, tiens ; voilà qui m’occuperait — “Très chère Sarah, merci pour l’article, mais j’avoue que son contenu m’inquiète : vas-tu bien ? Que fais-tu au Sarawak ?” Non, trop anodin. “Chère Sarah, il faut que tu saches que je suis mourant.” Un peu prématuré. “Chère Sarah, tu me manques”, trop direct. “Très chère Sarah, est-ce que les douleurs anciennes ne pourraient pas un jour redevenir joies ?” C’est beau ça, les douleurs anciennes . Est-ce que j’avais pompé des poètes, dans mes lettres d’Istanbul ? J’espère qu’elle ne les a pas conservées — un monument à la forfanterie.
La vie est une symphonie de Mahler, elle ne revient jamais en arrière, ne retombe jamais sur ses pieds. Dans ce sentiment du temps qui est la définition de la mélancolie, la conscience de la finitude, pas de refuge, à part l’opium et l’oubli ; la thèse de Sarah peut se lire (j’y pense seulement maintenant) comme un catalogue de mélancoliques, le plus étrange des catalogues d’aventuriers de la mélancolie, de genres et pays différents, Sadegh Hedayat, Annemarie Schwarzenbach, Fernando Pessoa, pour ne citer que ses préférés — qui sont aussi ceux auxquels elle consacre le moins de pages, contrainte qu’elle est par la Science et l’Université à coller à son sujet, aux Visions de l’autre entre Orient et Occident . Je me demande si ce qu’elle a cherché, au cours de cette vie scientifique qui recouvre totalement la sienne, sa quête, n’était pas sa propre guérison — vaincre la bile noire par le voyage, d’abord, puis par le savoir, et par la mystique ensuite et sans doute moi aussi, moi aussi, si l’on considère que la musique est le temps raisonné, le temps circonscrit et transformé en sons, si je me débats aujourd’hui dans ces draps, il y a gros à parier que je suis moi aussi atteint de ce Haut Mal que la psychiatrie moderne, dégoûtée de l’art et de la philosophie, appelle dépression structurelle , même si les médecins ne s’intéressent, dans mon cas, qu’aux aspects physiques de mes maux, sans doute tout à fait réels, mais dont j’aimerais tellement qu’ils soient imaginaires — je vais mourir, je vais mourir, voilà le message que je devrais envoyer à Sarah, respirons, respirons, allumons la lumière, ne nous laissons pas emporter sur cette pente-là. Je vais me débattre.
Où sont mes lunettes ? Cette lampe de chevet est vraiment indigente, il faut absolument que je la change. Combien de soirs l’ai-je allumée puis éteinte en me disant cela ? Quel laisser-aller. Il y a des livres partout. Des objets, des images, des instruments de musique dont je ne saurai jamais jouer. Où sont ces lunettes ? Impossible de remettre la main sur les actes du colloque de Hainfeld où se trouve son texte sur les goules, les djinns et autres monstres à côté de mon intervention sur Farabi. Je ne jette rien, et pourtant je perds tout. Le temps me dépouille. Je me suis rendu compte qu’il manquait deux volumes à mes œuvres complètes de Karl May. Qu’à cela ne tienne, je ne les relirai sans doute jamais, je mourrai sans les avoir relues, c’est atroce de penser cela, qu’un jour on sera trop mort pour relire Les Déserts et les Harems . Que mon Panorama d’Istanbul depuis la tour de Galata finira chez un antiquaire viennois qui le vendra en expliquant qu’il provient de la collection d’un orientaliste mort récemment. À quoi bon changer la lampe de chevet, du coup ? Panorama d’Istanbul … ou ce dessin de David Roberts lithographié par Louis Hague et colorisé soigneusement à la main pour la Souscription royale, représentant l’entrée de la mosquée du sultan Hassan au Caire, il ne faudra pas qu’il la brade, l’antiquaire, j’ai payé cette gravure une fortune. Ce qui est fascinant chez Sarah, c’est qu’elle ne possède rien. Ses livres et ses images sont dans sa tête ; dans sa tête, dans ses innombrables carnets. Moi les objets me rassurent. Surtout les livres et les partitions. Ou m’angoissent. Peut-être m’angoissent-ils autant qu’ils me rassurent. J’imagine tout à fait sa valise pour le Sarawak : sept culottes trois soutiens-gorges autant de tee-shirts, de shorts et de jeans, une foultitude de carnets à moitié remplis et point. Lorsque j’étais parti pour Istanbul la première fois Maman m’avait forcé à emporter du savon, de la lessive, une trousse de secours et un parapluie. Ma malle pesait trente-six kilos ce qui m’avait valu des ennuis à l’aéroport de Schwechat ; il avait fallu que j’en abandonne une partie à Maman, elle avait eu le bon goût de m’accompagner : je lui avais laissé à contrecœur la correspondance de Liszt et les articles de Heine (ils m’ont manqué par la suite), impossible de lui refiler le paquet de lessive, le chausse-pied ou mes chaussures de montagne, elle me disait “mais c’est indispensable, tu ne vas pas partir sans chausse-pied ! En plus ça ne pèse rien”, pourquoi pas un tire-botte tant que j’y étais, j’emportais déjà tout un assortiment de cravates et de vestes “au cas où je serais invité chez des gens bien”. Pour un peu elle m’aurait contraint à prendre un fer à repasser de voyage, mais j’avais réussi à la convaincre que, s’il était effectivement douteux que l’on trouvât de la bonne lessive autrichienne dans ces terres lointaines, les appareils électroménagers y étaient nombreux, y pullulaient même, étant donné la proximité de la Chine et de ses usines, ce qui ne l’avait que très moyennement rassurée. Cette valise est donc devenue ma croix, trente kilos de croix traînés douloureusement (les roulettes surchargées ont évidemment explosé au premier cahot) de logement en logement dans les rues aux pentes terrifiantes d’Istanbul, de Yeniköy à Taksim, et m’ont valu bien des sarcasmes de mes cothurnes, surtout pour la lessive et la pharmacie. Je voulais donner l’image d’un aventurier, un explorateur, un condottiere, et je n’étais qu’un fils à maman chargé de médicaments contre la diarrhée, de boutons et de fil à coudre au cas où. C’est un peu déprimant d’admettre que je n’ai pas changé, que les voyages n’ont pas fait de moi un homme intrépide, courageux et bronzé, mais un pâle monstre à lunettes qui tremble aujourd’hui à l’idée de traverser son quartier pour se rendre au lazaret.
Tiens les reflets de la lampe soulignent la poussière sur le Panorama d’Istanbul depuis la tour de Galata , on ne voit presque plus les bateaux, il faudrait que je la nettoie et surtout que je remette la main sur ces foutues lunettes. J’ai acheté cette photochromie dans une boutique derrière Istiqlal Caddesi, beaucoup de la crasse doit provenir d’Istanbul elle-même, saleté d’origine, en compagnie de Bilger l’archéologue — aux dernières nouvelles il est toujours aussi fou et alterne les séjours à l’hôpital avec des périodes d’une exaltation terrifiante où il découvre des tombeaux de Toutankhamon dans les jardins publics de Bonn, avant de retomber, vaincu par les drogues et la dépression, et on se demande dans laquelle de ces phases il est le plus inquiétant. Il faut l’entendre crier en gesticulant qu’il est victime de la malédiction du pharaon et décrire la conspiration scientifique qui l’écarte des postes importants pour se rendre compte à quel point il est atteint. La dernière fois, invité pour une conférence à la Beethovenhaus, j’ai cherché à l’éviter, mais par malchance il n’était pas à la clinique, il se tenait dans le public, au premier rang s’il vous plaît, et a évidemment posé une question interminable et incompréhensible sur une conspiration anti-Beethoven dans la Vienne impériale, où tout se mélangeait, le ressentiment, la paranoïa et la certitude d’être un génie incompris — l’assistance le regardait (à défaut de l’écouter) avec un air absolument consterné et l’organisatrice me lançait des regards terrifiés. Dieu sait pourtant si nous étions proches, autrefois — il était “promis à un grand avenir” et avait même dirigé, par intérim pendant quelques mois, l’antenne du prestigieux Deutsches Archäologisches Institut à Damas. Il gagnait beaucoup d’argent, arpentait la Syrie dans un 4×4 blanc impressionnant, passait de chantiers de fouilles internationaux à la prospection de sites hellénistiques inviolés, déjeunait avec le directeur des Antiquités nationales syriennes et fréquentait de nombreux diplomates de haut rang. Nous l’avions accompagné, une fois, sur l’Euphrate, dans une visite d’inspection au milieu du désert derrière l’atroce ville de Raqqa, et c’était merveille de voir tous ces Européens suer sang et eau au milieu des sables pour diriger des commandos d’ouvriers syriens, véritables artistes de la pelle, et leur indiquer où et comment ils devaient creuser le sable pour en faire renaître les vestiges du passé. Dès l’aube glacée, pour éviter la chaleur de la mi-journée, des indigènes en keffiehs grattaient la terre sous les ordres de savants français, allemands, espagnols ou italiens dont beaucoup n’avaient pas trente ans et venaient, gratuitement le plus souvent, profiter d’une expérience de terrain sur un des tells du désert syrien. Chaque nation avait ses sites, tout au long du fleuve et jusque dans les terres mornes de Jéziré aux confins de l’Irak : les Allemands Tell Halaf et Tell Bi’a, qui recouvrait une cité mésopotamienne répondant au doux nom de Tuttul ; les Français Doura Europos et Mari ; les Espagnols Halabiya et Tell Haloula et ainsi de suite, ils se battaient pour les concessions syriennes comme des compagnies pétrolières pour des champs pétrolifères, et étaient aussi peu enclins à partager leurs cailloux que des enfants leurs billes, sauf quand il fallait profiter de l’argent de Bruxelles et donc s’allier, car tous se mettaient d’accord quand il s’agissait de gratter, non plus la terre, mais les coffres de la Commission européenne. Bilger était dans ce milieu comme un poisson dans l’eau ; il nous semblait être le Sargon de ces foules besogneuses ; il commentait les chantiers, les trouvailles, les plans ; il appelait les ouvriers par leurs petits noms, Abou Hassan, Abou Mohammed : ces terrassiers “locaux” gagnaient une misère, mais une misère bien supérieure à ce qu’un chantier de construction du cru leur aurait rapporté, sans compter le divertissement de travailler pour ces Francs en sahariennes et foulards couleur crème. C’était le gros avantage des campagnes de fouilles “orientales” : là où en Europe ils étaient contraints par leurs budgets à creuser eux-mêmes, les archéologues en Syrie, à l’image de leurs glorieux prédécesseurs, pouvaient déléguer les basses besognes. Comme disait Bilger, citant Le Bon, la brute et le truand : “Le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un revolver, et ceux qui creusent.” Les archéologues européens avaient donc acquis un vocabulaire arabe tout à fait particulier et technique : creuser ici, dégager là, à la pelle, à la pioche, à la petite pioche, à la truelle — le pinceau était l’apanage des Occidentaux. Creuser doucement , dégager vite , et il n’était pas rare d’assister au dialogue suivant :
Читать дальше