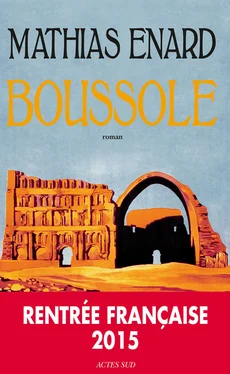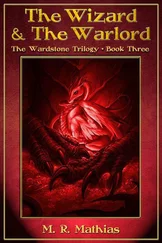Tiens, à propos de musique militaire : la galopade de M. Gruber qui va se coucher. Il est donc 23 heures — incroyable quand même que ce monsieur courre vers la salle de bains, tous les soirs, chaque soir que Dieu fait Herr Gruber se précipite vers ses chiottes à 11 heures pétantes en faisant craquer le parquet et trembler mes lustres.
En rentrant de Téhéran, je m’étais arrêté à Istanbul où j’avais passé trois jours splendides, seul ou presque, à part une virée mémorable avec Michael Bilger pour “fêter ma libération”, tant il est vrai qu’après dix mois sans sortir de Téhéran et une immense tristesse je méritais une fête à tout casser, en ville, dans des bars enfumés, des tavernes où il y avait de la musique, des filles et de l’alcool, et je pense que c’est la seule fois où j’ai été soûl de ma vie, réellement ivre, ivre de bruit, ivre des cheveux des femmes, ivre de couleurs, de liberté, ivre d’oubli de la douleur du départ de Sarah — Bilger l’archéologue prussien était un excellent guide, il m’a promené de bar en bar à travers Beyoglu avant de m’achever dans une boîte de nuit je ne sais plus où : je me suis effondré au milieu des putes et de leurs robes bariolées, le nez dans une coupelle contenant des carottes crues et du jus de citron. Il m’a raconté le lendemain avoir été obligé de me porter jusqu’à ma chambre d’hôtel, d’après lui je chantais à tue-tête (quelle horreur !) la Marche de Radetzky , mais ça je n’arrive pas à y croire, pourquoi diantre (même si j’étais en route pour Vienne) chanter ce thème martial dans la nuit stambouliote, sûr qu’il se foutait de moi, Bilger s’est toujours moqué de mon accent viennois — je ne pense pas avoir jamais chanté Johann Strauss à tue-tête, ni même siffloté ne serait-ce que le Pas des patineurs , déjà au lycée les cours de valse étaient une véritable torture, d’ailleurs la valse est la malédiction de Vienne et aurait dû être interdite après l’avènement de la République, en même temps que l’usage des titres de noblesse : cela nous épargnerait nombre d’affreux bals nostalgiques et d’atroces concerts pour touristes. Toutes les valses, sauf bien sûr la petite valse pour flûte et violoncelle de Sarah, le “thème de Sarah” qui était une de ces petites phrases mystérieuses, enfantines, fragiles, dont on se demandait où elle avait bien pu la dénicher et qui est aussi un endroit où il fait bon retourner, la musique est un beau refuge contre l’imperfection du monde et la déchéance du corps.
Le lendemain à Istanbul je me suis réveillé fringant, comme si de rien n’était, tant l’énergie de la ville et le plaisir de la parcourir effaçaient puissamment les effets de l’alcool ingurgité la veille, pas de maux de tête, pas de nausées, rien qui ne s’envolât d’un coup, Sarah et les souvenirs, nettoyés par le vent du Bosphore.
La petite valse est une drogue puissante : les cordes chaleureuses du violoncelle enveloppent la flûte, il y a quelque chose de fortement érotique dans ce duo d’instruments qui s’enlacent chacun dans son propre thème, sa propre phrase, comme si l’harmonie était une distance calculée, un lien fort et un espace infranchissable à la fois, une rigidité qui nous soude l’un à l’autre en nous empêchant de nous rapprocher tout à fait. Un coït de serpents, je crois que l’image est de Stravinski, mais de quoi parlait-il, certainement pas de valse. Chez Berlioz, dans son Faust , dans Les Troyens ou Roméo et Juliette , l’amour est toujours le dialogue d’un alto et d’une flûte ou d’un hautbois — il y a longtemps que je n’ai pas écouté Roméo et Juliette , ses passages saisissants de passion, de violence et de passion.
Il y a des lumières dans la nuit, sous les rideaux ; je pourrais tout aussi bien me remettre à lire, il faut que je me repose, je vais être épuisé demain.
À Graz sans doute avais-je mal dormi aussi, après le dîner en tête à tête, je me sentais un rien déprimé par la perfection de cette fille, sa beauté mais surtout sa facilité à disserter, à commenter, à exposer avec un naturel extraordinaire les connaissances les plus improbables. Étais-je déjà conscient de nos trajectoires si proches, ai-je eu l’intuition de ce qui s’ouvrait par ce dîner, ou me laissai-je guider par mon désir, en lui souhaitant la bonne nuit dans un couloir que je revois parfaitement, murs couverts d’un feutre marron, meubles en bois clair, abat-jours vert foncé, comme je me revois allongé ensuite sur le lit étroit les bras croisés sous la tête, soupirant en regardant le plafond, déçu de ne pas être à ses côtés, de ne pas découvrir son corps après avoir été charmé par son esprit — ma première lettre sera pour elle, me suis-je dit en pensant à mon voyage en Turquie ; j’imaginais une correspondance torride, mélange de lyrisme, de descriptions et d’érudition musicale (mais surtout de lyrisme). Je suppose que je lui avais raconté dans le détail le but de mon séjour stambouliote, la musique européenne à Istanbul du XIX eau XX esiècle, Liszt, Hindemith et Bartók sur le Bosphore, d’Abdülaziz à Atatürk, projet qui m’avait valu une bourse de recherche d’une fondation prestigieuse dont je n’étais pas peu fier et qui allait déboucher sur mon article à propos du frère de Donizetti, Giuseppe, comme introducteur de la musique européenne dans les classes dirigeantes ottomanes — je me demande ce que vaut ce texte aujourd’hui, pas grand-chose sans doute, à part la reconstruction de la biographie de ce singulier personnage presque oublié, qui vécut quarante ans à l’ombre des sultans et fut enterré dans la cathédrale de Beyoglu au son des marches militaires qu’il avait composées pour l’Empire. (La musique militaire est décidément un point d’échange entre l’Est et l’Ouest, aurait dit Sarah : il est extraordinaire que cette musique si mozartienne “retrouve” en quelque sorte son point d’origine, la capitale ottomane, cinquante ans après la Marche turque ; après tout il est logique que les Turcs aient été séduits par cette transformation de leurs propres rythmes et sonorités, car il y avait — pour emprunter le vocabulaire de Sarah — du soi dans l’autre.)
Je vais essayer de réduire mes pensées au silence, au lieu de m’abandonner au souvenir et à la tristesse de cette petite valse ; je vais utiliser une de ces techniques de méditation dont Sarah est familière et qu’elle m’expliquait, en rigolant un peu tout de même, ici à Vienne : essayons de respirer profondément, de laisser glisser les pensées dans un immense blanc, paupières closes, mains sur le ventre, singeons la mort avant qu’elle ne vienne.
Sarah à demi nue dans une chambre au Sarawak, à peine vêtue d’un débardeur et d’un short en coton ; un peu de sueur entre les omoplates et au creux des genoux, un drap repoussé, en bouchon, à la moitié des mollets. Quelques insectes s’accrochent encore à la moustiquaire, attirés par le battement du sang de la dormeuse, malgré le soleil qui perce déjà à travers les arbres. La long house s’éveille, les femmes sont dehors, sous le porche, sur la terrasse de bois ; elles préparent le repas ; Sarah perçoit vaguement les bruits d’écuelles, sourds comme des simandres, et les voix étrangères.
Il est sept heures de plus en Malaisie, le jour s’y lève.
J’ai tenu quoi, dix minutes sans presque penser à rien ?
Sarah dans la jungle des Brooke, les rajas blancs du Sarawak, la dynastie de ceux qui voulaient être rois en Orient et le sont devenus, tenant le pays pendant près d’un siècle, parmi les pirates et les coupeurs de têtes.
Читать дальше