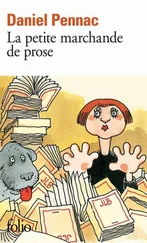*
NOTE À LISON
Ma chère Lison,
Là encore tu peux sauter le cahier suivant. Tu n’y trouveras que cette phrase, indéfiniment répétée. Violette était morte en effet. Et pour le garçon que j’étais, elle n’aurait pas dû mourir. Elle était sous ma protection, vois-tu. Toute la force que j’avais puisée dans sa vieille force avait fait de moi son protecteur naturel. Rien ne pouvait lui arriver tant que je vivais auprès d’elle. Elle est morte, pourtant. Elle est morte et j’étais là. Il n’y avait que moi. J’ai été le seul témoin de sa mort. Un après-midi que j’avais attrapé cinq truites en remontant le cours de la rivière tandis qu’elle m’attendait, assise sur son pliant de toile rouge (elle m’avait appris à pêcher les truites à la caresse, plaque-les bien contre la pierre et n’aie pas peur des serpents, les petites bêtes ne mangent pas les grosses), cinq truites que j’avais jetées vives dans son panier cet après-midi-là (c’était elle qui les tuait, d’un coup sec sur une pierre), elle est morte. À la sixième truite. Je l’ai trouvée, tombée de son pliant, suffoquant, cherchant l’air comme le poisson que je venais de lâcher en courant vers elle, et j’ai crié son nom, et j’ai frappé son dos, croyant qu’elle avait avalé quelque chose de travers, et j’ai dégrafé son corsage, et j’ai plongé ma chemise dans la rivière pour lui faire une compresse fraîche, et pendant tout ce temps elle courait après son souffle, happait l’air qui l’étouffait, l’air qui devait la sauver et qui maintenant l’étouffait, ses yeux stupéfaits par cette trahison de la vie, ses mains agrippées à mes bras comme ceux d’une noyée à la dernière branche, et ne pouvant me parler, pas même me dire qu’elle mourait, rien que ces doigts glacés, ces cris avalés, cette affreuse déchirure de la trachée, cette mort rauque et bleuissante, car elle mourait, nous le savions elle et moi. Violette je ne veux pas que tu meures ! C’était ce que je criais, pas au secours, pas à l’aide, Violette je ne veux pas que tu meures ! répété jusqu’à cette seconde où je ne me suis plus vu dans ses yeux, où ses yeux si proches n’ont plus rien regardé, cette seconde où elle a soudain pesé, dans mes bras, son poids de femme morte. Alors nous n’avons plus bougé. Son corps s’est vidé de tout l’air qui l’avait étouffé et j’ai laissé passer le jour. Quand Robert et Marianne nous ont trouvés, la truite vivait encore.
Une fois ramené par maman à la maison, je me suis enfermé dans ma chambre et me suis mis à remplir un cahier de cette seule phrase : « Violette est morte » répétée indéfiniment. C’était le cahier que tu as sous les yeux, le huitième de mon journal, et ce cahier une fois rempli j’en noircirais d’autres, tel était mon projet, tous les cahiers suivants, de cette phrase unique, Violette est morte, cahier après cahier, façon d’écrire sans respirer jusqu’à extinction de mes propres forces. À en juger par l’application de ma calligraphie c’était une résolution calme, Violette est morte, mon écriture d’aujourd’hui déjà, tout à fait maîtrisée, boucles, pleins et déliés, un rigoureux hurlement III eRépublique, de sages pages d’écriture au service d’une douleur atroce. J’ai hurlé Violette est morte jusqu’à ce que l’épuisement me fasse tomber le stylo de la main. Ce n’était pas la fatigue d’écrire, c’était d’avoir le ventre vide. Car j’avais entamé une grève de la faim. Maman n’était pas venue à l’enterrement de Violette, maman parlait de Violette morte comme elle le faisait de Violette vivante, maman, pensais-je, salissait la mémoire de Violette — je ne salis personne je dis ce que je pense ! — et j’avais entamé une grève de la faim pour ne plus vivre avec maman. J’ignorais alors que ma mère ne pensait pas, qu’elle faisait partie de la cohorte innombrable de ceux qui, « en leur âme et conscience », appellent « opinion », « conviction », « certitude, » et même « sentiment » et même « pensée », les sensations vagues et pourtant tyranniques qui arment leurs jugements. Violette était sournoise, Violette était vulgaire, Violette ne tenait pas sa place, Violette probablement volait, Violette était négligée, alcoolique, intempérante, Violette sentait, Violette devait finir comme ça, et moi je ne voulais plus vivre avec maman. La pension ou la mort, tel fut mon slogan. Et la grève de la faim mon moyen de pression.
*
14 ans, 11 mois, 3 jours
Mardi 13 septembre 1938
La grève de la faim, toi ? On en reparlera demain ! Elle se trompe. Je tiens le coup. Ce n’est pas si terrible, d’ailleurs. Je ne triche pas. Je ne mange pas en cachette. Quand j’ai trop faim, je bois un verre d’eau, comme on en a le droit avant la communion. À chaque repas, elle me ressert la même assiette, comme elle fait avec Dodo quand il n’aime pas ce qu’elle lui sert. Si tu crois que nous allons gâcher la nourriture ! Elle ne comprend vraiment rien. C’est intéressant, quelqu’un qui croit tout savoir et qui comprend si peu les gens. Mais je ne veux pas m’intéresser à elle. Je ne dirai plus jamais maman.
14 ans, 11 mois, 4 jours
Mercredi 14 septembre 1938
Je suis allé aux cabinets pour la dernière fois. Maintenant, je suis vraiment vide. Mon estomac (ou mes intestins ?) gargouille, parce que mon appareil digestif travaille inutilement. Quand on a vraiment faim, on dort en chien de fusil. On se referme sur son estomac. Comme si on le comprimait pour oublier ce vide. Dans la journée, on ne pense qu’à manger. La salive devient sucrée. On pourrait manger n’importe quoi, je crois. Dodo veut que je l’emmène avec moi en pension. Il dit qu’il ne restera pas seul ici.
14 ans, 11 mois, 5 jours
Jeudi 15 septembre 1938
Hier soir, j’ai mâché mon drap. Ce n’était pas tricher, c’était juste pour avoir quelque chose dans la bouche. Je crois que je le mâchais encore en m’endormant. Dodo en a profité pour me menacer. Il m’a fait jurer de l’emmener. Il m’a dit, si tu ne m’emmènes pas avec toi, je t’apporte tout ce qu’il y a de meilleur à manger et je le mange devant toi. Nous avons ri.
14 ans, 11 mois, 6 jours
Vendredi 16 septembre 1938
Ce matin, elle a voulu m’embrasser. J’ai sauté de mon lit. Je ne veux pas qu’elle me touche. Mais la tête m’a tourné et je suis tombé. Elle a voulu me relever, j’ai roulé sous le lit pour qu’elle ne m’attrape pas. Elle a dit que ce n’est pas en pension qu’elle allait me mettre mais chez les fous. Elle a ajouté d’ailleurs c’est de la comédie, tu manges en cachette, je t’ai vu ! Elle le répète tout le temps, pour se rassurer. C’est Dodo qui me l’a dit.
14 ans, 11 mois, 7 jours
Samedi 17 septembre 1938
La nourriture c’est de l’énergie. Je n’ai plus d’énergie. Enfin, je n’en ai plus pour mon corps. Pour ma volonté, ça va, rien n’a changé. Je ne remangerai et je ne reparlerai que quand elle aura dit oui à la pension. N’importe quelle pension, je m’en fiche.
Il ne faut pas que je reste couché. Il ne faut pas que je dorme. Il faut que je sorte. Il faut que je marche. Moins on mange plus on se sent lourd et plus les distances paraissent longues. Dans la rue, pour avancer je vais de réverbère en réverbère. Quand j’en atteins un, je m’arrête pour respirer, je regarde le suivant et je repars. Il faut que je fasse au moins dix réverbères par promenade. Dix à l’aller, dix au retour. C’est peut-être comme ça que je marcherai quand je serai vieux. En comptant les réverbères.
Читать дальше