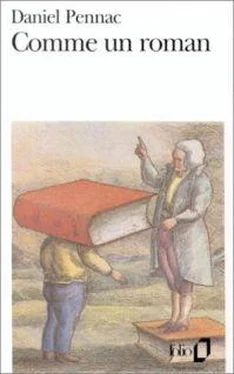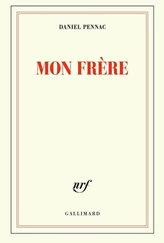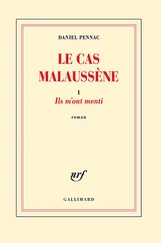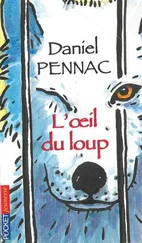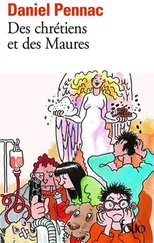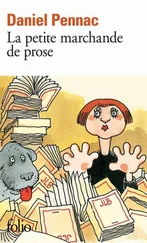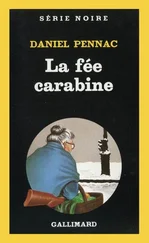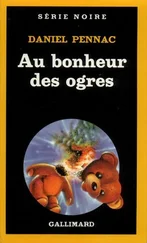Tout, nous faisons tout subir aux livres. Mais c'est la façon dont les autres les malmènent qui seule nous chagrine…
Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu de mes yeux vu une lectrice jeter un énorme roman par la fenêtre d'une voiture roulant à vive allure: c'était de l'avoir payé si cher, sur la foi de critiques si compétents, et d'en être tellement déçue. Le grand-père du romancier Tonino Benacquista, lui, est allé jusqu'à fumer Platon! Prisonnier de guerre quelque part en Albanie, un reste de tabac au fond de sa poche, un exemplaire du Cratyle (va savoir ce qu'il fichait là?), une allumette… et crac! une nouvelle façon de dialoguer avec Socrate… par signaux de fumée.
Autre effet de la même guerre, plus tragique encore: Alberto Moravia et Eisa Morante, contraints de se réfugier pendant plusieurs mois dans une cabane de berger, n'avaient pu sauver que deux livres La Bible et Les Frères Karamazov. D'où un affreux dilemme: lequel de ces deux monuments utiliser comme papier hygiénique? Si cruel qu'il soit, un choix est un choix. La mort dans l'âme, ils choisirent.
Non, quelque sacré que soit le discours tressé autour des livres, il n'est pas né celui qui empêchera Pepe Carvalho, le personnage préféré de l'Espagnol Manuel Vasquez Montalban, d'allumer chaque soir un bon feu avec les pages de ses lectures favorites.
C'est le prix de l'amour, la rançon de l'intimité.
Dès qu'un livre finit entre nos mains, il est à nous, exactement comme disent les enfants: «C'est mon livre»… partie intégrante de moi-même. C'est sans doute la raison pour laquelle nous rendons si difficilement les livres qu'on nous prête. Pas exactement du vol… (non, non, nous ne sommes pas des voleurs, non…) disons, un glissement de propriété, ou mieux, un transfert de substance: ce qui était à l'autre sous son œil devient mien tandis que mon œil le mange; et, ma foi, si j'ai aimé ce que j'ai lu, j'éprouve quelque difficulté à le «rendre».
Je ne parle là que de la façon dont nous, les particuliers, traitons les livres. Mais les professionnels ne font pas mieux. Et que je te massicote le papier au ras des mots pour que ma collection de poche soit plus rentable (texte sans marge aux lettres rabougries par l’étouffement), et que je te gonfle comme une baudruche ce tout petit roman pour donner à croire au lecteur qu'il en aura pour son argent (texte noyé, aux phrases ahuries par tant de blancheur), et que je te colle des «jaquettes» m'as-tu-vu dont les couleurs et les titres énormes gueulent jusqu'à des cent cinquante mètres: «m'as-tu lu? m'as-tu lu?» Et que je te fabrique des exemplaires «club» en papier spongieux et couverture cartonneuse affublée d'illustrations débilitantes, et que je te prétends fabriquer des éditions «de luxe» sous prétexte que j'enlumine un faux cuir d'une orgie de dorures…
Produit d'une société hyperconsommatrice, le livre est presque aussi choyé qu'un poulet gavé aux hormones et beaucoup moins qu'un missile nucléaire. Le poulet aux hormones à la croissance instantanée n'est d'ailleurs pas une comparaison gratuite si on l'applique à ces millions de bouquins «de circonstance» qui se trouvent écrits en une semaine sous prétexte que, cette semaine-là, la reine a cassé sa pipe ou le président perdu sa place.
Vu sous cet angle, le livre, donc, n'est ni plus ni moins qu'un objet de consommation, et tout aussi éphémère qu'un autre: immédiatement passé au pilon s'il ne «marche pas», il meurt le plus souvent sans avoir été lu.
Quant à la façon dont l'Université elle-même traite les livres, il serait bon de demander à leurs auteurs ce qu'ils en pensent. Voilà ce qu'en écrivit Flannery O'Connor, le jour où elle apprit qu'on faisait plancher des étudiants sur son œuvre:
« Si les professeurs ont aujourd'hui pour principe d'attaquer une œuvre comme s'il s'agissait d'un problème de recherche pour lequel toute réponse fait l'affaire, à condition de n'être pas évidente, j'ai peur que les étudiants ne découvrent jamais le plaisir de lire un roman*… »
* Flannery O'Connor, L'Habitude d'être (Editions Gallimard). Traduit par Gabrielle Rolin.
Voilà pour le «livre».
Passons au lecteur.
Parce que, plus instructives encore que nos façons de traiter nos livres, il y a nos façons de les lire.
En matière de lecture, nous autres «lecteurs», nous nous accordons tous les droits, à commencer par ceux que nous refusons aux jeunes gens que nous prétendons initier à la lecture.
1) Le droit de ne pas lire.
2) Le droit de sauter des pages.
3) Le droit de ne pas finir un livre.
4) Le droit de relire.
5) Le droit de lire n'importe quoi.
6) Le droit au bovarysme.
7) Le droit de lire n'importe où.
8) Le droit de grappiller.
9) Le droit de lire à voix haute.
10) Le droit de nous taire.
Je m'en tiendrai arbitrairement au chiffre 10, d'abord parce que c'est un compte rond, ensuite parce que c'est le nombre sacré des fameux Commandements et qu'il est plaisant de le voir pour une fois servir à une liste d'autorisations.
Car si nous voulons que mon fils, que ma fille, que la jeunesse lisent, il est urgent de leur octroyer les droits que nous nous accordons.
LE QU’EN LIRA-T-ON
(ou les droits imprescriptibles du lecteur)
Le droit de ne pas lire
Comme toute énumération de «droits» qui se respecte, celle des droits à la lecture devrait s'ouvrir par le droit de n'en pas user - en l'occurrence le droit de ne pas lire - faute de quoi il ne s'agirait pas d'une liste de droits mais d'un vicieux traquenard.
Pour commencer, la plupart des lecteurs s'octroient quotidiennement le droit de ne pas lire. N'en déplaise à notre réputation, entre un bon bouquin et un mauvais téléfilm, le second l'emporte plus souvent que nous aimerions l'avouer sur le premier. Et puis, nous ne lisons pas continûment. Nos périodes de lecture alternent souvent avec de longues diètes où la seule vision d'un livre éveille les miasmes de l'indigestion.
Mais le plus important est ailleurs.
Nous sommes entourés de quantité de personnes tout à fait respectables, quelquefois diplômées, parfois «éminentes» - dont certaines possèdent même de fort jolies bibliothèques mais qui ne lisent pas, ou si peu que l'idée ne nous viendrait jamais de leur offrir un livre. Elles ne lisent pas. Soit qu'elles n'en éprouvent pas besoin, soit qu'elles aient trop à faire par ailleurs (mais cela revient au même, c'est que cet ailleurs-là les comble ou les obnubile), soit qu'elles nourrissent un autre amour et le vivent d'unt façon absolument exclusive. Bref, ces gens-là n'aiment pas lire. Ils n'en sont pas moins fréquentables, voire délicieux à fréquenter. (Du moins ne nous demandent-ils pas à tout bout de champ notre opinion sur le dernier bouquin que nous avons lu, nous épargnent-ils leurs réserves ironiques sur notre romancier préféré et ne nous considèrent-ils pas comme des demeurés pour ne pas nous être précipités sur le dernier Untel, qui vient de sortir chez Machin et dont le critique Duchmole a dit le plus grand bien.) Ils sont tout aussi «humains» que nous, parfaitement sensibles aux malheurs du monde, soucieux des «droits de l'Homme» et attachés à les respecter dans leur sphère d'influence personnelle, ce qui est déjà beaucoup - mais voilà, ils ne lisent pas. Libre à eux.
L'idée que la lecture «humanise l'homme» est juste dans son ensemble, même si elle souffre quelques déprimantes exceptions. On est sans doute un peu plus «humain», entendons par là un peu plus solidaire de l'espèce (un peu moins «fauve») après avoir lu Tchékhov qu'avant.
Читать дальше