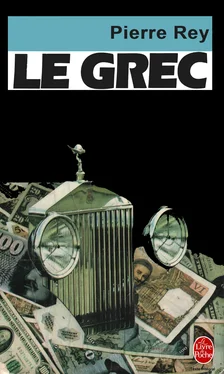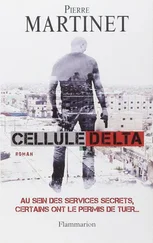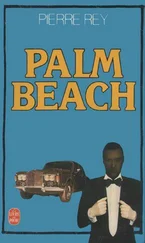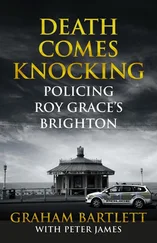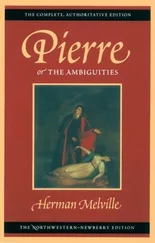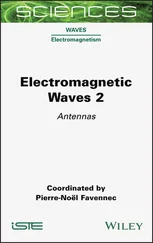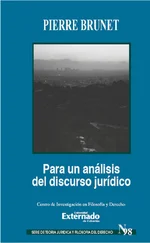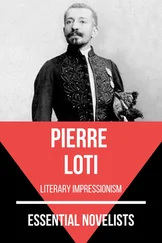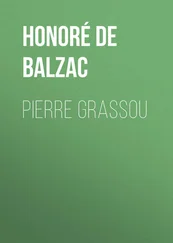— Ces types ont du génie !
— Attends ! Ne sois pas dégueulasse ! Pendant ce temps, il y a de pauvres poires d’Américains qui y sont restés !
— C’est la vie, non ?
— Oui, celle des autres. Mon frère, par exemple.
— Pardon, Scott.
— Ça va…
— Je suis désolée pour William. Mais quand on a les ambitions que tu as, il faut être réaliste. La guerre n’a jamais empêché les affaires. Tu fais l’idiot ou quoi ?
— Dès que l’Europe a été libérée par nos soins, on a bradé nos surplus. Là-bas, ils n’avaient plus un chantier naval debout. Qui s’est précipité pour acheter nos liberty-ships ?
— Les Grecs.
— Tu as gagné un paquet de lessive ! Tu peux même dire le Grec. À lui tout seul, Satrapoulos en a acheté vingt-cinq pour trois fois rien, une misère, douze millions de dollars. Et avec ça, vogue la galère ! D’artisan à qui on faisait la charité, il passait au rang des concurrents dangereux de nos propres transports pétroliers. Ses bateaux tournaient vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les équipages se relayaient nuit et jour.
— Et alors, c’est illégal ?
— Non. Mais ça agaçait nos propres armateurs. En 1947, on a fait une deuxième vente. Mais cette fois, nuance, il fallait être citoyen américain pour bénéficier de la manne.
— Vous n’étiez pas très sport envers lui. C’est sans doute ce que vous appelez le libre jeu de la concurrence ?
— Ne t’inquiète pas, il s’en est très bien sorti ! Un coup fumant ! Il a créé des sociétés américaines ou en a racheté d’autres qui étaient en faillite. Bien entendu, elles restaient majoritaires dans le nouveau holding, mais comme c’est lui qui les finançait en sous-main… Il leur balançait vingt-cinq pour cent des acomptes, gardait pour lui quarante-neuf pour cent des actions, et allez donc ! Il nous a encore eus d’une trentaine de liberty-ships !
— Il les a payés ou pas ?
— Quarante-cinq millions de dollars.
— Qu’avait-il à se reprocher ?
— Rien ! Mais entre-temps, ses bateaux qui marchaient à toute vapeur lui avaient peut-être rapporté cinquante fois plus !
— Ma parole, mais vous étiez jaloux !
— Quand on en a eu marre, on a lâché sur lui les types du Trésor. Première mesure, ils ont saisi dix-huit navires qui se trouvaient dans les eaux américaines…
— C’est élégant, bravo ! Dis donc Scott, qui vole qui dans ton histoire ? J’espère qu’il a pu récupérer ses cargos ?
— Tu penses s’il s’en foutait ! Ils étaient bons pour la casse, et avec ce qu’ils lui avaient déjà fait gagner ! C’est à ce moment-là qu’il a commis sa seule maladresse : il a eu le tort de se pointer à New York, pour la forme. On l’a coffré.
— Longtemps ?
— Hélas ! non, une nuit ! »
Peggy hurla de rire :
« Il vous a ridiculisés ! »
Scott retint à grand-peine un sourire. Quelle que soit la façon dont il ait tourné son récit, il n’y voyait qu’une conclusion possible : c’est vrai, jusqu’à présent, le Grec les avait toujours roulés ! Il eut assez d’humour pour raconter la suite :
« Ce n’est pas tout ! On l’a relâché le lendemain car la prison était envahie par une nuée d’avocats internationaux, niais on a maintenu les poursuites pour infraction à la législation des transports. On lui a imposé une transaction : mettre trente de ses navires sous pavillon américain de telle sorte que le trust ne puisse être contrôlé que par deux Américains, et plus par lui.
— Il a accepté ? »
Scott éclata de rire :
« Tout de suite !
— Pourquoi ris-tu ? C’est drôle ?
— Tu n’as pas entendu le plus beau ! Les deux Américains en question, tu sais qui ? Ses propres enfants dont il avait fait, à leur naissance, des citoyens des États-Unis !… Des gosses de sept ans présidents ! Et sous sa tutelle !
— Mais c’est fantastique ! Scott ! Tu n’es pas sport ! Tu devrais tirer ton chapeau !
— Pour ses funérailles. Tout a une fin. Maintenant, ils vont lui mettre de nouveaux bâtons dans les roues. Et à l’autre aussi, son beau-frère.
— Kallenberg ? Mais tu sais bien, je t’ai raconté ! Quand je t’ai connu, j’arrivais de chez lui à Londres. Une soirée démente, complètement dingue, où on avait fêté Noël la nuit du 15 août avec neige, chasseurs alpins et tout le tremblement !
— Et pendant ce temps, moi, je t’attendais comme une cloche !
— Évidemment, tu ne me connaissais pas encore ! Ce que tu devais souffrir… Tu sais, c’est marrant, parce que Kallenberg et Satrapoulos se détestent. Et ça se complique du fait que tous deux haïssent leur belle-mère, la vieille Mikolofides.
— Mais c’est du Sophocle !
— Tu ne crois pas si bien dire ! Dans cette famille, il n’est question que de savoir qui réussira à éliminer les autres ! La matrone fait des coups en douce à ses deux gendres, leurs femmes ne pensent qu’à se faucher leurs maris…
— Belle mentalité…
— Deux connes sans intérêt, sans parler de la troisième qui est, paraît-il, complètement louf, une espèce de mystique à la gomme. Mais ça, on s’en fout non ?… Tu ne vas pas te priver d’un allié pareil ? Viens seulement une heure chez Nut, au moins, tu verras sa tête !
— Il y sera vraiment ?
— Bien sûr ! Chaque fois qu’elle divorce, Nut n’oublie jamais d’inviter tous ses anciens amants !
— Elle était avec lui ?
— Toujours, entre deux mariages. Une vieille histoire.
— Elles sont parfaites, tes amies…
— Est-ce que je m’occupe des tiens ? Nut est fabuleuse ! On se dit tout depuis dix ans, on ferait n’importe quoi l’une pour l’autre.
— Qui te prouve qu’il viendra ?
— Tu as l’air d’oublier que, pour l’amour de toi, je suis capable de rendre des points à Mata-Hari ! Tu as entendu parler de la Menelas ?
— Comme tout le monde, oui… Elle chante ?
— Non, barbare, elle joue du piano !
— Le rapport ?
— J’avais appris par Nut que Satrapoulos était un admirateur inconditionnel de la Menelas. Elle a fait savoir au Grec que son idole serait de la fête. Voilà, c’est tout.
— Elle va pas jouer au moins ? Je déteste le classique !
— Prétentieux ! Tout l’argent de ton parti ne suffirait pas à payer un seul de ses récitals !
— Quel idiot j’ai été d’avoir loupé toutes mes leçons de piano !
— Si tu n’étais idiot que pour ça ! Heureusement que je suis là, salaud ! »
Elle se rua sur lui avec impétuosité, le cloua sur le lit et lui mordit la bouche. Avec Scott, c’était la seule façon d’avoir le dernier mot.
Après avoir déposé Rita, Raph et Amore regagnaient le Pierre en taxi.
« J’ai faim…, dit Dun.
— Tu es une vraie bête… Manger, dormir, baiser…
— Tu connais quelque chose de mieux ? »
Amore, en gloussant, saisit la balle au bond :
« Mieux que baiser ? Non.
— Et bouffer ?
— Ça dépend quoi. Je suis un raffiné, moi. Tu ne peux pas comprendre, tu es un barbare. Je te vois très bien dans les hordes d’Attila, serrant ton morceau de viande entre tes cuisses. Allons, bon, voilà que je m’excite !… »
Le taxi s’arrêta devant l’hôtel. Dans le hall, Raph salua Léon, le portier de nuit français qu’il connaissait depuis des années. Léon, mieux que quiconque à New York, savait d’une façon précise avec qui chacun de ses clients finissait ses nuits. Et parmi ceux-ci, Raph était l’homme qui se faisait apporter des collations aux heures les plus tardives, quatre ou cinq heures du matin, pour deux, trois, ou même quatre personnes, cela dépendait. Un jour, Léon l’avait même trouvé debout, goûtant au Dom Pérignon qu’il lui avait commandé, alors que trois filles superbes étaient nues dans le lit, songeant à peine à remonter le drap sur leur poitrine. Léon, qui était marié depuis vingt ans à une Américaine observant le rite mormon, avait détourné les yeux pudiquement. À plusieurs reprises, Dun lui avait proposé des sommes folles pour qu’il consente à égrener ses souvenirs devant un magnétophone. Mais Léon aimait son travail et ne voulait rien commettre qui pût risquer de l’en priver. Il connaissait également Dodino depuis longtemps et savait parfaitement à qui il avait affaire.
Читать дальше