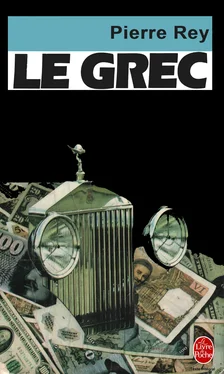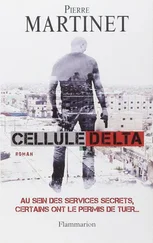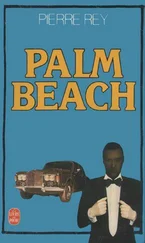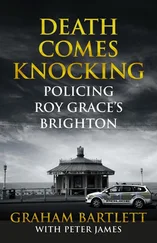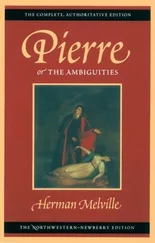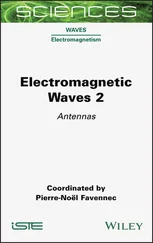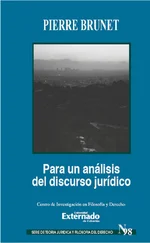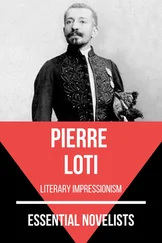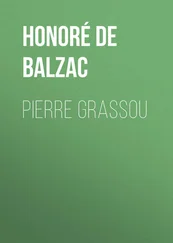« Vous allez voir comme c’est bon. »
On ne voyait pas l’eau, mais une montagne de mousse dont l’odeur luttait avec celle de Tina. La vieille femme, complètement nue, se sentait sans défense aucune. D’ailleurs, elle n’avait pas envie de se défendre. Elle flottait, douce, moelleuse, soumise, comme un enfant qui s’abandonne parce qu’il sait qu’on va le gâter. Cette blonde avait l’air si gentil… Elle s’assit sur le rebord de la baignoire, soutenue par Maria qui la fit glisser dans l’océan de mousse. Tina se souvint qu’il lui était arrivé de se laver, autrefois. Encore faut-il savoir pour qui on a envie d’être propre : quand on vit seule, ça sert à quoi, d’être propre ? Une fois dans l’eau, elle se détendit, retrouvant en une sensation fugitive la jouissance d’un bain de mer qu’elle avait pris, à l’âge de vingt ans, dans une Méditerranée tiède… Brusquement, la densité de l’eau lui enlevait le poids de son corps, lourd et douloureux. C’était quelque chose d’ineffable. Maria, doucement, lui savonnait le dos, luttant contre sa répugnance, se donnant une foule de raisons pour ne pas s’enfuir.
« Les cheveux maintenant.
— Aussi ? »
Sur les touffes grises, sèches et cassantes, Maria étendit du shampooing.
« Ça pique ! dit la vieille.
— Fermez les yeux. Laissez-vous aller. C’est bon… »
C’est vrai, que c’était bon. Tina sentait les doigts légers de l’infirmière lui masser habilement le cuir chevelu. C’était comme une caresse.
« Où sommes-nous ? demanda-t-elle.
— À Athènes.
— Pour quoi faire ?
— Nous allons repartir pour Paris. Vous allez voir… Vous avez des robes splendides qui vous attendent. Et des bijoux.
— Des bijoux ? Où ça ?
— Ici, dans cette maison.
— J’aimerais avoir des bijoux. Mais je ne me souviens plus à quoi ça sert…
— À être belle.
— Je ne suis pas belle. Je suis vieille. Comment vous appelez-vous ?
— Maria. »
Maria eut un sentiment de triomphe. En une heure à peine, elle avait presque apprivoisé la bête sauvage. Cette victoire lui donnait raison. Elle prétendait que la douceur peut obtenir des miracles, aussi bien sur les animaux que sur les humains.
« Moi, je m’appelle Tina, dit la vieille. Athina.
— Je sais, madame Satrapoulos, je le sais.
— Qu’est-ce que vous me voulez ?
— Relevez votre jambe… là… encore un peu…
— Qu’est-ce que vous me voulez ? »
Plus tard, drapée dans un peignoir éponge d’un blanc immaculé, Tina avait regardé les robes que Maria avait sorties d’une armoire :
« Voulez-vous les essayer ?
— Moi ?
— Mais oui, vous ! Elles sont pour vous. »
L’infirmière en avait étalé quelques-unes sur le lit. La vieille s’en approcha, méfiante — une belette flairant un piège. Elle s’enhardit à les toucher. Sa main, sèche et maigre, saisit le tissu, le froissa, l’abandonna. Elle fit une seconde tentative, le caressant cette fois. Puis elle souleva une robe et la porta à hauteur de ses yeux, marmonnant une litanie muette. Et vint le triomphe de Maria : sans qu’elle ait proféré le moindre mot d’encouragement pour l’inciter à faire ce geste qu’elle espérait, la paysanne usée, magiquement, retrouva l’obscur réflexe de toute femme devant une parure. Elle se drapa de la robe, s’approcha de l’armoire à glace et se regarda longuement, étonnée que le miroir veuille bien lui renvoyer cette image oubliée, déchue, cette image qui se prononçait au passé mais qui s’écrivait toujours Athina Satrapoulos. Doucement, Maria s’approcha, lui saisit la main :
« Je vais vous aider à la passer. »
La vieille se laissa ôter son peignoir, sans réagir, mais quand elle fut nue, elle détourna la tête du miroir. Habilement, Maria lui passa la robe. Tina restait rigide comme un mannequin.
« Ne bougez pas ! », dit Maria. Elle courut à un tiroir, en sortit quelques bibelots et lui enroula un collier de perles autour du cou.
« Asseyez-vous sur le lit maintenant… Les chaussures… »
Elle en prit une paire, au hasard, les lui enfila sans difficulté et déclara :
« Allez vous regarder… Allez-y ! Vous êtes superbe ! »
Elle la guida devant l’armoire. Tina resta muette, les yeux rivés sur ce reflet qui ne lui disait rien. Après s’être longuement contemplée sans que son visage eût la moindre expression, elle eut une réaction qui déconcerta Maria : elle éclata de rire, un rire qui la plia en deux et lui fit venir les larmes aux yeux. L’infirmière, inquiète, lui demanda :
« Elle ne vous plaît pas ? »
La vieille rit de plus belle. Elle s’arrêta net, dévisagea Maria d’un air sévère et lui dit, l’index tendu, accusateur :
« Où sont mes vêtements ?
— Mais… madame Satrapoulos… Ils étaient si usés… Je les ai jetés. »
Tina éructa :
« Vous les avez jetés ! » Et elle marcha droit sur elle, menaçante.
Figée, mal à l’aise, Maria ne trouva rien d’autre à dire ou à faire qu’étendre les bras devant elle en un geste apaisant. Elle reçut immédiatement un coup de griffe qui lui brûla la joue. Machinalement, elle porta la main au-dessous de sa pommette, la retira et regarda ses doigts pleins de sang, avec stupeur. Dépassée, elle éleva la voix en direction de la pièce mitoyenne :
« Pouvez-vous venir une minute… Vite ! »
Elle ne voulait pas montrer à Tina à quel point l’avait affolée la brutalité de son attaque, et en même temps, elle n’avait pu s’empêcher de crier le dernier mot : « Vite ! » La porte s’ouvrit. Apparurent les deux hommes, probablement restés aux aguets. Ils se saisirent de Tina, lançant à l’infirmière, avec une pointe de moquerie :
« Alors ? Qu’est-ce qu’on en fait maintenant ? »
Interdite, Maria, se tenant toujours la joue, jeta un regard étonné à la vieille qui essayait furieusement de briser l’étreinte de ceux qui la maintenaient :
« Ce n’est pas bien ce que vous avez fait là, madame Satrapoulos… Non… Ce n’est vraiment pas bien… »
« Pourquoi me laissez-vous seule si longtemps ? »
Le Grec réprima un mouvement d’impatience. Il était vanné et se demandait avec inquiétude comment tournerait la vilaine affaire déclenchée par Kallenberg. S’il venait passer deux heures sur son bateau, ce n’était pas pour subir des reproches alors qu’en temps ordinaire il ne pouvait déjà pas tolérer la moindre question.
« Pourquoi ne m’avez-vous pas accompagné à Londres ? Je vous l’avais proposé.
— Vous savez bien que j’ai horreur de ce genre de soirée. Vous semblez soucieux ? Avez-vous des ennuis ? »
Il posa les yeux sur Wanda. Elle avait l’air sincère :
« Des masses. »
Il lui prit la main et la baisa doucement :
« Vous avez bien fait de ne pas venir. Tout s’est terminé d’une façon épouvantable. Vous lirez les journaux… Parlez-moi plutôt de vous. Qu’avez-vous fait ?
— Oh !… Moi… Je me suis ennuyée… J’ai lu… J’ai regardé la mer… »
Il gardait sa main dans la sienne. Elle était avec lui comme un enfant et, pourtant, elle était et resterait jusqu’à la fin des temps, tant que les hommes auraient une mémoire, la plus belle femme du monde. Il la connaissait depuis cinq ans déjà et faisait tout pour qu’elle ne lui échappe pas, la comblant de cadeaux qui la laissaient indifférente, envoyant un avion la chercher au bout de la terre, pour qu’elle revienne à bord. Au début, Lena avait manifesté de l’humeur. Puis elle s’était habituée, considérant à son tour la Deemount non plus comme une personne vivante, mais comme une légende prisonnière d’un argonaute. Pas une rivale, un mythe. Il est vrai que les relations de Socrate et de la Deemount se situaient à un niveau que n’aurait pu comprendre l’homme de la rue. Il l’avait aperçue à New York, à la fin de la guerre, alors qu’elle sortait de son hôtel pour s’engouffrer dans une voiture. Ce jour-là, il s’était juré de l’approcher, de la conquérir et de la garder captive. Il avait appris qu’elle gardait un appartement à l’année au Waldorf, où elle séjournait entre deux vagabondages. À prix d’or, il avait loué la résidence contiguë à la sienne, au dernier étage de la plus haute tour du palace. Fiévreusement, il avait consulté le Prophète pour savoir à quel moment il avait le plus de chances de ne pas se faire éconduire en l’abordant.
Читать дальше