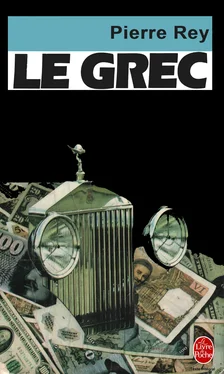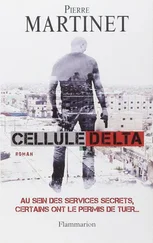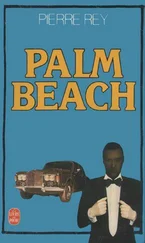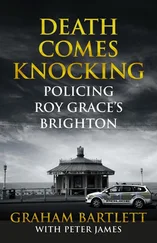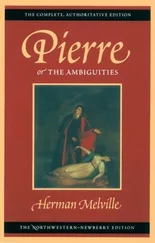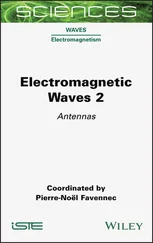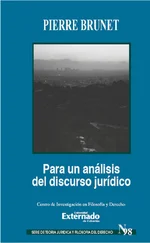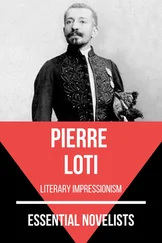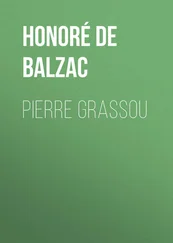Elle buvait du lait dans sa cabane lorsque les deux hommes avaient fait irruption. Visiblement, c’étaient des étrangers, elle aurait pu s’en apercevoir à vue de nez, même s’ils n’avaient pas porté leurs blouses-blanches : qu’est-ce qu’ils voulaient ? En grec, ils lui avaient dit que tout était prêt, qu’elle n’avait plus qu’à les suivre. Les suivre ? Où cela ? Il y avait plus de trente ans qu’elle n’avait quitté sa montagne. Sans ménagements, elle les avait priés de sortir, arguant que c’était l’heure de son dîner et que, justement, elle était en train de boire un bol de lait. Ce discours n’avait pas eu l’air de les convaincre. Ils l’avaient écoutée, gravement, immobiles comme des statues, hochant la tête d’un air compréhensif et bienveillant. Devant ce mutisme souriant, Tina s’était emportée et les avait menacés d’un tisonnier. Depuis longtemps déjà, sa pensée consciente ne fonctionnait que par à-coups, petite étincelle suffisante pour éclairer ses problèmes journaliers, mais pas assez vivace pour comprendre l’incompréhensible. Parfois, son esprit se fixait des journées entières sur un minuscule sujet, par exemple, une écharpe, que son mari lui avait offerte et dont le souvenir lui permettait de ruminer pendant des heures, fermée à tout ce qui n’était pas ce souvenir, plus puissant, riche et coloré dans sa réminiscence que la réalité banale dont il était nourri. Quand, par extraordinaire, une voisine engageait la conversation avec elle, Tina suivant sans peine le déroulement de son propos, jusqu’à ce qu’elle décroche, l’espace de quelques secondes suffisantes pour que son interlocutrice s’en aperçoive :
« Hein ? Qu’est-ce que vous dites ? »
La voisine répétait et Tina reprenait sans peine le fil de son discours. Avec le temps, ces absences s’étaient allongées, laissant place à la rumination permanente ou à de longs moments de vide, sans notion de durée, d’où elle ne sortait que pour accomplir les gestes nécessaires à sa survie : manger, dormir, froid ou chaud, les bêtes. Des signaux, beaucoup plus que des images, des mots ou des idées. Elle ne voyait absolument pas où ces hommes voulaient l’emmener, ni pourquoi : elle était bien dans sa maison et n’avait nulle envie d’en bouger. D’ailleurs, existait-il quoi que ce soit en dehors de cette maison ?
Elle s’était mise en colère, leur ordonnant de partir. En réponse à sa rage, ils avaient échangé un signe et s’étaient avancés, un à droite, l’autre à gauche. Ne sachant sur qui frapper en premier, elle avait eu une seconde d’inattention dont ils avaient profité pour la désarmer et la saisir sous les deux bras. Elle avait hurlé :
« Mes chèvres ! Je ne leur ai encore rien donné à manger ! »
Ils l’avaient rassurée, lui jurant qu’« on » allait s’en occuper, et l’avaient entraînée au-dehors. Le soir tombait, il faisait doux, l’horizon était rose et on voyait déjà les premières étoiles. Chose curieuse, aucun de ses voisins n’avait passé la tête, malgré ses cris. Impuissante, pratiquement soulevée par les deux hommes, elle avait longé la douzaine de maisons sans qu’aucun secours ne lui vienne. Quand la dernière masure fut dépassée, elle vit une grande voiture blanche sur les flancs de laquelle était peinte une immense croix rouge. Bien entendu, elle savait ce qu’était une ambulance et sa fureur avait redoublé :
« Lâchez-moi ! Vous êtes fous ! Je ne suis pas malade ! Lâchez-moi ! »
Une grande jeune femme blonde, à l’air très doux, en blouse blanche elle aussi, lui avait fait un large sourire amical, comme si elle avait été heureuse de la voir. Elle lui avait dit :
« Nous ne vous voulons pas de mal, madame Satrapoulos… au contraire ! Simplement vous offrir un beau voyage et quelques jours de vacances… Nous savons que vous en avez besoin. »
Tina s’en était étranglée. Son esprit fonctionnait au summum de sa puissance, comme si les interminables heures de vacuité l’avaient préparé à se défendre mieux, le moment venu. Elle hurla :
« Des vacances ! En ambulance ! Lâchez-moi ! »
Elle avait crié le nom d’Alexandre, son mari, auquel elle n’avait pourtant pas pensé depuis des années. Comme s’il avait pu la protéger… De force, les deux hommes l’avaient hissée à l’intérieur de la fourgonnette, faisant la moue devant son odeur de vieille femme sale. Seule, la blonde n’avait pas paru s’en soucier, la cajolant, lui murmurant des mots rassurants. Puis, pendant qu’un troisième larron faisait démarrer la voiture, elle lui avait tendu un verre rempli d’alcool :
« Buvez… Cela vous détendra. »
Tina avait feint d’obéir, avait avalé une gorgée et craché le tout au visage de la femme. Elle n’avait pas semblé s’en offusquer, lui disant simplement :
« Oh ! Madame Satrapoulos ! Comme c’est vilain ! »
Ce qui avait eu le don de ranimer la rogne de Tina. Toutefois, dans le regard de cette blonde, quelque chose l’alerta. Derrière elle, dans son dos, elle sentait que les types en blouse blanche se livraient à une action mystérieuse, qui la concernait. Le temps de détourner la tête, l’un d’eux l’avait entravée, sans perdre pour autant son exaspérant sourire. L’autre lui attrapait les jambes, malgré son dégoût visible. La femme lui retroussa la manche du haillon qu’elle portait et lui enfonça une seringue dans le bras. « Salope ! » eut le temps de crier Tina. Puis, les visages de ces gens s’estompèrent, elle les voyait flous, ils se démultipliaient, voilà maintenant qu’ils étaient six. Six, comment était-ce possible, dans une ambulance aussi petite ? Engourdie, Tina se laissa aller…
« Qu’est-ce qu’elle pue, la vieille ! C’est dégueulasse !
— On voit bien que vous ne vous êtes jamais occupé de vieillards. Laissez-moi seule avec elle maintenant. Je vais me débrouiller…
— Si vous avez besoin de nous, on est à côté. Vous n’avez qu’à appeler.
— C’est ça. D’accord… »
L’infirmière attendit que les deux employés soient sortis de la pièce. Puis elle commença la besogne la moins ragoûtante, surmontant sa nausée : déshabiller Tina.
Par la porte entrouverte de la chambre, elle entendait couler l’eau dans la salle de bain. Elle avait forcé sur les sels odorants, aux senteurs de pin et de lavande, sans grand espoir toutefois qu’un seul nettoyage put suffire à débarrasser Tina de cette odeur violente, agressive et animale qu’elle devait dégager depuis des années. La chair de ses jambes, une fois dépouillée des vieux bas rapiécés, apparut, douce, étonnamment blanche, sauf aux endroits où la crasse formait des plaques presque solides à force d’être épaisses. La vieille grogna quelque chose, ouvrit les yeux, n’eut pas l’air de comprendre où elle était. Elle articula le mot « soif ». Maria, avec un grand sourire, lui tendit un verre plein d’un liquide glacé, au goût sucré :
« Buvez, madame Satrapoulos. Après, nous irons faire vôtre toilette. »
Tina engloutit le contenu de son verre et, machinalement, fit un mouvement destiné à aider la blonde qui lui ôtait sa robe.
« Vous allez me laver ? lui demanda-t-elle.
— Oui, répondit Maria, vous laver d’abord, pour que vous soyez belle et parfumée. Ensuite, nous ferons bien d’autres choses. Des choses agréables, que vous aimez. Vous allez voir…
— Des choses que j’aime ? Qu’est-ce que j’aime ?
— Quand vous les ferez, vous les aimerez. Relevez-vous maintenant… Marchez… Je vous aide… Votre bain est prêt. »
Maria avait passé ses bras sous les aisselles de Tina, la soutenant, sans cesser de lui sourire ou de lui parler, malgré l’insupportable odeur qui émanait d’elle. Après tout, la vieillesse était peut-être un naufrage, mais pourquoi serait-elle un péché ? Elle-même, un jour, si Dieu le voulait, serait vieille. Qui la laverait ? Les deux femmes s’arrêtèrent sur le seuil de la salle de bain. Tina jeta à Maria un regard interrogateur. L’infirmière hocha la tête d’un air rassurant :
Читать дальше