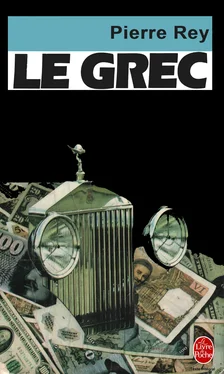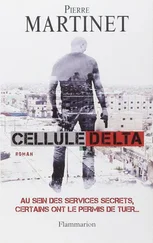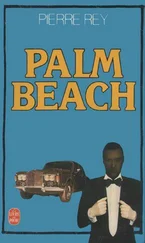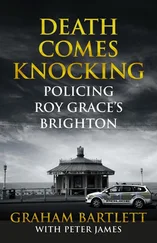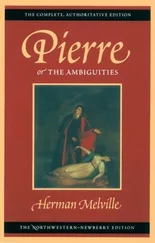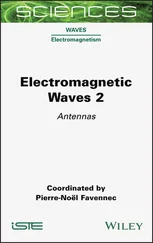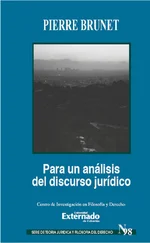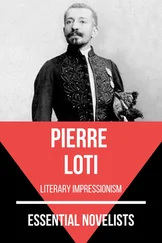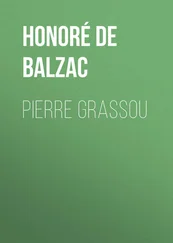Mais déjà, l’Écossais s’était avancé et, d’un seul coup de poing, étendait raide le jeune homme. Tout de suite, il eut deux autres garçons sur le dos. On avait compris maintenant qu’il y avait danger, que chacun devait se défendre pour éviter le pire. Partout, des grappes de combattants se formaient, pendant qu’un petit clan, entraîné par Percy, prenait les étages d’assaut, fracassant le mobilier, crevant les toiles de maîtres, brisant tous les objets à sa portée. Kallenberg, qui se trouvait avec Dun au moment où les événements avaient débuté, entrouvrit la porte de son bureau : ce fut suffisant pour que deux hommes happent son bras. Il se sentit tiré dans le couloir, plongea en avant, roula sur lui-même et, dans un même mouvement, décocha un terrible coup de pied à son adversaire le plus proche. Le type poussa un hurlement et pivota sur sa jambe cassée avant de s’écrouler. Déjà debout, Barbe-Bleue, sans prendre le temps d’évaluer les dégâts provoqués, lançait à la volée une manchette qui atteignit le deuxième homme en plein visage, lui fracassant simultanément la cloison nasale et l’arcade sourcilière gauche. Pétrifié, Dun vit Kallenberg se ruer à son bureau, en renverser un tiroir pour en extraire un automatique Beretta.
« Vous n’allez pas faire ça…, chevrota-t-il en bégayant…
— Je vais me gêner ! », répondit Barbe-Bleue en se précipitant vers la porte.
Il y eut deux détonations et Kallenberg hurla à Dun :
« Appelez les flics, crétin ! Qu’est-ce que vous attendez ? »
En tremblant, Dun composa le 999 sur le cadran et, d’une voix égale, dont il était sûr qu’elle ne pouvait pas venir de lui, s’entendit dire :
« Ici, la résidence de M. Kallenberg, sur le Mail, au 71… »
Pendant ce temps, la horde continuait son saccage. Après son acte irraisonné, le comte s’était vu assailli par trois envahisseurs. Sur sa lancée, il avait essayé de faire front. Mais, vidé de toute énergie par sa décharge première, il avait fui de toute la vitesse de ses petites jambes dans un escalier qui l’avait mené tout droit à une terrasse, cul-de-sac où se terraient déjà plusieurs couples et quelques musiciens. À sa suite, les malfrats firent leur apparition, décidés à se venger sur cette proie facile qui ne pouvait plus leur échapper. Les yeux fous, von Lupus cherchait une issue, des secours, suppliant les témoins de lui venir en aide. Les femmes crièrent, les hommes les rassurèrent, mais personne ne broncha. Ses trois poursuivants avançaient sur lui en demi-cercle, l’acculant de plus en plus contre le parapet de la terrasse. Bientôt, le comte sentit la pierre du garde-fou contre son dos : il ne pouvait pas aller plus loin. Avec terreur, il entendit :
« Prenez-le par les jambes et foutez-le en bas ! »
Il voulut crier, gigoter, faire quelque chose, prier Dieu, appeler sa femme, n’importe quoi pour éviter la chute. Au lieu de cela, il restait debout, le corps secoué de longs tremblements, pétrifié par la peur. Il sentit que des mains s’abattaient sur lui, le soulevaient. Ses jambes quittèrent le sol et il s’accrocha, dans un réflexe ultime, aux cheveux de l’un de ses tortionnaires. L’autre se dégagea d’une secousse. De sa main libérée, il empoigna l’angle du parapet. Il avait maintenant les deux jambes au-dessus du vide, les fesses aussi, et le tronc. Dans un brouillard, il entendit une voix de femme hurler : « Ne faites pas ça ! Ne le lâchez pas ! Remontez-le ! »
Le « remontez-le » lui parvint decrescendo, car il avait déjà basculé de l’autre côté. Il sentit son corps heurter quelque chose, s’y agrippa de tous ses muscles, lâcha prise et glissa, inerte, sur les branches du sapin qui ployèrent sous son poids, libérant dans leur mouvement élastique les derniers paquets de neige.
À l’instant où il s’écrasait sur le trottoir, Wise, qui avait entendu les coups de feu, sifflait dans ses doigts pour donner le signal de la retraite. À quelques secondes près se passa alors une chose horrible. Le lord écossais, qui ne voulut pas s’avouer vaincu, gisait sur le sol, maintenu par deux adversaires. Sa résistance même, et son acharnement à se battre, firent se déchaîner ses adversaires, meurtris par ses coups et exaspérés par sa force physique. L’un d’eux sortit de sa poche un couteau à cran d’arrêt. L’Écossais roula sur lui-même pour parer le coup qu’il sentait venir, n’offrant qu’une cible mouvante.
« Tiens-le bien ! », jura entre ses dents celui qui tenait la lame.
Le deuxième homme s’arc-bouta, pesant de tout son poids sur le sternum de l’Écossais. L’autre, d’un geste vif, releva le kilt au-dessus des cuisses, et, à travers le slip, lui trancha le sexe. Le châtré eut un cri abominable et se tordit. Percy, qui passait par-là, balança un méchant coup de pied à son homme de main, l’empoigna aux épaules, groggy, le releva et cria : « Calte ! »
Au moment où ils sortaient, Kallenberg tira sur eux à trois reprises et les manqua. Les invités, toujours dans le salon, pétrifiés, écoutèrent décroître le bruit de la cavalcade alors que s’élevaient les mugissements des sirènes de Police secours. Dodino était penché sur la comtesse, lui tapotant les joues, circonspect comme un pêcheur de crevettes tâtant la peau d’une baleine morte. Les premiers agents firent irruption dans le salon dévasté, jonché de bouteilles brisées, d’éclats de bois. Au pied de l’estrade, quelqu’un avait vomi. Des femmes sanglotaient. Les hommes, hébétés, leur bredouillaient des mots de réconfort, qui ne voulaient rien dire. Un groupe s’était formé autour de l’Écossais, que des agents fendirent pour charger la victime sur une civière et l’emporter vers un hôpital. Sur la moquette, l’emplacement libéré apparut, rouge de sang. Blême, défait, les yeux brillants, son arme toujours à la main, Kallenberg, debout au milieu de la pièce, dit à un brigadier qui s’était approché de lui :
« Là-haut… Dans le couloir… J’en ai tué un. »
Le petit Spiro venait de rentrer ses chèvres dans l’étable. La nuit tombait. En général, il retournait chez lui plus tôt, mais la noire s’était blessée au sabot de la patte antérieure gauche. Il avait dû la porter, impatienté de la voir traîner lorsqu’il la reposait sur le sol. Il s’était aussi attardé sur la colline, couché sur le dos, un brin de paille entre les dents, regardant le ciel bleu et dur pendant des heures, jusqu’au vertige, comme si sa contemplation avait pu lui fournir des réponses aux questions qu’il se posait. La vie d’un jeune berger est toute simple : les bêtes, la nourriture, le sommeil. Encore faut-il que rien ne vienne troubler cet ordre immuable et séculaire. Et Spiro était troublé. Il se demandait le sens des événements dont il avait été le témoin, cherchant dans sa mémoire d’enfant des signes qui auraient pu lui servir de références : il n’en trouvait pas. Ce va-et-vient de voitures dans un village où il n’en passait jamais, ces hélicoptères venus il ne savait d’où pour repartir sans laisser de traces l’intriguaient et le plongeaient dans une sorte de sourde inquiétude. L’inconnu fait peur.
Il avait bien essayé, à deux ou trois reprises, de poser des questions à son oncle, mais apparemment, ce dernier ne voulait pas lui répondre. Pourquoi ? L’esprit ailleurs, il donna un tour au loquet de la porte de l’enclos aux chèvres, et entra dans la pièce aux murs crépis où son oncle et lui prenaient leurs repas. Parfois, l’oncle faisait une soupe chaude, mais la plupart du temps, ils se nourrissaient de quelques olives, d’un morceau de fromage blanc et d’oignons crus. Deux fois par an, on tuait un chevreau dont on faisait rôtir des quartiers entiers dans l’âtre. Sur la grosse table de bois, deux gobelets, l’un, pour l’homme, plein d’un vin épais au goût de résine, l’autre, pour l’enfant, de lait. Spiro, encouragé par son oncle, avait tenté de tremper les lèvres dans le vin : malgré son désir de se montrer viril, il avait dû recracher la mixture, sa gorge refusant de la laisser passer. Peut-être, quand il serait grand, arriverait-il à la boire ? Il s’assit à la gauche de son oncle. La phrase sortit de sa bouche malgré lui, sans que sa volonté y soit pour quoi que ce soit :
Читать дальше