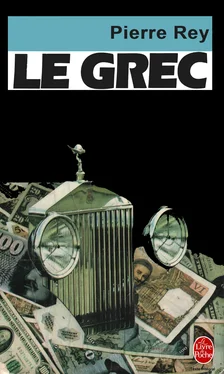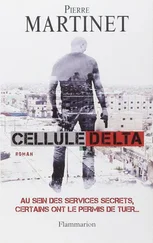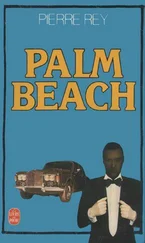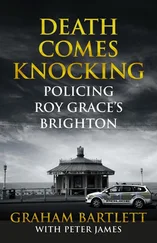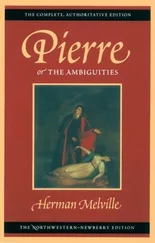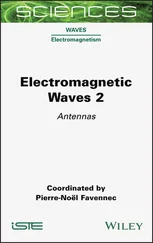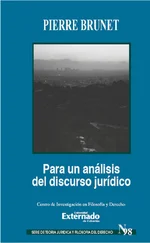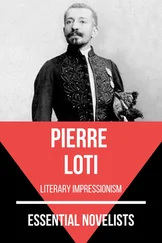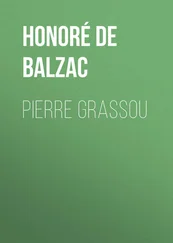Quand, fut venu le moment de repartir pour Londres, Janet, qui avait eu le coup de foudre pour New York, dit à Christopher :
« Pourquoi ne pas vivre ici ? Tu ouvrirais une nouvelle banque !
— Chérie, tu es fantastique ! Je n’osais pas te le proposer ! »
Ce fut aussi simple. Ils tombèrent dans les bras l’un de l’autre et achetèrent, le jour même, un splendide hôtel sur Park Lane. Deux ans plus tard naissait Peggy. En se réveillant à la clinique, sa mère, qui l’avait prise dans ses bras, s’écria avec horreur :
« Quelle affreuse chose ! Elle n’a pas l’air d’un bébé, mais d’une petite vieille ! C’est épouvantable, je l’ai eue trop tard ! »
Comme Janet venait d’entrer dans sa vingt et unième année, sa phrase eut le don de provoquer un immense éclat de rire parmi les infirmières et les médecins. Née dans une Rolls empaquetée dans un matelas de dollars, Peggy, de toute éternité, était destinée à être ritzy, selon la célèbre expression bostonienne désignant ainsi l’élite digne de faire du Ritz une espèce de résidence secondaire naturelle et à vie. Peggy n’allait pas tarder à justifier les espoirs placés sur sa tête. À deux ans déjà, elle avait son nom cité dans la chronique de Charlie Knickerbocker :
Peggy Nash-Belmont, écrivait-il, est une blondinette adorable aux immenses yeux verts qui ne cillent pas sous le regard d’un homme. Elle m’a pourtant autorisé à la prendre dans mes bras, le temps de lui donner un peu de bouillie car Peggy, aurais-je oublié de vous le dire, fêtait hier son deuxième anniversaire.
À cinq ans, Peggy, prise en main par sa mère, emportait son premier concours hippique. À huit ans, elle achevait un livre de poèmes dont la première partie, en vers libres, était un péan à la nature, et la seconde, en alexandrins, une déclaration d’amour à son poney favori, Jolly Beaver . À dix ans, elle avait son premier vrai chagrin d’amour, pour les yeux bleus d’un aviateur ayant osé, malgré les promesses qu’il lui avait faites, épouser une horrible fille brune de douze ans son aînée. Malgré cette déception, la vie s’était écoulée comme un conte de fées, dans des résidences somptueuses aux façades rappelant les hôtels français du XVIII esiècle, des parcs sublimes, des parterres de fleurs peuplés de jardiniers souriants, et des longues voitures noires d’apparat, conduites par des chauffeurs assortis, à la casquette galonnée. Ou alors, pendant, la période des vacances, sur d’immenses plages désertes, parce que privées, dans l’ambiance raffinée et irréelle de goûters d’enfants, de nurses autrichiennes aux longues jupes amidonnées, blondes, angéliques, sereines. Peggy avait eu dès sa naissance une nurse française, Anne-Marie, et nul n’aurait su dire si ses premiers balbutiements avaient été émis en anglais ou en français, en quelque sorte, ses deux langues maternelles. Ce qui était remarquable chez cette petite poupée blonde extrêmement douée, c’était le sérieux presque effrayant qu’elle apportait à toutes ses activités. Cela amusait fort son père, qui l’escortait régulièrement aux concours hippiques. Il disait d’elle avec fierté : « Elle est née sur une selle. » Et en fait, Peggy, à l’âge de six ans, damait facilement le pion, sur un parcours de jumping, à des enfants qui en avaient douze. On ne pouvait s’empêcher de la montrer du doigt avec admiration et attendrissement lorsque, sanglée dans sa veste de tweed cintrée, minuscules culottes de cheval et petit chapeau rond, elle traînait son poney avec les gestes chevronnés d’un jockey professionnel.
Un drame était survenu lors de sa quatrième année. Un jour d’avril, sa mère, qui s’était absentée pendant trois semaines, était revenue à la maison avec un bébé sur les bras. En souriant, elle avait dit à Peggy : « Regarde ta petite sœur. Elle s’appelle Patricia. » Peggy, que personne n’avait cru devoir prévenir de l’événement, avait fixé sa mère d’un air dur, incrédule, accusateur. Puis, elle avait éclaté en sanglots, tourné les talons et était partie en courant dans sa chambre, pour se jeter dans les bras de Coody, son ours en peluche. Son père l’y avait suivie, assez inquiet, tentant de lui expliquer qu’avoir une petite sœur était la chose la plus merveilleuse qui pouvait arriver à une petite fille. Mais, devant son air buté, il avait dû battre en retraite, après avoir promis de lui offrir un chien.
Dès le lendemain, « l’équipe » de Peggy, comportant déjà Jolly Beaver, l’ours Coody et Pamela, une immonde poupée en haillons, s’était enrichie de Sammy, un scoth-terrier noir de trois mois. Seul changement au train-train quotidien, Pamela fut rebaptisée Patricia et, très souvent, rouée de coups. En dehors de ce transfert passionnel, l’incident Patricia, en apparence, semblait oublié. Pourtant, deux mois plus tard, Peggy faisait une fugue. Dans la résidence familiale, le téléphone avait sonné. Une grosse voix d’homme avait expliqué à Janet Nash-Belmont : « Ici, le poste de police de Central Park. On a trouvé une petite fille. On ne comprend pas bien son nom, mais elle a donné ce numéro de téléphone. Est-ce qu’elle est à vous ? » Janet était arrivée au commissariat à la vitesse du vent, toute pâle. Un type en uniforme lui avait raconté : « Elle s’est tranquillement arrêtée près de moi, et elle m’a dit que sa nurse s’était perdue. » Le soir même, Anne-Marie était renvoyée dans ses foyers. Dès que Peggy avait su écrire, elle avait commencé la rédaction d’un journal personnel où voisinaient ses impressions, ainsi que des caricatures de ses gouvernantes et de ses précepteurs. À peine savait-elle lire, qu’elle dévorait Le Petit Lord Fauntleroy et Les Aventures de Tom Sawyer. À huit ans, elle raconta à sa mère qu’elle avait beaucoup aimé l’histoire du monsieur qui voulait se jeter du haut d’une falaise pour une dame.
« De quelle falaise parles-tu ? »
Plus tard, l’ayant pressée de questions, Janet, abasourdie par une telle précocité, avait compris que Peggy venait de lire Le Joueur de Dostoïevski. « Mais, lui demanda-t-elle, as-tu bien compris tous les mots ? — Oui, répondit la fillette, tous, sauf roulette. »
À douze ans, elle avait lu quatre fois Autant en emporte le vent, lorsque éclata le coup de tonnerre : ses parents divorçaient. Désemparée, Peggy ne comprit pas très bien, ou plutôt, refusa de comprendre. Pourtant, deux ans plus tard, lorsque sa mère épousa Arthur Erwin Beckintosh, elle eu le cran de lui offrir un bouquet de fleurs, juste après la cérémonie. Ensuite, elle s’enferma dans sa chambre et pleura vingt-quatre heures d’affilée. Lorsqu’elle eut enfin les yeux secs, ce fut pour aller vivre avec sa mère à Merrywood, en Virginie, où son beau-père possédait la plus belle propriété des rives du Potomac. À la fin de l’hiver, on quittait Merrywood pour la résidence d’été de Greenwood, en Nouvelle-Angleterre, pour faire de la voile et nager des journées entières sur les plages d’Arthur Erwin Beckintosh.
Mais chaque dimanche, et durant la moitié des congés scolaires, c’était la magie : Peggy et Patricia couraient se jeter dans les bras de leur père, qu’elles idolâtraient. À leurs yeux éblouis, Christopher Nash-Belmont était le dieu possédant le don de créer le plaisir à longueur de temps. Il aimait par principe tout ce que les deux fillettes adoraient, et se faisait un devoir de leur apprendre à apprécier tout ce qui le passionnait. Avant tout, il appliquait la règle d’or de Rabelais dans l’abbaye de Thélème : « Fais ce que voudras. » Mieux, il les encourageait à oser tout ce qui était habituellement interdit, grimper aux arbres, livrer des batailles de tartes à la crème, monter à vélo sans toucher au guidon. Dans son délire de père gâté et amoureux, il lui arrivait même de les emmener à Wall Street et de les faire asseoir à la place du caissier de sa banque. Quant aux gouvernantes, elles ne pouvaient que prendre un air pincé devant Pat et Peggy engloutissant régulièrement d’énormes ice-creams cinq minutes avant le dîner. Les années n’avaient pas entamé la passion de Christopher pour Peggy. Aujourd’hui encore, les cadeaux somptueux qu’il lui faisait étaient célèbres à New York, à tel point qu’Arthur Erwin, pour ne pas être en reste, avait dû se piquer au jeu et rivaliser, par prodigalités interposées, avec les folies du père. Peggy recevait ces présents avec la sérénité de l’habitude, sans les désirer vraiment, bien qu’ils lui fussent, avec le temps, devenus indispensables. À force de recevoir sans rien avoir à demander, elle avait éprouvé le désir de se situer en faisant abstraction de son nom et de sa fortune, car on évalue sa puissance par ce qu’on prend, non par ce qu’on vous donne.
Читать дальше