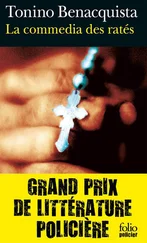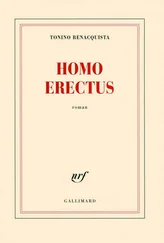— Il ne s’était jamais remis de la mort de son père. Thierry avait toujours souffert d’une peur de l’abandon, d’un manque de protection. Il a longtemps cherché une image paternelle à laquelle s’identifier.
Ce qu’il n’avait jamais supporté chez Anne, c’était sa façon d’infantiliser l’individu, ou pire, de le considérer comme un sujet d’étude qui ferait d’elle une sorte d’entomologiste passionnée par ses raisonnements qu’elle assenait comme des verdicts. Pendant les dîners, parfois même les week-ends à la campagne, elle restait à l’affût d’une interprétation psychanalytique des événements de la journée allant du crash aérien au pot de moutarde égaré. Elle savait faire passer son entourage pour de sympathiques petits êtres trahis par leur impitoyable inconscient. Blin s’amusait à placer de faux lapsus dans la conversation — « manger le chat » au lieu de « changer le mât » — pour la voir entrer en état de combustion spontanée ; la logorrhée qui s’ensuivait aurait mérité de petites publications à compte d’auteur. N’était-ce pas cette même Anne qui, un soir, avait dit, au détour d’une phrase : « Ma mère était catholique, et mon autre père était protestant. »
— D’ailleurs la mère de Thierry ne s’est jamais remise de la disparition de son mari. Plus rien n’a été pareil.
Hypothèse intéressante. Anne ne s’y était jamais risquée devant Blin en personne. Étrange situation que de s’entendre résumer un drame familial dont il n’avait, lui-même, jamais eu conscience. La perte de son père avait été douloureuse, mais jamais il n’avait eu le sentiment qu’elle les avait rendus bancals, sa mère ou lui.
— La question est de savoir si tout ça peut ouvrir des pistes sur sa disparition, dit Paul.
— C’est forcément à mettre en corrélation. Thierry avait peur du travail d’analyse. Ça l’aurait sans doute aidé à passer cette crise.
Anne avait cherché plus d’une fois à le pousser vers le divan ; un intarissable prosélytisme qui allait bien avec le personnage. J’ai procédé autrement, Anne. Il est encore trop tôt pour savoir si je me suis réussi, mais au moins, j’aurai essayé. Quelle tête ferait-elle à cette seconde précise si Paul lui avouait en bloc qu’il avait changé de visage, de nom, de métier, de domicile, de femme, qu’il avait organisé sa disparition, et qu’il se retrouvait là, devant elle, à l’écouter claironner des choses comme : « Thierry avait peur du travail d’analyse. » Anne n’avait aucun scrupule à s’ingérer dans la vie d’autrui, à anticiper sur son devenir. Elle se contentait d’une ou deux grilles de lecture avec lesquels elle tricotait toutes les certitudes dont elle aurait besoin jusqu’à la fin de sa vie. Chercher le prévisible en chacun, c’était nier l’irrationnel de tous, leur poésie, leur absurdité, leur libre arbitre. Certaines folies échappaient à toute logique, et la plupart, comme celle de Thierry Blin, n’étaient pas répertoriées dans le grand livre des pathologies.
Entre deux gorgées de ce verre du souvenir — un punch assez relevé — Paul s’arrêtait sur certains visages. À chaque regard, à chaque mouvement de tête, à chaque nouvelle apparition, il s’attendait à être foudroyé par les yeux écarquillés de celui qui reconnaîtrait l’ombre de Blin derrière ses traits.
À force de parler de lui, on allait finir par le voir partout.
En attendant, il passait brillamment le test, son heure de vérité n’avait pas encore sonné. Depuis qu’Anne s’était jetée dans les bras d’une autre amie de Nadine — Mireyo, ou un prénom bizarre dans ce genre-là, Blin l’avait à peine connue — il pouvait enfin faire le décompte, lent et méthodique, de ceux qui avaient pris la peine de se déplacer jusqu’ici pour évoquer sa mémoire.
Il repéra, entre autres, le jeune encadreur qui avait repris sa boutique en compagnie de Mme Combes et de divers clients du Cadre bleu. Paul fut presque touché de les savoir présents, surtout le médecin, prospère et sympathique, brillant, d’une politesse rare, et qui n’avait jamais payé le montage d’une vitrine pour son colloque sur la médecine du travail. Hormis ce petit groupe qui ne se mélangeait pas aux autres, il y avait Roger, l’homme qui l’avait initié à l’encadrement, au Louvre. Paul se demanda comment il avait eu vent de la réunion et s’approcha de lui, le salua en jouant la pure politesse, tendit son verre pour trinquer. Roger était un véritable encadreur, de ceux pour qui c’est un art auquel on consacre une vie. Il n’était éloquent que dans l’exercice de sa fonction, le reste du temps, il écoutait, timide, comme ce soir-là, face à Paul Vermeiren. Le cousin Clément était présent aussi, un des derniers vestiges d’une famille sans trop de racines. Blin n’avait jamais connu les confitures d’une grand-mère, les bagarres avec des cousins de province. Les repas de Noël n’avaient jamais excédé quatre personnes. Clément, fils de l’unique frère de sa mère, avait vécu au Vietnam jusqu’à l’âge de dix-huit ans, puis à Djibouti jusqu’à ses trente-cinq, ils ne s’étaient pas parlé plus de trois fois depuis son retour. Paul remarqua la présence, parfaitement injustifiée, de Jacques et Céline, couple de voisins de la rue de la Convention. Thierry avait disparu , et ce simple mot donnait du relief au fait de l’avoir connu ; le relent de soufre méritait le détour. Blin était-il tombé dans une crevasse ? Blin avait-il été kidnappé, exilé, séquestré par une secte, zigouillé par des joueurs de poker affiliés au milieu ? Blin avait-il refait sa vie ailleurs ? Cruelle ironie, il resterait dans les mémoires pour avoir quitté le paysage sans la moindre explication. Devenir un fait divers était le plus sûr moyen de ne jamais être oublié.
Tiens, le coiffeur… Le coiffeur est venu…
Paul ne se doutait pas que le coiffeur était l’homme le moins rancunier du monde. Un jour où il passait devant le Cadre bleu, Blin l’avait insulté pour avoir jeté son paquet de cigarettes par terre. Il était entré dans une colère noire : les gens capables de faire ça étaient des êtres inférieurs sans la moindre réflexion sur l’existence, sur autrui ; ils étaient condamnés à mourir puérils, le chemin à parcourir étant désormais trop long. L’homme l’avait écouté, interdit, et lui avait fait des excuses que Blin, dans sa fureur, n’avait pas su entendre. Une rage vite transformée en gêne ; plus jamais il n’était retourné dans son salon. Aujourd’hui, le coiffeur était là, le verre du souvenir en main. Paul ne résista pas à l’envie d’aller lui parler.
— Je me présente, Paul Vermeiren, j’étais un client de la boutique de Thierry Blin, mais je n’habite pas le quartier.
— Jean-Pierre Maraud, on était collègues. Je veux dire, des commerçants du coin.
Il saisit une poignée de cacahouètes et les happa toutes d’un coup.
— Quelle genre de commerce ?
— J’ai un salon de coiffure.
— Je ne les fréquente pas beaucoup, dit-il en caressant son crâne lisse.
Maraud, peu intrigué par la présence de Paul, essayait d’écouter, à quelques pas de là, les anecdotes de Mme Combes.
— Et vous le coiffiez ? insista Paul.
— Il y a longtemps, oui, mais il y a eu une petite fâcherie, un truc stupide, j’avais jeté un papier dans la rue et il ne m’a plus jamais adressé la parole.
— Il l’a sans doute regretté, vous savez. Peut-être qu’il n’osait plus passer devant votre boutique parce qu’il se sentait coupable.
— Il avait eu raison de pousser un coup de gueule. Je me suis demandé pourquoi il m’arrivait de jeter des choses à terre. Était-ce parce que je n’avais aucune conscience du bien commun et que je me foutais de la propreté des rues ? Était-ce parce que j’imaginais un employé de la voirie passer derrière moi ? Ou tout simplement parce ce que ça n’est pas interdit chez nous, une raison bien suffisante pour ne pas s’en priver ? Je n’ai pas réussi à me situer dans une de ces catégories, mais la peur de me retrouver dans toutes m’a donné une sacrée leçon. J’avais, comme il le disait, du chemin à parcourir, cette affaire de papier par terre a été un déclencheur, une prise de conscience. Aujourd’hui, quand je vois un type jeter quoi que ce soit dans la rue, j’ai pitié de lui. Je me fais une haute idée du respect de la collectivité. Grâce à Thierry Blin.
Читать дальше