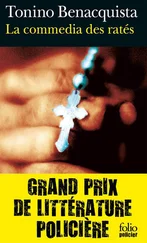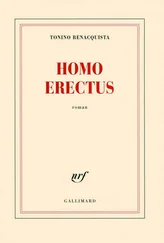Le matin de son entrée en clinique, il avait quitté l’appartement de Convention en laissant quelques bijoux de valeur dans un tiroir, un café encore tiède sur un coin de table, un livre ouvert sur une table basse, une fenêtre entrouverte. Rien qui donne à penser qu’il avait préparé une sortie.
La suite se déroulait selon un scénario qu’il n’avait cessé de réécrire jusqu’à sa version la plus aboutie. Prévenue par la concierge — étonnée par l’amoncellement du courrier — Nadine ouvrait l’appartement avec le double que Thierry lui avait laissé, puis se rendait au commissariat pour déclarer sa disparition. Elle remplissait le formulaire, donnait le signalement le plus précis possible sans oublier les signes particuliers — la cicatrice dans l’aine droite en forme de V qui l’intriguait et la repoussait à la fois — et leur laissait une photo récente, sans doute la grande en noir et blanc qu’elle avait faite pour sa série de portraits. Le Service des Disparitions prenait le relais, appelait les hôpitaux, l’institut médico-légal, le médecin et le dentiste du disparu, visitait son appartement et interrogeait quelques-uns de ses amis, peut-être aussi des clients du Cadre bleu. Vermeiren connaissait les chiffres : sur trois mille disparus par an en région parisienne, 5 % des cas n’étaient jamais élucidés. Il avait réuni tous les atouts pour faire partie de ces cent cinquante-là et tomber dans la catégorie V.R. — Vaines Recherches — jusqu’à la fin des temps.
*
Paul Vermeiren aurait pu sortir vingt-quatre heures après l’opération ; il avait préféré passer une nuit de plus à la clinique, inquiet de se retrouver livré à lui-même sans savoir qui il était vraiment. Joust, satisfait de ce qu’il avait vu sur le visage de son patient, lui proposa un rendez-vous dès le lendemain — « J 3 » selon son mode de calcul — pour enlever les fils des paupières supérieures, et un deuxième, J 7, pour les paupières inférieures. Ils ne se reverraient qu’en J 15 pour ôter les agrafes dans la bouche, le menton et les pommettes. En plus des bandages qui lui couvraient entièrement le visage, Joust lui conseilla de porter d’ici là une cagoule de compression afin d’éviter tout risque sur la zone frontale. Avec sa tête de film fantastique, il repassa par le service des admissions et demanda un taxi.
— Pour quelle adresse ?
— 4, allée des Favorites, à Cholong-sur-Cèze.
Il précisa à l’infirmière, qui s’en foutait : c’est chez moi .
*
— Vous y serez bien.
Cette simple phrase de l’agent immobilier, trop prosaïque pour être malhonnête, l’avait décidé. À quoi bon rater une occasion d’être bien quelque part, et pourquoi pas dans un pavillon de grande banlieue qui ressemblait beaucoup à un coin de campagne, une bicoque entourée d’arbres, hors du village et hors du temps. Trois fenêtres donnaient sur une ruelle que personne n’empruntait, les autres sur un jardin dont on ne pouvait deviner les limites. Un saule pleureur, deux sapins, un magnifique érable, un cerisier. Paul s’y sentait comme un hobereau vieillissant accroché à sa terre pour se consoler d’avoir perdu ses autres privilèges. La maison était saine et juste à sa mesure : un salon avec une cheminée qui prenait tout un mur, une chambre avec vue sur le jardin, une cuisine qui sentait le bois et la cendre.
Thierry Blin, lui, avait toujours aimé la ville. Il voulait être au cœur, là d’où partent toutes les artères, et si les battements de ce cœur se faisaient parfois trop entendre, il lui était impensable de vivre ailleurs. Le monde était sous ses fenêtres, il se voyait comme le mille de la cible. Il craignait que quelque chose lui échappe et pensait avoir assez d’énergie pour se confronter à la grande ville. Depuis que le matériau humain était devenu son gagne-pain, il recherchait le contraire ; après des jours et des nuits de filatures, de tension nerveuse et de désordre, il avait besoin de remettre sa tête à l’endroit, loin de la folie des hommes.
Paradoxe : depuis son exil, il n’avait jamais senti Paris si proche. S’il pouvait voir la Ville lumière scintiller du haut du clocher de Cholong, à quoi bon l’avoir à ses pieds ? Comment ressentir une ville quand on est pris dans sa tourmente ? Babylone n’est Babylone que si on peut la contempler de loin.
Allongé dans une chaise longue, le nez en l’air, un plaid sur les genoux et un livre en main, il attendait en paix la fin de sa convalescence. Il retourna à la cuisine pour surveiller un gratin de légumes et ouvrir son courrier où le nom de Vermeiren était imprimé partout. Paul Vermeiren existait pour le social. La machine s’était enclenchée d’elle-même, il suffisait de respecter quelques règles, de ne rien demander à personne, de ne jamais se plaindre. Dès lors, un citoyen de plus ou de moins passait inaperçu aux yeux de tous.
— C’est flamand comme nom ? lui demanda l’employé des Télécom en installant la ligne.
— D’origine hollandaise, assez lointaine.
Il n’avait plus sur le visage que quelques sparadraps au coin des tempes. Se regarder bien en face ne lui posait plus de problème. Les lentilles marron lui donnaient un regard plein, profond, en harmonie avec ses cheveux et son grain de peau — le regard qu’il aurait dû avoir depuis toujours. La forme de ses yeux, à peine plus fendue, faisait sourire le visage entier et le rendait malicieux. Plus que tout, Paul était fier de son menton ; il lui donnait une légitimité, une assurance qui lui avaient toujours manqué, un surcroît de virilité, une finition inattendue qui le débarrassait à tout jamais d’une barbe de camouflage. Il prenait plaisir à se raser, à masser ses joues parfaitement glabres. Tous les trois jours, il passait son crâne à la tondeuse, un geste maîtrisé d’emblée. Par endroits, la cicatrisation le démangeait et lui rappelait qu’il y avait une couture ; pas de quoi se prendre pour un monstre. De jour en jour, il voyait son visage s’affirmer dans le miroir. Parfois, il retrouvait Blin sous ses traits, à l’improviste, l’espace d’une mimique. Un Blin lisse, anamorphosé, tellement lointain. Même l’éclat dans son œil avait presque disparu, comme une toute petite braise prête à s’éteindre sous un voile de cendre.
Paul Vermeiren avait du temps pour tout, du goût pour tout, la cuisine, la promenade, la lecture sous un plaid, les soirées au coin du feu, les nuits devant des films, les grasses matinées interminables, les bains chauds à toute heure. Sa convalescence lui laissait même le temps de mettre à l’épreuve de vieux rêves et d’élucider certains mystères. Il s’était toujours demandé comment un objet pouvait tenir en l’air, tourner sur lui-même, dessiner une courbe, faire une révolution complète, et revenir dans la main. Il n’était peut-être pas trop vieux pour accomplir des miracles. Chaque jour il apprenait à lancer le boomerang, seul, un livre ouvert à ses pieds. Il voyait dans ce geste un mélange de science, d’élégance, d’humilité face à la nature, une façon de rendre hommage aux mystères de la physique qui fascinaient déjà les primitifs. Comme un véritable aborigène, Paul prenait le temps de ressentir la qualité du vent, de s’en faire un ami, de contourner les arbres par d’habiles paraboles. Pendant les heures d’apprentissage où son boomerang se perdait dans la nature, il arpentait des kilomètres de pré avec la patience d’un sourcier. Les gens du coin le saluaient, le regardaient lancer, amusés — une lubie ? La toute dernière mode parisienne ? — sans se douter un instant que cet homme reproduisait un geste rituel bien antérieur à l’existence des tracteurs, des vaches, peut-être même de l’herbe verte.
Читать дальше