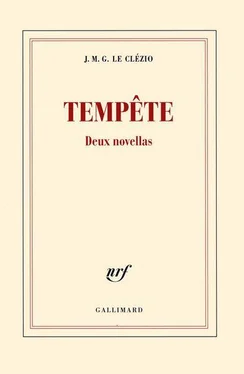Jean-Marie Le Clézio - Tempête. Deux novellas
Здесь есть возможность читать онлайн «Jean-Marie Le Clézio - Tempête. Deux novellas» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Paris, Год выпуска: 2014, ISBN: 2014, Издательство: Éditions Gallimard, Жанр: Современная проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Tempête. Deux novellas
- Автор:
- Издательство:Éditions Gallimard
- Жанр:
- Год:2014
- Город:Paris
- ISBN:978-2070145355
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Tempête. Deux novellas: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Tempête. Deux novellas»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
J. M. G. Le Clézio
Tempête. Deux novellas — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Tempête. Deux novellas», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
C’est cela qu’elles me montrent, quand elles sortent de l’eau, les vieilles femmes de la mer. Elles titubent sur les rochers, les bras un peu écartés, leurs corps luisants noirs gonflés au ventre et à la poitrine, elles n’ont plus la légèreté de l’eau, la jeunesse de l’eau, le vent les pousse, le ciel leur pèse, le soleil fait larmoyer leurs yeux. Elles s’essuient, elles se mouchent entre leurs doigts, elles crachent dans les flaques. Elles renversent sur une roche plate leur récolte de tourillons et d’ormeaux, les oursins, leurs mains ont les ongles cassés et noirs, la peau de leur cou est ridée comme celle des tortues. Elles ne parlent pas. Elles ôtent leurs combinaisons de caoutchouc, je les aide en tirant sur les manches, sans rire. Leur peau sent la mer, leurs cheveux gris sont frisés par l’humidité. Une fois j’ai dit : « Eh bien, on dirait que moi je suis née sous la mer, mes cheveux sont frisés naturellement. » Puis elles rassemblent leurs affaires dans leurs poussettes, je crois que ce sont les mêmes poussettes dans lesquelles elles ont promené leurs filles quand elles étaient jeunes mamans. Elles s’en vont à la queue leu leu sur la route côtière, sans faire attention aux voitures des touristes, aux curieux qui s’arrêtent pour les prendre en photo. Elles retournent chez elles. Sur la terre, elles sont lourdes, maladroites, on dirait de vieilles mouettes engluées, mais moi je les trouve belles. J’aime surtout la vieille Kando. Quand je rentre à la maison, maman me regarde sévèrement. Brown a essayé une fois de me faire la morale, mais je l’ai regardé froidement, et depuis que je me suis moquée de lui il se méfie. Il a intérêt à la fermer.
J’oublie de parler de Monsieur Kyo. C’est comme cela que je l’appelle, mais son vrai nom c’est Philip. C’est un étranger. Je l’ai rencontré la première fois sur le port, il était sur la digue en train de pêcher. Il a tout un attirail pour ça. Un matériel d’expert. Une canne en fibre de verre, des moulinets perfectionnés. Une boîte en plastique rouge avec toutes sortes d’hameçons, du fil, des bouchons, des plombs, et avec ça un petit couteau en inox avec plusieurs lames et des ciseaux pliants, un coupe-ongles. Il a une boîte en métal pleine d’asticots et de crevettes pour appât. J’étais venue ce soir-là sur la digue pour voir le départ du ferry, et il était là tout seul. Moi j’aime bien les étrangers, je suis allée lui parler. C’est une chose que je ne fais pas d’habitude, et pourtant ce soir-là j’ai eu envie de parler à cet inconnu. Il avait cette drôle d’allure, un peu engoncé et maladroit dans ses habits de la ville, et tout son attirail de pêcheur. C’était assez bizarre, et pour tout dire, vraiment nouveau.
« Vous êtes super équipé, vous vous y connaissez en pêche ! » Il m’a regardée comme s’il cherchait à comprendre si je me foutais de lui. Il n’a même pas eu l’air étonné que je parle bien sa langue.
« Ah oui, a-t-il dit enfin. Mais l’équipement ne fait rien à l’affaire. » Il a avoué, avec un petit sourire, et ça m’a bien plu parce que c’était la première fois qu’un homme disait cela sans honte : « Je n’y connais rien, c’est la première fois que je pêche. »
Il a un visage sombre, la peau un peu grise, des cheveux frisés, assez longs, pour ce que je peux voir parce qu’il est coiffé d’une casquette de base-ball sur laquelle est marqué 1986. Il est costaud, avec des épaules larges et de grandes mains. Il est évident qu’il n’est pas habillé pour la pêche, avec son complet-veston et ses souliers noirs vernis. Il n’a pas l’air non plus d’un touriste.
« Vous êtes venu ici pour apprendre à pêcher, c’est ça ? » Il me regarde sans sourire. J’imagine que ça doit lui paraître bizarre, cette gamine de treize ans qui lui pose des questions. Il lance la ligne qui siffle avant que les plombs ne touchent l’eau, à une dizaine de mètres de la digue. Il dit : « Et c’est vous qui allez m’apprendre à pêcher ? » Il est sûrement ironique, mais je ne me laisse pas décourager. Je lui réponds : « Eh bien, je pourrais. Je m’y connais bien. Je pêche depuis que je suis toute petite. » J’ajoute, pour avoir l’air intelligente : « Vous savez, ici, il n’y a rien d’autre à faire. » Il mouline sans répondre, je dis : « Il faut connaître les endroits. Par exemple, ici, vous n’attraperez rien. Il n’y a pas assez de fond, votre hameçon va se prendre dans les algues. » À cet instant précis, comme un fait exprès, sa ligne s’accroche dans le fond. « Voyez ? je lui dis. Vous vous êtes pris dans le fond. » Il jure et tire de toutes ses forces sur la canne, qui est prête à se casser. « Attendez, je vais le faire. » Je prends la canne et je la balance de chaque côté, plutôt doucement, je me mets à quatre pattes sur le quai et je tire à petits coups, comme sur un animal en laisse. Au bout d’un instant, la ligne se décroche, et il rembobine. L’hameçon sort de l’eau avec une touffe d’algues. L’homme sourit enfin. Il a l’air satisfait. « C’est vrai, vous n’avez pas menti. » Il est devenu amical. « Vous vous y connaissez, vous pouvez me donner des leçons, si vous avez le temps. » Je lui dis : « J’ai tout le temps quand je ne suis pas à l’école. » Là, il m’a donné son nom, Kyo Philip. J’aime bien ce nom. J’ai pensé tout de suite qu’on pourrait être amis, avec ce nom-là. Je suis restée un bon moment à lui expliquer la pêche, je lui ai montré le coin de l’autre côté de la digue, où la marée ne risque pas de pousser sur la ligne. La nuit venait, et je suis retournée à la maison. Avant de partir, j’ai dit à Monsieur Kyo : « Demain, c’est dimanche. Si vous y tenez, je pourrais vous montrer où il faut pêcher. Les bons coins, si vous voyez ce que je veux dire. » Il m’a regardée avec toujours son petit sourire. « OK, demain matin ? » J’ai dit : « Demain après-midi, parce que le matin je vais à l’église avec ma mère. » Il a remballé sa canne et ses appâts. « Vous ne savez pas où j’habite ? » Je lui ai fait un signe entendu : « Tout le monde sait où vous habitez, Monsieur. Ici tout le monde sait tout sur tout le monde, c’est une petite île. » J’ai ajouté, parce que je n’étais pas sûre qu’il eût compris : « Vous n’avez qu’à sortir de chez vous, et c’est moi qui vous retrouverai. » Et c’est ainsi que nous sommes devenus des amis, Monsieur Philip Kyo et moi-même.
À la fin de l’été, les forces se rassemblent. Je hais l’été, c’est la saison de l’oubli, ou du moins la saison où l’on fait semblant d’oublier. Chaque jour, la marée humaine remplit tous les coins, une eau trouble et clapotante qui s’infiltre dans les espaces vides, se ramifie, se décuple. Un moment, à six heures du matin, déjà grand jour, tout est désert, en suspens. Seules les pêcheuses d’ormeaux flottent au large. Quelques oiseaux. L’instant d’après, c’est l’invasion. Une éclosion d’insectes noirs. Ils courent dans tous les sens, leurs antennes aux aguets, leurs élytres écartés, ils nagent, ils roulent, parfois même ils volent, j’en ai vu : un homme attaché par des sangles qu’un bateau avait halé jusqu’à la plage, et le vent gonflait ses membranes flasques, l’entraînait à quatre pattes comme un monstrueux crabe multicolore. Je l’ai arrêté dans sa course. Il a tourné son visage rouge vers moi. Il s’est épousseté, et il m’a dit : « Spassiba ! » Quel mauvais vent l’a amené jusqu’ici ?
Le bruit et la chaleur me font fuir l’étroite chambre de l’hôtel près du port. Le taulier m’a loué une tente — un témoin des surplus d’après-guerre, me semble-t-il — et je suis allé m’installer de l’autre côté de l’île, là où il n’y a pas de plage, une côte de rochers noirs hérissés de griffes. J’y suis envahi par les cafards de mer, mais je les préfère aux insectes humains. Mary disait que j’étais un éternel célibataire maniaque. Elle se moquait de moi : « Sissy, poussy. » Elle ne savait rien de ma vie. Elle ne parlait pas souvent d’elle-même. Une nuit, parce qu’elle chantait à tue-tête en marchant au bord de la mer, je lui ai dit que n’importe où ailleurs elle passerait pour une folle. Elle a cessé de chanter, elle a parlé avec amertume de la maison où on l’avait enfermée sur la recommandation d’un médecin ami de sa famille. Elle appelait ça : la Maison blanche. Parce que tout était blanc, les murs, les plafonds, les blouses des infirmiers et des toubibs, et même le teint des patients.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Tempête. Deux novellas»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Tempête. Deux novellas» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Tempête. Deux novellas» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.