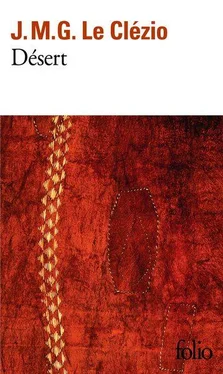Elle est assise sur un haut tabouret, devant un miroir, et elle essaie les couleurs sur le dessus de sa main, tandis que la vendeuse aux cheveux de paille la regarde avec des yeux stupides.
À l’étage, Lalla se faufile entre les vêtements, toujours en tenant Radicz par la main. Elle choisit un tee-shirt, une salopette de travail en denim bleu, puis des sandales de tennis et des chaussettes rouges. Elle laisse derrière, dans le salon d’essayage, sa vieille robe-tablier grise et ses sandales de caoutchouc, mais elle garde le manteau marron parce qu’elle l’aime bien. Maintenant, elle marche plus légèrement, en rebondissant sur ses semelles élastiques, une main dans la poche de sa salopette. Ses cheveux noirs tombent en lourdes boucles sur le col de son manteau, étincellent à la lumière de l’électricité blanche.
Radicz la regarde et la trouve belle, mais il n’ose pas le lui dire. Ses yeux sont brillants de joie. Il y a comme l’éclat du feu dans le noir des cheveux de Lalla, dans le cuivre rouge de son visage. Maintenant, c’est comme si la lumière de l’électricité avait ranimé la couleur du soleil du désert, comme si elle était venue là, dans le Prisunic, directement du chemin qui vient des plateaux de pierres.
Peut-être que tout a disparu, réellement, et que le grand magasin est seul au centre d’un désert sans fin, pareil à une forteresse de pierre et de boue. Mais c’est la ville entière que le sable entoure, que le sable enserre, et on entend craquer les superstructures des immeubles de béton, tandis que courent les fissures sur les murs, et que tombent les panneaux de verre miroir des gratte-ciel.
C’est le regard de Lalla qui porte la force brûlante du désert. La lumière est ardente sur ses cheveux noirs, sur la natte épaisse qu’elle tresse au creux de son épaule, en marchant. La lumière est ardente dans ses yeux couleur d’ambre, sur sa peau, sur ses pommettes saillantes, sur ses lèvres. Alors, dans le grand magasin plein de bruit et d’électricité blanche, les gens s’écartent, s’arrêtent sur le passage de Lalla et de Radicz le mendiant. Les femmes, les hommes s’arrêtent, étonnés, car ils n’ont jamais vu personne qui leur ressemble. Au centre de l’allée, Lalla avance, vêtue de sa salopette sombre, de son manteau brun qui s’ouvre sur son cou et sur son visage couleur de cuivre. Elle n’est pas grande, et pourtant elle semble immense quand elle avance au centre de l’allée, puis quand elle descend sur l’escalier roulant vers le rez-de-chaussée.
C’est à cause de toute la lumière qui jaillit de ses yeux, de sa peau, de ses cheveux, la lumière presque surnaturelle. Derrière elle vient l’étrange garçon maigre, dans ses habits d’homme, pieds nus dans ses chaussures de cuir noir. Ses cheveux noirs et longs entourent son visage triangulaire aux joues creuses, aux yeux enfoncés. Il va en arrière, sans bouger les bras, silencieux, un peu de travers comme les chiens peureux. Les gens aussi le regardent avec étonnement, comme s’il était une ombre détachée d’un corps. La peur se lit sur son visage, mais il essaie de la cacher avec un drôle de sourire dur qui ressemble plutôt à une grimace.
Parfois, Lalla se retourne, elle lui fait un petit signe, ou elle le prend par la main :
« Viens ! »
Mais le jeune garçon se laisse bien vite distancer. Quand ils sont à nouveau dehors, dans la rue, dans le soleil et le vent, Lalla lui demande :
« Tu as faim ? »
Radicz la regarde avec des yeux brillants, fiévreux.
« On va manger », dit Lalla. Elle montre ce qui reste de la poignée de billets froissés dans la poche de sa salopette neuve.
Le long des grandes avenues rectilignes, les gens marchent, les uns vite, les autres lentement, en traînant les pieds. Les autos roulent toujours le long des trottoirs, comme si elles guettaient quelque chose, quelqu’un, une place pour se garer. Il y a des martinets dans le ciel sans nuages, ils descendent les vallées des rues en poussant des cris stridents. Lalla est contente de marcher, comme cela, en tenant la main de Radicz, sans rien dire, comme s’ils allaient vers l’autre bout du monde pour ne plus jamais revenir. Elle pense aux pays qu’il y a de l’autre côté de la mer, les terres rouges et jaunes, les noirs rochers debout dans le sable, comme des dents. Elle pense aux yeux de l’eau douce ouverts sur le ciel, et au goût du chergui , qui soulève la peau de la poussière et fait avancer les dunes. Elle pense encore à la grotte du Hartani, en haut de la falaise, là où elle a vu le ciel, rien que le ciel. Maintenant c’est comme si elle marchait vers ce pays, le long des avenues, comme si elle retournait. Les gens s’écartent sur leur passage, les yeux étrécis par la lumière, sans comprendre. Elle passe devant eux sans les voir, comme à travers un peuple d’ombres. Lalla ne parle pas. Elle serre très fort la main de Radicz, elle va droit devant elle, dans la direction du soleil.
Quand ils arrivent à la mer, le vent souffle plus fort, bouscule. Les autos klaxonnent avec violence, prises dans les embouteillages du port. De nouveau, la peur se lit sur le visage de Radicz, et Lalla tient sa main bien serrée, pour le rassurer. Il ne faut pas qu’elle hésite, sinon l’ivresse du vent et de la lumière va partir, les laisser à eux-mêmes, et ils n’auront plus le courage d’être libres.
Ils marchent le long des quais, sans regarder les bateaux dont les mâts résonnent. Les reflets de l’eau dansent sur la joue de Lalla, font briller sa peau de cuivre, ses cheveux. La lumière est rouge autour d’elle, d’un rouge de braise. Le jeune garçon la regarde, il laisse entrer en lui la chaleur qui sort de Lalla, qui l’enivre. Son cœur bat avec force, résonne dans ses tempes, dans son cou.
Maintenant apparaissent les hauts murs blancs, les vitres larges du grand restaurant. C’est là qu’elle veut aller. Au-dessus de la porte, il y a des mâts avec des drapeaux de couleur qui claquent dans le vent. Lalla connaît bien cette maison, il y a longtemps qu’elle la voit de loin, très blanche, avec ses grandes vitres qui renvoient les éclairs du soleil couchant.
Elle entre sans hésiter, en poussant la porte de verre. La grande salle est sombre, mais sur les tables rondes, les nappes font des taches éblouissantes. En un instant, Lalla voit tout, distinctement : les bouquets de fleurs roses dans des vases de cristal, les couverts en argent, les verres à facettes, les serviettes immaculées, puis les chaises couvertes de velours bleu marine, et le parquet de bois ciré où passent les garçons vêtus de blanc. C’est irréel et lointain, et pourtant c’est ici qu’elle entre, en marchant lentement et sans bruit sur le parquet, et tenant très fort la main de Radicz le mendiant.
« Viens », dit Lalla. « On va s’asseoir là-bas. »
Elle montre une table, près d’une grande fenêtre. Ils traversent la salle du restaurant. Autour des tables rondes, les hommes, les femmes relèvent la tête au-dessus de leur assiette et s’arrêtent de mâcher, de parler. Les garçons restent en suspens, la cuiller plongée dans le plat de riz, ou la bouteille de vin blanc inclinée un peu, laissant couler dans le verre un filet très mince qui s’effiloche comme une flamme en train de s’éteindre. Puis Lalla et Radicz s’assoient devant la table ronde, chacun d’un côté de la belle nappe blanche, séparés par un bouquet de roses. Alors les gens recommencent à mâcher, à parler, mais plus bas, et le vin recommence à couler, la cuiller sert le riz, et les voix chuchotent un peu, couvertes par le brouhaha des autos qui passent devant les larges vitres comme de monstrueux poissons d’aquarium.
Radicz n’ose pas regarder autour de lui. Il regarde seulement le visage de Lalla, de toutes ses forces. Il n’a jamais vu de visage plus beau, plus clair. La lumière de la fenêtre illumine les lourds cheveux noirs, fait une flamme autour du visage de Lalla, sur son cou, sur ses épaules, jusque sur ses mains posées à plat sur la nappe blanche. Les yeux de Lalla sont pareils à deux silex, couleur de métal et de feu, et son visage est pareil à un masque de cuivre lisse.
Читать дальше