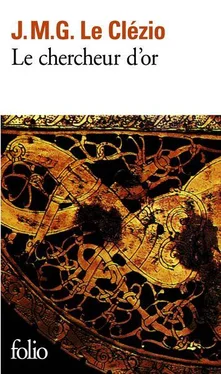Pendant des heures, je suis Sri à travers la montagne. Nous sommes haut, au-dessus des collines, sur les flancs des montagnes dénudées. Au-dessous de moi, je vois les pentes rocheuses, les taches sombres des vacoas et des arbustes épineux. Ici, tout est nu, minéral. Le ciel est magnifiquement bleu, les nuages venus de l’est courent au-dessus de la mer, passent sur la vallée en jetant une ombre rapide. Nous continuons à monter. Parfois je ne vois même plus mon guide, et quand je l’aperçois, loin devant moi, dansant rapide et léger, je ne suis pas sûr de ne pas avoir vu un cabri, un chien sauvage.
A un moment je m’arrête pour regarder la mer, au loin, comme je ne l’ai jamais vue encore : immense, brillante et dure à la lumière du soleil, traversée par la longue frange silencieuse des brisants.
Le vent souffle en rafales froides qui mettent des larmes dans mes yeux. Je reste assis sur une pierre pour reprendre mon souffle. Quand je recommence à marcher, j’ai peur d’avoir perdu Sri. Les yeux plissés, je le cherche, vers le haut de la montagne, sur les pentes sombres des vallons. Alors que je suis sur le point de renoncer à le retrouver, je le vois, entouré d’autres enfants, avec un troupeau de cabris, sur l’autre versant de la montagne. J’appelle, mais l’écho de ma voix fait fuir les enfants, qui disparaissent avec leurs chèvres, au milieu des broussailles, et des pierres.
Je vois ici les traces des hommes : ce sont des sortes de cercles de pierres sèches, semblables à ceux que j’ai trouvés lorsque je suis arrivé la première fois à l’Anse aux Anglais. Je remarque aussi des sentiers à travers la montagne, à peine marqués, mais que je peux apercevoir parce que la vie sauvage que je mène depuis quatre ans à l’Anse aux Anglais m’a appris à repérer le passage des hommes. Comme je m’apprête à descendre de l’autre côté de la montagne pour chercher les enfants, je vois Ouma tout à coup. Elle vient jusqu’à moi, et sans prononcer un mot, elle me prend par la main et elle me guide vers le haut de la falaise, là où le terrain forme une sorte de glacis en surplomb.
De l’autre côté du vallon, sur la pente aride, le long d’un torrent asséché, je vois des huttes de pierres et de branches, quelques champs minuscules protégés du vent par des murets. Des chiens nous ont sentis et aboient. C’est le village des manafs.
« Tu ne dois pas aller plus loin, dit Ouma. Si un étranger venait, les manafs seraient obligés de partir plus loin dans la montagne. »
Nous marchons le long de la falaise, jusqu’au versant nord de la montagne. Nous sommes face au vent. En bas, la mer est infinie, sombre, tachée de moutons. Vers l’est, il y a le miroir de turquoise du lagon.
« La nuit, on voit les lumières de la ville », dit Ouma. Elle montre la mer : « Et par là, on peut voir arriver les bateaux. »
« C’est beau ! » Je dis cela presque à voix basse. Ouma s’est assise sur ses talons, comme elle fait, en nouant ses bras autour de ses genoux. Son visage sombre est tourné vers la mer, le vent bouscule ses cheveux. Elle se tourne vers l’ouest, du côté des collines.
« Tu devrais redescendre, il va faire nuit bientôt. »
Mais nous restons assis, immobiles dans les bourrasques de vent, sans pouvoir nous séparer de la mer, pareils à des oiseaux en train de planer très haut dans le ciel. Ouma ne me parle pas, mais il me semble que je ressens tout ce qu’il y a en elle, son désir, son désespoir. Elle ne dit jamais cela, mais c’est pour cela qu’elle aime tant aller jusqu’au rivage, plonger dans la mer, nager vers les brisants armée de son long harpon, et regarder les hommes de la côte, cachée derrière les rochers.
« Veux-tu partir avec moi ? »
Le son de ma voix, ou bien ma question la fait sursauter. Elle me regarde avec colère, ses yeux brillent.
« Partir ? Pour aller où ? Qui voudrait de moi ? »
Je cherche des mots pour l’apaiser, mais elle dit avec violence :
« Mon grand-père était marron, avec tous les Noirs marrons du Morne. Il est mort quand on a écrasé ses jambes dans le moulin à cannes, parce qu’il avait rejoint les gens de Sacalavou dans la forêt. Alors mon père est venu vivre ici, à Rodrigues, et il s’est fait marin pour voyager. Ma mère est née au Bengale, et sa mère était musicienne, elle chantait pour Govinda. Moi, où pourrais-je aller ? En France, dans un couvent ? Ou bien à Port Louis, pour servir ceux qui ont fait mourir mon grand-père, ceux qui nous ont achetés et vendus comme des esclaves ? »
Sa main est glacée, comme si elle avait de la fièvre. Tout d’un coup, Ouma se lève, elle marche vers la pente, à l’ouest, là où les chemins se séparent, là où elle m’a attendu tout à l’heure. Son visage est calme à nouveau, mais ses yeux brillent encore de colère.
« Il faut que tu partes maintenant. Tu ne dois pas rester ici. »
Je voudrais lui demander de me montrer sa maison, mais elle s’en va déjà, sans se retourner, elle descend vers le vallon obscur où sont les huttes des manafs. J’entends des voix d’enfants, des chiens qui aboient. L’ombre arrive vite.
Je descends le long des pentes, je cours à travers les buissons d’épines et les vacoas. Je ne vois plus la mer, ni l’horizon, rien que l’ombre des montagnes qui s’agrandit dans le ciel. Quand j’arrive dans la vallée de l’Anse aux Anglais, il fait nuit, et la pluie tombe doucement. Sous mon arbre, à l’abri de ma tente, je reste recroquevillé, immobile, et je sens le froid, la solitude. Je pense alors au bruit de la destruction, qui grandit chaque jour, qui roule, pareil au grondement d’un orage, ce bruit qui est maintenant sur toute la terre, et que personne ne peut oublier. C’est cette nuit-là que j’ai décidé de partir pour la guerre.
Ils sont réunis ce matin, à l’entrée du ravin : il y a Adrien Mercure, un grand Noir d’une force herculéenne qui a été autrefois « foreman » dans les plantations de coprah à Juan de Nova, Ernest Raboud, Célestin Prosper, et le jeune Fritz Castel. Quand ils ont su que j’avais découvert la cachette, ils sont venus aussitôt, toutes affaires cessantes, chacun avec sa pelle et un bout de corde. Quiconque nous aurait vus traverser ainsi la vallée de l’Anse aux Anglais, eux avec leurs pelles et leurs grands chapeaux de vacoa, et moi à leur tête, avec ma barbe et mes cheveux longs et mes habits déchirés, la tête encore bandée d’un mouchoir, aurait pu croire à une mascarade imitant le retour des hommes du Corsaire, venus reprendre leur trésor !
L’air frais du matin nous encourage, et nous commençons à creuser autour des blocs de basalte, au fond du ravin. La terre, friable en surface, devient aussi dure que de la roche au fur et à mesure que nous creusons. À tour de rôle, nous donnons de grands. coups de pic, tandis que les autres s’emploient à déblayer vers la partie la plus large du ravin. C’est alors que me vient l’idée que ces pierres et cette terre amoncelées à l’entrée du ravin, et que j’avais prises pour un verrou naturel dû au ruissellement des eaux dans le lit de l’ancien torrent sont en réalité les matériaux déblayés lorsque les hommes du Corsaire ont excavé les cachettes au fond du ravin. À nouveau, je ressens cette impression étrange que le ravin tout entier est le résultat d’une création humaine. À partir d’une simple faille dans la falaise basaltique, l’on a creusé, fouillé, jusqu’à donner l’aspect de cette gorge, que les eaux de pluie ont remodelée pendant près de deux cents ans. C’est une impression étrange, presque effrayante, comme celle que doivent ressentir les chercheurs qui mettent au jour les anciennes tombes d’Egypte, dans le silence et la lumière inhumaine du désert.
Читать дальше