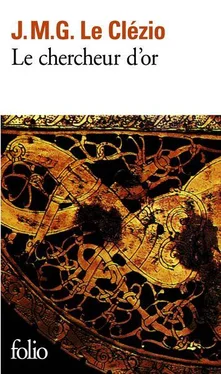Les bureaux de la Cable & Wireless sont encore vides à cette heure. Seul, un employé indien me regarde avec indifférence, même quand je lui pose, le plus poliment du monde, ma question saugrenue.
« Excusez-moi, monsieur, quel jour sommes-nous ? »
Il semble réfléchir. Sans bouger de sa place, sur les marches de l’escalier, il dit :
« Lundi. »
J’insiste :
« Mais quelle date ? »
Après un autre silence, il énonce :
« Lundi 10 août 1914. »
Tandis que je descends le long du chemin, entre les vacoas, vers la mer, je sens une sorte de vertige. Il y a si longtemps que je vis dans cette vallée solitaire, dans la compagnie du fantôme du Corsaire inconnu ! Seul avec l’ombre d’Ouma, qui disparaît parfois si longtemps que je ne sais plus si elle existe vraiment. Il y a si longtemps que je suis loin de ma maison, de ceux que j’aime. Le souvenir de Laure et de Mam me serre le cœur, comme un pressentiment. Le ciel bleu m’éblouit, la mer semble brûler. Il me semble que je viens d’un autre monde, d’un autre temps.
Quand j’arrive à Port Mathurin, je suis tout à coup dans la foule. Ce sont des pêcheurs qui retournent chez eux, à la baie Lascars, ou des fermiers des montagnes venus pour le marché. Des enfants noirs courent à côté de moi, en riant, puis se cachent quand je les regarde. À force de vivre dans son domaine, je crois que je me suis mis à ressembler un peu au Corsaire. Un drôle de corsaire sans bateau, sorti tout poussiéreux et guenilleux de sa cachette.
Passé la case Portalis, je suis au centre de la ville, dans Barclay’s Street. À la banque, tandis que je retire mes dernières économies (de quoi acheter biscuits marins, cigarettes, huile, café, et une pointe de harpon pour la pêche aux hourites), j’entends la première rumeur de cette guerre vers laquelle le monde semble se précipiter avec frénésie. Un exemplaire récent du Mauricien sur le mur de la banque affiche les nouvelles reçues d’Europe par télégraphe : la déclaration de guerre de l’Autriche à la Serbie après l’attentat de Sarajevo, la mobilisation en France et en Russie, les préparatifs de guerre en Angleterre. Ces nouvelles sont vieilles de dix jours déjà !
J’erre un long moment dans les rues de cette ville, où personne ne semble se rendre compte de la destruction qui menace le monde. La foule se presse devant les magasins, à Duncan Street, chez les Chinois de Douglas Street, sur le chemin du débarcadère. Un instant, je pense à aller parler au docteur Camal Boudou, au dispensaire, mais j’ai honte de mes habits en haillons et de mes cheveux trop longs.
Dans les bureaux de la Compagnie Elias Mallac, une lettre m’attend. Je reconnais sa belle écriture penchée, sur l’enveloppe, mais je n’ose pas la lire tout de suite. Il y a trop de monde dans le bureau de poste. Je la tiens dans ma main en marchant dans les rues de Port Mathurin, tout le temps que je fais mes courses. Ce n’est que lorsque je suis de retour dans l’Anse aux Anglais, assis dans mon campement sous le vieux tamarinier, que je peux ouvrir la lettre. Sur l’enveloppe je lis la date de l’envoi : 6 juillet 1914. La lettre n’a qu’un mois.
Elle est écrite sur une feuille de papier indien, léger, fin et opaque, que je reconnais rien qu’au craquement qu’il fait entre les doigts. C’est le papier sur lequel notre père aimait écrire, ou tracer ses plans. Je croyais que ces feuilles avaient toutes disparu lors de notre déménagement du Boucan. Où Laure les a-t-elle trouvées ? Je pense qu’elle a dû les garder tout ce temps, comme si elle les avait réservées pour m’écrire. De voir son écriture penchée, élégante, cela me trouble au point que je ne peux lire pendant un instant. Puis je lis ses mots à mi-voix, pour moi-même :
Mon cher Ali,
Tu vois, je ne sais pas tenir parole. J’avais juré de ne t’écrire que pour te dire un seul mot : reviens ! Et voici que je t’écris sans savoir ce que je vais te dire.
Je vais d’abord te donner quelques nouvelles, qui, comme tu l’imagines, ne sont pas fameuses. Depuis ton départ, tout ici est devenu encore plus triste. Mam a cessé toute activité, elle ne veut même plus aller en ville pour essayer d’arranger nos affaires. C’est moi qui suis allée à plusieurs reprises pour tenter d’apitoyer nos créanciers. Il y a un Anglais, un certain M. Notte (c’est un nom qui ne s’invente pas !), qui menace de saisir les trois meubles que nous avons encore à Forest Side. J’ai réussi à l’arrêter, en faisant des promesses, mais pour combien de temps ? Assez de cela. Mam est bien faible. Elle parle encore d’aller se réfugier en France, mais les nouvelles qui arrivent parlent toutes de guerre. Oui, tout est bien sombre en ce moment, il n’y a plus guère d’avenir.
Mon cœur se serre tandis que je lis ces lignes. Où est la voix de Laure, elle qui ne se plaignait jamais, qui refusait ce qu’elle appelait les « jérémiades » ? L’inquiétude que je ressens n’est pas celle de la guerre qui menace le monde. C’est plutôt le vide qui s’est creusé entre moi et ceux que j’aime, qui me sépare d’eux irrémédiablement. Je lis tout de même la dernière ligne, où il me semble reconnaître un bref instant la voix de Laure, sa moquerie :
« Je ne cesse pas de penser au temps où nous étions heureux, au Boucan, aux journées qui n’en finissaient pas. Je souhaite que pour toi, là où tu es, il y ait aussi de belles journées, et du bonheur, à défaut de trésors. »
Elle signe seulement d’une initiale, « L », sans formule d’adieu. Elle n’a jamais aimé les serrements de main ni les embrassades. Que me reste-t-il d’elle, entre mes mains, dans cette vieille feuille de papier indien ?
Je replie la lettre avec soin, et je la range avec mes papiers dans la cantine, près de l’écritoire. Dehors, la lumière de midi étincelle, fait briller avec force les pierres sur le fond de la vallée, aiguise les feuilles des vacoas. Le vent apporte le bruit de la marée qui monte. Les moucherons dansent à l’entrée de la tente, peut-être sentent-ils l’orage ? Il me semble que j’entends encore la voix de Laure, qui s’adresse à moi de l’autre côté de la mer, qui m’appelle au secours. Malgré le bruit de la mer et du vent, le silence est partout ici, la solitude éblouit dans la lumière.
Je marche au hasard à travers la vallée, encore vêtu de ma veste grise trop grande pour moi, les pieds écorchés par les bottines dont le cuir s’est desséché. Je marche sur les traces que je connais, le long des lignes du plan du Corsaire et de ses amorces, un grand hexagone terminé par six pointes, qui n’est autre que l’étoile du sceau de Salomon, et qui répond aux deux triangles inversés des organeaux.
Je traverse plusieurs fois l’Anse aux Anglais, le regard errant sur le sol, écoutant le bruit de mes pas qui résonne. Je vois chaque pierre que je connais, chaque buisson, et sur le sable des dunes, à l’estuaire de la rivière Roseaux, les traces de mes propres pas, qu’aucune pluie n’a lavées. Je relève la tête, et je vois au fond de la vallée les montagnes bleues, inaccessibles. C’est comme si je voulais me souvenir de quelque chose de lointain, d’oublié, du grand ravin sombre de Mananava, peut-être, là où commençait la nuit.
Je ne peux plus attendre. Ce soir, quand le soleil descend vers les collines, au-dessus de la pointe Vénus, je marche jusqu’à l’entrée du ravin. Avec fièvre, j’escalade les blocs qui ferment l’entrée, et je creuse à coups de pic dans les parois du ravin, au risque d’être enterré sous un ébouleraient. Je ne veux plus penser à mes calculs, aux jalons. J’entends les coups de mon cœur, le bruit rauque de ma respiration oppressée, et le fracas des pans de terre et de schiste qui s’effondrent. Cela me soulage, me libère de mon anxiété.
Читать дальше