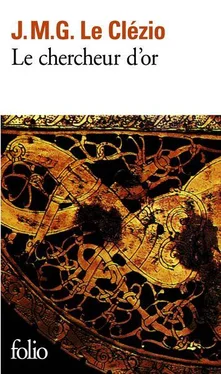C’est la nuit déjà. Le ciel vide, au-dessus du ravin, s’assombrit lentement. Mais l’air est si chaud qu’il me semble que le soleil brûle encore, sur les parois de pierre, sur mon visage, sur mes mains, à l’intérieur de mon corps. Assis au fond du ravin, devant la cachette vide, je bois toute l’eau qui me reste dans la gourde, une eau chaude et sans goût qui ne parvient pas à me rassasier.
Pour la première fois depuis longtemps, je pense à Laure, il me semble que je sors de mon rêve. Que penserait-elle de moi si elle me voyait ainsi, couvert de poussière, au fond de cette tranchée, les mains ensanglantées à force d’avoir creusé ? Elle me regarderait de son regard sombre et brillant, et je sentirais la honte. Maintenant, je suis trop fatigué pour bouger, pour penser, pour sentir quoi que ce soit. J’attends la nuit avec soif, avec désir, et je m’allonge à la place où je suis, au fond du ravin, la tête appuyée sur une des pierres noires que j’ai arrachées à la terre. Au-dessus de moi, entre les hautes parois de pierre, le ciel est noir. Je vois les étoiles. Ce sont des morceaux de constellations brisées, dont je ne peux plus connaître le nom.
Le matin, quand je sors du ravin, je vois la silhouette d’Ouma. Elle est assise près du campement, à l’ombre d’un arbre, et elle m’attend. À côté d’elle, il y a Sri, qui me regarde venir sans bouger.
Je m’approche de la jeune fille, je m’assois à côté d’elle. Dans l’ombre, son visage est sombre, mais ses yeux brillent avec force. Elle me dit :
« Il n’y a plus d’eau dans le ravin. La fontaine a séché. »
Elle dit « fontaine » pour source, à la manière créole. Elle dit cela calmement, comme si c’était de l’eau que j’avais cherchée dans le ravin.
La lumière du matin brille sur les pierres, dans le feuillage des arbres. Ouma est allée chercher de l’eau à la rivière dans la marmite, et maintenant elle prépare la bouillie de farine des femmes indiennes, le kir. Quand la bouillie est cuite, elle me sert dans une assiette en émail. Elle-même puise avec ses doigts à même la marmite.
De sa voix tranquille et chantante, elle me parle encore de son enfance, en France, dans le couvent des religieuses, et de sa vie, lorsqu’elle est revenue vivre avec sa mère, chez les manafs. J’aime comme elle me parle. J’essaie de l’imaginer, le jour où elle a débarqué du grand paquebot, vêtue de son uniforme noir, les yeux éblouis par la lumière.
Je lui parle moi aussi de mon enfance, au Boucan, de Laure, des leçons de Mam sous la varangue, le soir, et des aventures avec Denis. Quand je lui parle de notre voyage en pirogue, au Morne, ses yeux brillent.
« Je voudrais bien aller sur la mer, moi aussi. »
Elle se lève, elle regarde du côté du lagon.
« De l’autre côté, il y a beaucoup d’îles, des îles où vivent les oiseaux de mer. Emmène-moi là-bas, pour pêcher. »
J’aime quand son regard brille comme cela. C’est décidé, nous irons sur les îles, à l’île aux Fous, à Baladirou, peut-être même au sud, jusqu’à Gombrani. J’irai à Port Mathurin pour louer une pirogue.
Pendant deux jours et deux nuits, la tempête souffle. Je vis replié sous ma tente, ne mangeant que des biscuits salés, presque sans sortir. Puis, le matin du troisième jour, le vent cesse. Le ciel est d’un bleu éclatant, sans nuages. Sur la plage, je trouve Ouma debout, comme si elle n’avait pas bougé tout ce temps. Quand elle me voit, elle me dit :
« J’espère que le pêcheur apportera la pirogue aujourd’hui. »
Une heure plus tard, en effet, la pirogue aborde sur la plage. Avec la provision d’eau et une boîte de biscuits, nous embarquons. Ouma est à la proue, son harpon à la main, elle regarde la surface du lagon.
À la baie Lascars, nous débarquons le pêcheur, et je promets de lui ramener la pirogue le lendemain. Nous nous éloignons, la voile tendue dans le vent d’est. Les hautes montagnes de Rodrigues s’élèvent derrière nous, encore pâles dans la lumière du matin. Le visage d’Ouma est éclairé de bonheur. Elle me montre le Limon, le Piton, le Bilactère. Quand nous franchissons la passe, la houle fait tanguer la pirogue, et les embruns nous enveloppent. Mais plus loin, nous sommes à nouveau dans le lagon, à l’abri des récifs. Pourtant l’eau est sombre, traversée de reflets mystérieux.
Devant la proue, une île apparaît : c’est l’île aux Fous. Avant même de les apercevoir, nous entendons le bruit des oiseaux de mer. C’est un roulement continu, régulier, qui emplit le ciel et la mer.
Les oiseaux nous ont vus, ils volent au-dessus de la pirogue. Des sternes, des albatros, des frégates noires, et les fous géants, qui tournoient en glapissant.
L’île n’est plus qu’à une cinquantaine de brasses, à tribord. Du côté du lagon, c’est une bande de sable, et vers le large, des rochers sur lesquels viennent se briser les vagues de l’océan. Ouma est venue près de moi à la barre, elle dit à voix basse, près de mon oreille :
« C’est beau !… »
Jamais je n’ai vu autant d’oiseaux. Ils sont des milliers sur les rochers blancs de guano, ils dansent, ils s’envolent et se reposent, et le bruit de leurs ailes vrombit comme la mer. Les vagues déferlent sur les récifs, recouvrent les rochers d’une cascade éblouissante, mais les fous n’ont pas peur. Ils écartent leurs ailes puissantes et ils se soulèvent dans le vent au-dessus de l’eau qui passe, puis ils retombent sur les rochers.
Un vol serré passe au-dessus de nous en criant. Ils tournent autour de notre pirogue, obscurcissant le ciel, fuyant contre le vent, leurs ailes immenses étendues, leur tête noire à l’œil cruel tournée vers les étrangers qu’ils haïssent. Ils sont maintenant de plus en plus nombreux, leurs cris stridents nous étourdissent. Certains nous attaquent, piquent vers la poupe de la pirogue, et nous devons nous abriter. Ouma a peur. Elle se serre contre moi, elle bouche ses oreilles avec ses mains :
« Partons d’ici ! Partons d’ici ! »
Je mets la barre à tribord, et la voile reprend le vent en claquant. Les fous ont compris. Ils s’éloignent, prennent de l’altitude, et continuent à nous surveiller en tournoyant. Sur les rochers de l’île, le peuple d’oiseaux continue à sauter pardessus les flots d’écume.
Ouma et moi sommes encore troublés par la peur. Nous fuyons sous le vent, et longtemps après que nous avons quitté les parages de l’île, nous entendons les cris stridents des oiseaux et le vrombissement de leurs ailes. À un mille de l’île aux Fous, nous trouvons un autre îlot, sur la barrière des récifs. Au nord, les vagues de l’océan déferlent sur les rochers, avec un bruit de tonnerre. Ici, il n’y a presque pas d’oiseaux, sauf quelques sternes qui planent au-dessus de la plage.
Dès que nous avons abordé, Ouma ôte ses habits et elle plonge. Je vois briller son corps sombre entre deux eaux, puis elle disparaît. Plusieurs fois, elle refait surface pour respirer, son harpon dressé vers le ciel.
A mon tour, je me déshabille et je plonge. Je nage les yeux ouverts près du fond. Dans les coraux, il y a des milliers de poissons dont je ne connais même pas les noms, couleur d’argent, zébrés de jaune, de rouge. L’eau est très douce et je glisse près des coraux, sans effort. En vain je cherche Ouma.
Quand je reviens sur la rive, je m’étends dans le sable, et j’écoute le bruit des vagues derrière moi. Les sternes planent dans le vent. Il y a même quelques fous venus de leur île pour me regarder en criant.
Longtemps après, alors que le sable blanc a séché sur mon corps, Ouma sort de l’eau devant moi. Son corps brille dans la lumière comme du métal noir. Autour de sa taille, elle porte une liane tressée où elle a accroché ses proies, quatre poissons, une dame berri, un capitaine, deux gueules pavées. Elle plante le harpon sur le rivage, la pointe vers le haut, elle défait sa ceinture et elle place les poissons dans un trou de sable qu’elle recouvre d’algues mouillées. Puis elle s’assoit sur la plage et elle saupoudre son corps de sable.
Читать дальше