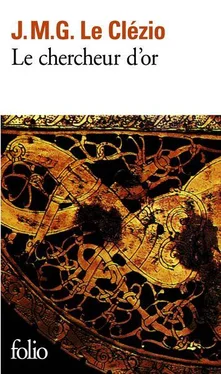« Pourquoi cherches-tu de l’or ici ? »
Je voudrais lui parler de notre maison au Boucan, de notre jardin sans limites, de tout ce que nous avons perdu, puisque c’est cela que je cherche. Mais je ne sais pas le lui dire, et elle ajoute, tout bas, comme si elle se parlait à elle-même :
« L’or ne vaut rien, il ne faut pas avoir peur de lui, il est comme les scorpions qui ne piquent que celui qui a peur. »
Elle dit cela simplement, sans forfanterie, mais avec dureté, comme quelqu’un qui est sûr. Elle dit encore :
« Vous autres, le grand monde, vous croyez que l’or est la chose la plus forte et la plus désirable, et c’est pour cela que vous faites la guerre. Les gens vont mourir partout pour posséder l’or. »
Ces paroles font battre mon cœur, parce que je pense à mon engagement. Un instant, j’ai envie de tout dire à Ouma, mais ma gorge se serre. Il ne me reste plus que quelques jours à vivre ici, près d’elle, dans cette vallée, si loin du monde. Comment parler de la guerre à Ouma ? Pour elle c’est le mal, je crois qu’elle ne me le pardonnerait pas, et qu’elle s’enfuirait aussitôt.
Je ne peux pas lui parler. Je tiens sa main dans la mienne, serrée très fort pour bien sentir sa chaleur, je respire son souffle sur ses lèvres. La nuit est douce, une nuit d’été, et le vent a cessé quand la mer est étale, les étoiles sont nombreuses et belles, tout est plein de paix et de joie. Pour la première fois, je crois, je goûte le temps qui passe sans impatience ni désir, mais avec tristesse, en pensant que plus rien de tout cela ne peut revenir, que cela va être détruit. Plusieurs fois, je suis sur le point d’avouer à Ouma que nous n’allons plus nous revoir, mais c’est son rire, son souffle, l’odeur de son corps, le goût du sel sur sa peau qui m’arrêtent. Comment troubler cette paix ? Je ne peux retenir ce qui va être brisé, mais je peux croire encore au miracle.
Chaque matin, comme la plupart des Rodriguais, je suis devant le bâtiment du télégraphe, en quête de nouvelles.
Les communiqués en provenance de l’Europe sont affichés sous la varangue, à côté de la porte du télégraphe. Ceux qui savent lire traduisent en créole aux autres. Dans la bousculade, je parviens à lire quelques lignes : il est question des armées de French, de Haig, et des troupes françaises de Langle, de Larrezac, des batailles en Belgique, des menaces sur le Rhin, du front sur l’Oise, près de Dînant, dans les Ardennes, près de la Meuse. Je connais ces noms pour les avoir appris au collège, mais que peuvent-ils signifier pour la plupart des Rodriguais ? Pensent-ils à ces noms comme à des sortes d’îles, où le vent balance les palmes des cocos et des lataniers, où l’on entend, comme ici, le bruit incessant de la mer sur les récifs ? Je ressens la colère, l’impatience, car je sais que dans peu de temps, quelques semaines peut-être, je serai là-bas, sur les bords de ces fleuves inconnus, dans cette guerre qui balaie tous les noms.
Ce matin, quand le jeune Fritz Castel est venu, j’ai fait quelque chose qui ressemble à un testament. Muni de mon théodolite, j’ai calculé pour la dernière fois la droite est-ouest qui passe exactement par les deux signes de l’organeau, sur les rives de la vallée, et j’ai déterminé l’endroit où cette droite rencontre l’axe nord-sud tel que l’indique la boussole, avec la différence légère donnée par la direction du nord stellaire. Au point de rencontre de ces deux droites, c’est-à-dire au centre de la vallée de la rivière Roseaux, aux limites du terrain marécageux qui forme une langue de terre entre les deux bras de la rivière, j’ai apporté une lourde pierre de basalte, ayant la forme d’une borne. Pour faire venir cette pierre, j’ai dû la faire glisser avec l’aide du jeune Noir sur un chemin de roseaux et de branches rondes, disposé sur le lit de la rivière. J’ai attaché une corde à la borne et, tirant et poussant à tour de rôle, nous l’avons amenée de l’autre bout de la vallée, sur une distance de plus d’un mille, jusqu’au point que j’ai marqué B sur mes plans, un peu en hauteur sur une butte de terre qui avance dans l’estuaire et se trouve entourée d’eau à marée haute.
Tout ce travail nous a occupés presque tout le jour. Fritz Castel m’a aidé sans me poser de questions. Puis il est retourné chez lui.
Le soleil est bas dans le ciel quand, muni d’un ciseau à froid et d’un gros caillou en guise de maillet, je commence à tracer mon message pour le futur. Sur le sommet de la borne, j’ai tracé une rainure longue de trois pouces, qui correspond à la droite qui relie les organeaux est-ouest. Sur le flanc de la borne, du côté sud, j’ai marqué les principaux points de repère correspondant aux jalons du Corsaire. Il y a le M majuscule qui représente les pointes du Comble du Commandeur, les : : poinçonnés sur la roche, la gouttière désignant le ravin, et le point indiquant la pierre la plus au nord, à l’entrée de l’estuaire. Sur la face nord de la borne, j’ai marqué au moyen de cinq poinçons les cinq principaux jalons du Corsaire : le Charlot, le Bilactère, le mont des Quatre Vents, qui forment le premier alignement sud-sud-est, et le Commandeur et le Piton qui forment un deuxième alignement légèrement divergent.
J’aurais voulu graver aussi les triangles de la grille du Corsaire, inscrits dans le cercle qui passe par les organeaux et par la pierre la plus au nord, et dont cette borne, je m’en aperçois, est le centre. Mais la surface de la pierre est trop inégale pour permettre d’inscrire avec mon ciseau émoussé un dessin aussi précis. Je me contente de marquer, à la base de la borne, en lettres majuscules, mes initiales, AL. En dessous, la date, en chiffres romains :
X XII MCMXIV
Cet après-midi, le dernier sans doute que je passe ici, dans l’Anse aux Anglais, j’ai voulu profiter de la chaleur du plein été pour nager longtemps dans le lagon. Je me suis déshabillé dans les roseaux, devant la plage déserte, là où nous allions avec Ouma. Aujourd’hui, tout me semble encore plus silencieux, lointain, abandonné. Il n’y a plus les nuées d’oiseaux couleur d’argent qui jaillissaient en poussant des cris aigus. Il n’y a plus d’oiseaux de mer dans le ciel. Il n’y a que les crabes soldats qui fuient vers la vase du marécage, leurs pinces dressées vers le ciel. Je nage longuement dans l’eau très douce, frôlant les coraux que la mer est en train de découvrir. Les yeux grands ouverts sous l’eau, je vois passer les poissons des hauts-fonds, des coffres, des aiguillettes couleur de nacre, et même un laffe splendide et vénéneux, ses nageoires dorsales hérissées comme des gréements. Tout près de la barrière de corail, je débusque une vieille qui s’arrête pour me regarder, avant de s’enfuir. Je n’ai pas de harpon, mais en aurais-je eu un, je crois que je n’aurais pas eu le cœur de l’utiliser contre une seule de ces créatures silencieuses, et voir leur sang empourprer l’eau !
Sur le rivage, dans les dunes, je me suis couvert de sable et j’ai attendu que le soleil déclinant le fasse couler sur ma peau en petits ruisseaux, comme lorsque j’étais là avec Ouma.
Je regarde la mer longtemps, j’attends. J’attends peut-être qu’Ouma apparaisse sur la plage, au crépuscule, son harpon d’ébène à la main, portant des hourites en guise de trophées. Les ombres emplissent la vallée quand je marche vers le campement. Avec inquiétude, avec désir, je regarde les hautes montagnes bleues, au fond de la vallée, comme si j’allais aujourd’hui enfin voir apparaître une forme humaine dans ce pays de pierres.
Ai-je appelé : « Ouma-ah » ? Peut-être, mais alors d’une voix si faible, si étranglée qu’elle n’a éveillé aucun écho. Pourquoi n’est-elle pas ici, maintenant, plus que n’importe quel soir ? Assis sur ma pierre plate, sous le vieux tamarinier, je fume en regardant la nuit entrer dans le creux de l’Anse aux Anglais. Je pense à Ouma, comme elle écoutait quand je lui parlais du Boucan, je pense à son visage caché dans ses cheveux, au goût du sel sur son épaule. Ainsi, elle savait tout, elle connaissait mon secret, et quand elle est venue près de moi, le dernier soir, c’était pour me dire adieu. Pour cela, elle cachait son visage, et sa voix était dure et amère quand elle me parlait de l’or, quand elle disait « vous autres, le grand monde ». De ne pas avoir compris, je sens maintenant de la colère, contre elle, contre moi-même. Je marche fiévreusement dans la vallée, puis je retourne m’asseoir sous le grand arbre où la nuit a déjà commencé, je froisse les papiers dans mes mains, les cartes. Plus rien de tout cela ne m’importe ! Maintenant, je sais qu’Ouma ne viendra plus. Je suis devenu comme les autres, comme les hommes de la côte que les manafs surveillent de loin, en attendant qu’ils laissent le passage.
Читать дальше