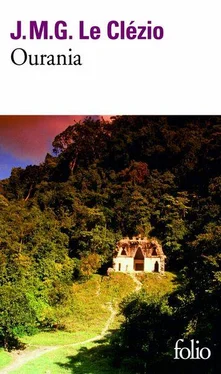Quand je suis arrivé, je n'ai pas reconnu immédiatement Dahlia. Pourtant, je n'ai eu aucune hésitation. Elle a toujours ses yeux d'un brun très clair et très doux. Sa vivacité, cette façon qu'elle a de marcher avec nonchalance, en traînant ses chanclas, la tête un peu penchée de côté.
Elle n'a pas eu l'air étonnée. Elle ne m'a pas posé de questions sur ma vie, elle n'a pas évoqué le passé. Elle est prise dans un tourbillon, elle n'a pas le temps de s'attendrir. J'étais venu pour une journée, deux tout au plus. Je suis resté. C'est Cattleya qui m'a retenu. Pour moi qui ai traversé l'existence sans me reproduire — je crois que j'en avais même fait ma justification, ne pas avoir contribué au surpeuplement et au malheur de cette planète —, l'irruption de cette poupée vivante et solitaire m'a ému à un point que j'ai du mal à admettre.
Dahlia n'a pas eu d'autre enfant. Fabio est aujourd'hui un homme, il est agent commercial dans une grande maison d'import-export en Floride, il s'est marié, il a des enfants. Son père, l'ex-révolutionnaire, est anthropologue, il enseigne à Tegucigalpa, à moins qu'il ne soit déjà, lui aussi, à la retraite. Quant à Angel, personne ne sait rien de lui, mais je n'ai pas de mal à l'imaginer chauffeur de taxi à San Salvador. C'était le sort de beaucoup d'anciens combattants de la révolution sandiniste.
Le soir, Dahlia et moi nous parlons un peu, assis sous la varangue, en écoutant la rumeur de la ville. Je crois qu'elle a eu des amants et des amantes, et qu'ils ont glissé sur elle sans laisser de traces. L'action qu'elle avait entreprise pour reconquérir sa dignité et arracher Fabio à l'emprise d'Hector est devenue peu à peu le centre de sa vie, la raison qu'elle a trouvée pour justifier son passage sur la terre (cela dit un peu grandiloquemment, car pourquoi y aurait-il une raison à un phénomène naturel ?).
Dahlia est une vieille femme. Mais le temps ne l'a pas usée. Elle qui était maigre et nerveuse comme une chatte de gouttière est devenue une femme corpulente. Sur son visage les traits des mélanges se sont accentués. Elle a quelque chose de Marian Anderson, dans le front bombé, le regard, la masse des cheveux qu'elle coiffe en chignon. Elle a aussi le teint cuivré des Caraïbes, l'aigu du profil andalou. Ce qui n'a pas changé, c'est le dédain qu'elle manifeste pour les emblèmes de la soi-disant féminité : elle ne porte toujours pas de bijoux ni de boucles d'oreilles. Ses habits sont la version adoucie, pour ainsi dire quotidienne, de la tenue de combat : un pantalon de grosse toile « relax fit », une chemise à manches longues aux poches bourrées de papiers, de crayons à bille. Aux pieds, des tongs.
Elle me parle des enfants qu'elle a vus grandir, des filles qu'elle arrache au trottoir, des femmes qu'elle accompagne jusqu'à la mort à l'hôpital. Je comprends qu'elle a troqué sa vie pour la vie des autres. Elle les écoute, elle est leur intermédiaire avec les fonctionnaires et les politiciens. Elle écrit des lettres, elle sollicite des emprunts aux banques, des moratoires pour les dettes impossibles à payer. Elle gêne sûrement, et j'imagine que pour beaucoup elle est l'ennemie.
C'est dix heures du soir, je suis avec elle, et il y a encore des filles qui viennent lui parler, des appels au téléphone, des décisions à prendre. Tout à coup je m'aperçois que les années qui nous séparent n'ont pas d'importance. Pour certains êtres, le temps ne s'écoule pas de la même manière. L'amour que j'ai ressenti pour Dahlia s'est arrêté à un point, il y a très longtemps, et n'a plus changé.
Elle doit penser la même chose, ou bien c'est la cubita que nous buvons en souvenir d'autrefois, parce qu'elle dit en riant à moitié : « En d'autres temps, c'est toi que j'aurais dû épouser. »
Vers minuit, elle m'a accompagné jusqu'à l'avenue où se trouve mon hôtel. Nous avons erré dans les rues du quartier, dans l'odeur des flamboyants. Elle me tenait par la main comme jadis, je sentais la même paume large, les tendons des doigts, la chaleur de son corps. Je m'aperçois que cela a fait bouger quelque chose au fond de moi, une chose que je croyais enfouie pour toujours.
Cela m'a ramené à l'époque où nous étions sur la route d'Ario, pour assister au départ en exil du peuple arc-en-ciel. Depuis ce jour, le monde a bougé. La révolution tant attendue n'aura pas lieu, ni l'éruption annoncée par le Conseiller (encore qu'elle ne soit pas tout à fait impossible). Je me souviens de la plaisanterie que mon prof de géologie servait à chaque nouvelle génération d'étudiants : Qu'est-ce qu'un volcan mono-éruptif ? Un volcan qui n'a pas encore eu sa deuxième éruption.
En attendant, les régions les plus pauvres de la planète continuent à sombrer dans les guerres larvées et l'insolvabilité. Il n'y a plus qu'un grand mouvement d'exode, une sorte de vague de fond qui se brise continuellement sur l'écueil de la frontière. Il n'y a pas de quoi être optimiste. Pourtant, ce qui nous unit encore, Dahlia et moi, ce qui nous permet d'espérer, c'est la certitude que le pays d'Ourania a vraiment existé, d'en avoir été les témoins.
Saint-Martin — San Juan, 1945–2009
Itinéraire du Paricutin à la vallée du Tepalcatepec
Quitté Los Reyes par car à 8 h le matin.
Mon barda : soupes lyophilisées, bouillie d'avoine, sessina, et surtout l'eau.
Une couverture pour ne pas faire mentir Don Thomas au cas où l'enfer serait frisquet la nuit.
Citronnelle contre les moustiques.
Le matériel : marteau, sacs à échantillons, bottes en plastique.
Mon vieux Minolta, boussole, calepins, crayons.
Un couteau suisse.
Alcool, pansements, crème solaire, pastilles de chlorazone pour désinfecter l'eau.
Pas de malaria, mais le mal de Pinto, un spirochète (tréponème herrejoni) qui sème des taches sur la peau et rend anémique.
Angahuan, 18/11
Temps sombre.
Marché dans les rues du village.
Sur la place un haut-parleur diffuse une valse.
Contacté Salvador (mon guide, 43 ans), qui connaît par cœur l'histoire du volcan (son gagne-pain).
Raconte les tremblements de terre, la pluie de cendres, la lave qui déborde et la forêt qui s'enflamme. Nous descendons vers Parangaricutiro vers 10 h du matin.
Traversons une partie de la coulée, non loin de la tour de l'église miraculeuse, dans les creux je remarque des offrandes de fleurs.
Continué par un chemin creusé dans la lave.
À 4 h environ nous sommes au bas du volcan (l'altimètre indique déjà 2 000 mètres). Le cône est parfait, échancre au nord-est par la coulée qui a anéanti le village en 43.
Salvador me conduit à travers les laves en aiguilles jusqu'à la « curiosité » : à 500 mètres du cratère, la mazorca (l'épi de maïs), une bombe volcanique en fuseau de 2 mètres de haut.
Avons commencé l'escalade dans la cendre, les laves brûlées, le salpêtre. Odeur forte de soufre. Je touche la cendre, elle me semble encore chaude, sans doute à cause de la réverbération solaire.
Continuons l'escalade à quatre pattes à cause de la pente ; vue sur le paysage chaotique de la vallée. Au sud la montagne où le Tepalcatepec prend sa source.
Je regarde la vallée où je dois faire ma coupe. Devant nous, assez proche, le volcan Tancitaro, type Fuji. La pointe est blanche, non de givre, mais de salpêtre.
L'océan est hors de vue, mais dans l'ombre, je vois un morceau de l'Infiernillo, formé par le barrage sur le río Balsas. L'impression est grandiose. Les deux volcans, Parícutin et Tancitaro, l'un de 2 800, l'autre de 3 000 mètres, commandent toute la vallée.
Nous distinguons clairement les vallées afïluentes : la Perota à l'est ; les plaines d'Antunez ; le Cupatitzio au nord-est, avec ses barrages ; le lac artificiel de Jicalan, et le hameau de Lombardia (le terminus de la voie ferrée Uruapan-Apatzingán). La rive gauche du Tepalcatepec est cultivée (cascalote, sorgho, concombre, melon, papaye, orangers).
Читать дальше