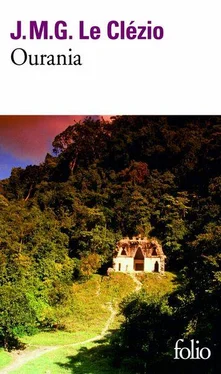Sur la route, quelques kilomètres après Santa Elena, Jadi a vu un panneau qui indiquait le village de Consejo, il a fait cette observation qui montre qu'il a gardé son sens de l'humour, il a dit que c'était une façon de leur montrer qu'ils allaient dans la bonne direction. Le soir même, la troupe s'est installée dans un vieil hôtel au centre de Belize, dans l'ancien quartier des esclaves.
La ville de Belize est devenue le terrain de jeu des enfants. Toute la journée ils courent dans les rues, du port au canal, et par le pont tournant jusqu'au Fort George.
Pour les adultes, la ville est bondée et étouffante, mais pour les jeunes c'est incroyablement drôle. Ruelles en pente vers la mer, placettes, maisons à balcons et rues à arcades, où se presse une foule bruyante, colorée : Antillais venus de la Jamaïque, ou d'Haïti, métis coiffés de panamas, filles en minijupes et dames opulentes, Mayas de la forêt sortis d'un bas-relief, Anglais roses qui sirotent leur gin aux terrasses des hôtels, qui disent à haute voix : « Isay, this is a tough country ! » Et les langages, l'anglais, l'espagnol, le maya, et cette langue créole qui résonne comme une musique, le bogo bogo venu d'Afrique, et quand il l'entend Raphaël a cette réflexion naïve : « Ils parlent elmen comme nous ! » Pas exactement, mais il lui semble qu'ils sont enfin arrivés dans un pays où tout se mélange, où tout est inventé.
Jadi ne bouge plus. Il passe sa journée dans la cour intérieure de l'hôtel, assis dans un grand fauteuil en bois noir. Depuis son accident cérébral, il ne marche plus. Il reste immobile, les mains posées bien à plat sur les accoudoirs du fauteuil, la nuque appuyée contre le haut du dossier. Il ne se plaint pas. Il ne parle pas, sauf de temps à autre pour demander, avec un geste, qu'on lui donne à boire, ou qu'on le porte jusqu'aux toilettes. Son visage est figé. Couleur de cendre, et ses cheveux qui tombent maintenant sur ses épaules sont mêlés de fils d'argent Sa seule coquetterie, c'est d'être rasé chaque matin par Hoatu.
Il a du monde autour de lui. Les enfants, les femmes, les fidèles. Hoatu passe beaucoup de temps à ses côtés. Elle est assise par terre, un bras posé sur le bras du fauteuil, elle tient sa main. Elle lui parle doucement, dans sa douce langue natale, ou bien en anglais. Elle parle de son île, qui doit ressembler à celle où Jadi a vécu pendant la guerre. Elle dit que là-bas tout pourra recommencer. Elle lui dit : Nous planterons dans le sable s'il le faut, nous mangerons la mer, et les enfants grandiront, ils apprendront d'autres chemins d'étoiles, ils deviendront des marins, des pêcheurs. Elle explique à Jadi qu'ils sont tous ses enfants. Qu'ils resteront avec lui pour toujours. Jadi ne répond pas. Hoatu sait qu'il entend tout ce qu'elle dit, elle le voit à son visage, à l'ombre d'un sourire qui passe sur ses lèvres.
Parfois viennent des visiteurs. Des gens de la ville, des hommes, des femmes, qui ont entendu parler du Conseiller, qui cherchent un réconfort, une bénédiction. Ils apportent des fruits, du pain, des bouteilles de soda. Ils posent tout cela aux pieds de Jadi, en offrande. Avec l'aide de Hoatu, Jadi passe ses mains sur leur visage, sur leur crâne.
Lui qui a toujours écarté toute idée de religion. Lui qui disait que nous touchons et que nous sentons la seule éternité, celle du monde. Qu'il n'y a pas d'autre vérité que celle de la matière, et que nous sommes, avec nos sentiments et notre conscience, une simple fraction de l'intelligence de l'univers.
C'est comme si cette grande cour carrelée de bleu et de blanc, au cœur de l'hôtel, ornée de ses caoutchoucs et de ses cactées, était devenue le centre du monde, et que Jadi assis dans son fauteuil en était le pivot.
Campos a été reconquis par Aldaberto Aranzas, grand bien lui fesse. Peut-être l'avocat a-t-il cru, en lançant cette guerre contre l'homme qui a créé la véritable Ourania, peut-être a-t-il imaginé qu'il allait capturer la magie du lieu, s'en imprégner et devenir invincible ? Et aujourd'hui, il se retrouve à régner sur un morceau de montagne aride, humecté par un filet d'eau, une source intermittente soufrée, où ne subsistent que des ruines, monceaux de pierre, murs de pisé fondus par la pluie, un jardin déjà envahi de mauvaises herbes, et les machines laissées autrefois par les jésuites, pompes au mécanisme faussé, moulins édentés, tuberie mangée par le vert-de-gris, pareils à des ossements rejetés par la terre.
Enfin, arrive le moment du départ pour
Christian et Hoatu ont tout préparé. Ce qui subsiste de la troupe arc-en-ciel peut tenir dans deux bateaux de pêche. Raphaël et Oodham ont été chargés de réunir les provisions, essentiellement des boîtes de conserve et des sacs de riz achetés chez le Chinois, du lait en poudre, du savon, des allumettes, du pétrole lampant pour les réchauds, des bougies, des vaches à eau pour plusieurs semaines.
Les bateaux affrétés sont de vieilles barques en bois munies d'un moteur hors-bord à arbre long, aux voiles cent fois rapiécées. Une des embarcations s'appelle le Laughing Bird r piloté par un jeune du nom de Mario, l'autre le Wee Wee, dont le propriétaire est un vieux nommé Douglass. Les noms des bateaux et de leurs marins ont été une source d'hilarité pour les voyageurs. Ils ont quelque chose de pas sérieux, propre à conjurer l'angoisse.
Efrain et sa bande ne seront pas du voyage. Ils se sont installés dans des appartements meublés, dans le quartier du Fort George. Quand Raphaël est allé les voir, le groupe était dans le jardin, en train de fumer. Efrain s'est moqué de lui. Dans son jargon moitié portugais, moitié anglais, il lui a dit : « Vous êtes fous ! Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Vous allez mourir de soif ! »
Raphaël n'a pas répondu. Pour une fois, Efrain n'a pas tort. Le prisonnier en cavale semble avoir réalisé son rêve à Belize. Il pense qu'ici il pourra glisser entre les mailles de la justice, fumer son herbe et vivre au soleil. Il n'a pas demandé des nouvelles d'Adhara ni du bébé qui va naître.
Les pêcheurs parient le créole, mêlé de mots d'espagnol. Ils ont un bon sens de l'humour. Quand les voyageurs sont montés à bord du Wee Wee, en passant sur l'échelle de coupée, les enfants se sont plaints de l'odeur de poisson. Le vieux Douglass a dit : « Fishman neba say i fish stink » (un pêcheur ne dit jamais que le poisson pue). C'était approprié.
Il a fallu porter Jadi, un devant, un derrière. Il est raidi dans son effort, son visage contracté. Raphaël et Oodham l'ont installé à l'arrière du bateau, le dos calé contre un rouleau de cordes. Adhara s'est assise à l'avant, les jambes repliées de côté, telle une figure de proue.
Malgré l'heure matinale, le soleil brûle déjà. Sur les quais, des gens se sont arrêtés pour regarder le départ. Des touristes prennent des photos. Christian a payé le voyage de retour, les pêcheurs doivent revenir dans dix jours. Personne ne peut imaginer ce qui se passera ensuite.
Les bateaux sont sortis de l'embouchure de la rivière à la force des moteurs, contre le vent. La mer est plate, tachée d'alluvions. Dès qu'ils sont au large, on entend le bruit de la grande barrière, une sorte de ronflement qui couvre le bruit des moteurs. Le Laughing Bird et le Wee Wee marchent de conserve, à vingt mètres l'un de l'autre. Sur le premier, Oodham est à l'avant, Jadi à l'arrière avec les enfants, et Raphaël est à côté du pilote. Sur le deuxième, Hoatu est debout à la proue, agrippée au filin du mât. Adhara assise juste derrière elle, et Christian et les hommes à la poupe, à côté des provisions sous une bâche trouée. Mario montre à Raphaël une grande terre plate à l'horizon : « C'est Turneffe. » Les deux bateaux peinent sous la charge, le clapot lèche leurs bords.
Читать дальше