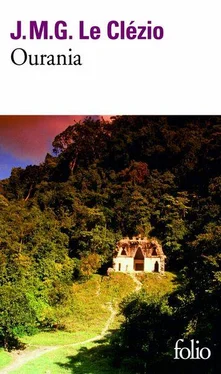Maintenant, dans la tourmente, Don Thomas était venu chercher son soutien. Il avait sans doute sous-estimé le pouvoir des intellectuels, ces gens de la capitale qui connaissaient les rouages de l'administration, et qui étaient capables de bloquer les crédits et de mettre en jeu la survie de l'institution plutôt que de renoncer à leur ambition. Il n'était pas prêt pour le pire.
Muni de ces informations, je pouvais apprécier la situation. Je m'étais reculé, un peu à l'écart, pour admirer la vue. Aranzas n'avait pas choisi l'emplacement de sa maison au hasard. De la terrasse, il embrassait toute la Vallée, la chaussée qui traversait les champs inondés, la tache sombre de la ville qui s'étendait jusqu'aux contreforts des montagnes et s'étirait vers le cul-de-sac de Campos. À certains moments, il pouvait vraiment croire qu'il en était le maître.
Sur les braseros, la viande grillait en dégageant une odeur délectable. Ce n'était pas le pique-nique rustique des anthropologues dans la tour Menendez. Ici, les serviteurs en veste blanche avaient mis à cuire de vraies pièces de bœuf, du « charolaïss » assaisonné de sauce rouge et d'oignons. Aussi les convives ne se faisaient pas prier.
J'ai rejoint un groupe où j'ai reconnu l'ombre de Don Thomas, la belle Ariana Luz. La femme d'Aranzas était avec elle, ainsi que Bertha, la femme de Don Chivas, et ses filles Aphrodite et Athena. Quand je me suis approché, Ariana a esquissé un sourire un peu crispé. Elle n'aimait pas les banalités. Elle a attaqué : « Tu as retrouvé ta protégée, cette fille du canal, comment l'appelles-tu ? » Ariana avait bu quelques verres, l'alcool la rendait agressive. « Liliana ? » ai-je dit. Elle ricanait. « Oui, c'est ça, Liliana, Lili, l'objet de la querelle. » La femme d'Aranzas se penchait, elle me regardait avec curiosité. « Une querelle, mais comme c'est romantique, racontez ! »
J'ai coupé court : « Il n'y a rien à raconter, c'est quelqu'un qui a disparu. »
Ariana ne voulait pas lâcher prise. Son visage anguleux avait une expression dure, tendue. « Disparu, mais où ça ? Elle n'est plus à Orandino, à l'adresse que je t'ai donnée ? »
La scène tournait au ridicule. Les éclats de voix ameutaient les invités. J'ai vu Don Thomas au bord du terrain, avec Menendez et Aranzas. J'ai arrêté Ariana : « Écoute, je suis juste venu pour prendre congé de Don Thomas. Je pars dans quelques jours, je ne sais pas si je reviendrai. » Éloignée du groupe des femmes, Ariana perdait ses raisons de parler fort. Elle s'est immobilisée, les bras ballants. « Ah oui, non, je ne savais pas. » J'ai eu envie de lui parler de Don Thomas, de toute cette cabale. Elle qui avait été l'oreille des séditieux, qui avait profité de la confiance de cet homme pour le trahir. Parfois il n'est pas nécessaire de parler pour dire les choses. Ariana a dû lire dans mes yeux ce que je pensais d'elle. Elle m'a regardé d'un air étrange, un regard qui passait à côté de moi, comme si elle fixait un point imaginaire, un peu en arrière, à ma droite. Je l'ai laissée.
Restait tout ce que je voulais dire à Aranzas, d'une voix enrouée de justicier. Lui montrer ce bout de la Vallée, cette tache où Campos existait encore, et qu'il avait décidé d'abolir d'un trait de plume pour étendre ses plantations, ou pour créer son futur lotissement, ça s'appellerait peut-être Cerro de las Campanas, ou El Cubilete, un nom qui plairait à tous les anciens combattants de la révolution. Pourquoi pas Padre Pro ? Une révolution chasse l'autre, n'est-ce pas ?
Dans la brume de l'après-midi, la Vallée paraissait l'endroit le plus paisible de la terre. Des fumées lentes s'étalaient, serpentaient au-dessus des champs. Dans les creux d'ombre, au pied des hautes montagnes, déjà les ampoules électriques s'allumaient, et les usines de congélation de fraises ressemblaient à de grands châteaux de contes de fées, avec leurs tours et leurs fossés. Seul Campos restait en dehors, silencieux, une île sombre au bout de la route.
Quelques jours plus tard, La Jornada a lancé l'attaque finale contre Campos, dans un éditorial sans signature, mais où il était facile de reconnaître la plume véhémente d'Alcibiade, alias Trigo. La république idéale du Conseiller y était décrite comme un refuge de vagabonds venus de l'étranger, où avaient cours la drogue, la promiscuité et les pratiques les plus condamnables de l'ex-mouvement hippie nord-américain.
Le Conseiller lui-même était peint sous les traits d'un gourou fanatique et dangereux, qui séquestrait les membres de sa secte après avoir pillé leurs économies. La caricature pouvait difficilement être prise au sérieux, mais elle signalait l'imminence des procédures légales pour expulser de Campos tous ses habitants. C'était une question de jours. J'ai décidé de repousser le voyage vers le Tepalcatepec jusqu'à ce que tout devienne clair. Et en effet, le lendemain de la parution du numéro de La Jornada , j'ai reçu, transmise par Raphaël, une lettre dictée par
ANTHONY MARTIN, LE CONSEILLER
« J'écris ceci, sachant que notre temps à Campos est compté.
« Je l'écris sans colère, car ce point final était prévu dès le moment où le rêve de Campos a pris forme. Mais non sans inquiétude, car j'ignore ce qui va advenir de tous ceux qui m'ont suivi, qui ont cru en moi, en la paix et l'harmonie de ce lieu. Je suis inquiet pour tous ceux, toutes celles qui ont travaillé de leurs mains pour construire ce village et créer ces champs, pour que le rêve ne soit pas une chimère mais devienne une réalité.
« À aucun moment je ne leur ai caché que notre vie ici était temporaire, que notre communauté ne pouvait être liée à la durée de notre séjour à Campos, puisque notre seul lien avec cette terre était un bail qui prend fin tôt ou tard.
« Je n'avais pas prévu qu'il prît fin aussi tôt. Peut-être n'ai-je pas été assez attentif aux signes précurseurs, à la rumeur, à la jalousie, à la diffamation ? Ou peut-être ai-je péché par naïveté, croyant avoir su dans ce pays inspirer la sympathie, voire l'enthousiasme, alors que ce n'étaient que paroles creuses, bulles de savon, vent de girouettes.
« Sans doute ai-je manqué de lucidité, de modestie.
J'ai été comme ce poète français, mon frère, qui après avoir couru le monde, au moment de rendre l'âme s'est écrié : déjà !
« Je ne peux plus reprendre racine quelque part. Je suis trop vieux, j'ai le cœur usé. Je l'ai dit à celui que je considère comme mon fils, à qui je confie le soin de cette lettre. Raphaël, que j'ai appelé Poussin à cause des sept étoiles qu'il a tatouées sur son poignet. Je lui ai dit, pour qu'il le répète aux autres : “Il faut partir, trouver une autre terre, mais sans moi.” Il m'a répondu : “Sans toi c'est impossible.” Je lui ai dit que le moment était venu de retourner au lieu de ma naissance, à Konawa sur la Canadian River, et il s'est caché les yeux pour pleurer. J'ai ressenti un déchirement au cœur que je ne croyais plus possible. Je pensais avoir tout prévu, jusqu'au dernier jour, et un enfant m'avait gardé cette surprise. Je lui ai parlé de la vie qui l'attendait, des pays qu'il allait parcourir, des amitiés nouvelles, de la liberté. Je me souvenais qu'à son âge j'avais tout quitté pour reconnaître le monde.
« Le déchirement, c'est de comprendre que j'avais donné à cet enfant, et à tous les habitants du village, l'illusion d'une protection sans fin, comme si nous avions élu domicile au paradis. De cela aussi je me sentais coupable. J'ai été dur avec Raphaël, alors que j'avais envie de pleurer avec lui. Je lui ai dit : “Qui te manquera ? N'as-tu pas Hoatu et Christian, tu les suivras, ils sont ta famille. N'as-tu pas un père qui a besoin de toi, dans ton pays ?” Mais l'enfant m'a dit avec entêtement : “Tu ne peux pas nous laisser. Sans toi nous n'arriverons jamais jusqu'à cette nouvelle terre que tu nous as promise.”
Читать дальше