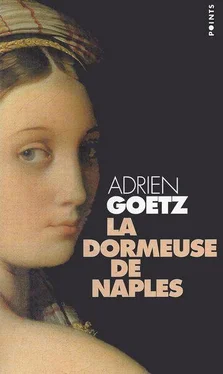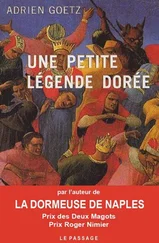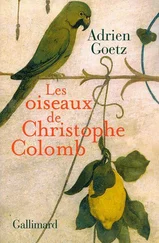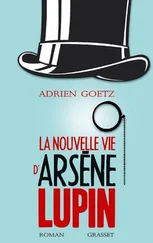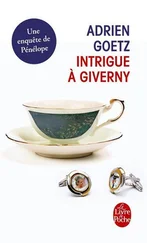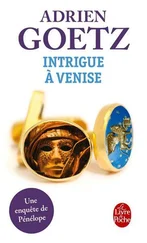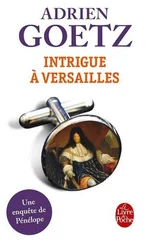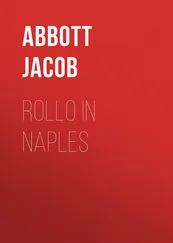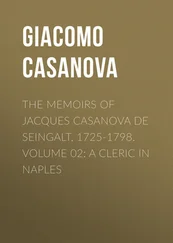« Une jolie femme, fit madame C.-M. ***, ne serait-ce pas, dites-moi, cette Dormeuse nue laissée par monsieur Ingres ? »
Je la regardai, stupéfait. Depuis près d’un demi-siècle, j’avais posé cette question à des centaines de personnes, à des prélats, à des Anglais, à des comédiens ambulants, à des capitaines au long cours, à des paysans de Barbizon qui ne savaient pas si Naples n’était pas le Kamtchatka. Je m’étais lassé. Enfin ! Dieu ne permettait pas que je meure sans avoir pénétré ce secret. Mes années de piété allaient avoir leur récompense. Merci à saint Vincent de Paul. Je restai coi. Elle me crut sourd et haussa d’une octave :
« C’est un tableau qui a compté pour moi plus que je ne saurais dire. Je l’ai vu souvent, il était chez madame de Narbonne, qui l’avait sauvé, dans la tourmente napolitaine de 1815, en le faisant mettre à la résidence de France. Une assez belle femme peinte, un peu canaille, mais que dirait-on maintenant, on la trouverait bien sage. C’était le style de monsieur Ingres, mais vous savez cela puisque vous êtes peintre. On peut dire qu’elle a été ma rivale, cette Dormeuse, et que je lui en ai voulu. »
Elle se lança alors dans son grand air, une histoire qu’elle devait parfaire depuis cinquante ans. Elle me fit comprendre qu’elle avait été du dernier bien avec un jeune peintre dont elle ne voulut pas me dire le nom — peut-être vivait-il encore sous les ors de l’institut — dont elle avait été folle. Elle l’avait connu à Naples du temps où elle était splendide et divine et unique et l’avait ensuite retrouvé à Paris. Il avait exigé d’elle une preuve d’amour étonnante. Il avait voulu qu’elle lui procure une autre femme. Une femme en peinture, qu’il avait vue à une réception chez les Narbonne. La tractation ne fut pas facile. La chanteuse dut promettre à l’ambassadrice trois saisons pour le San Carlo, d’être présente à vingt-sept dîners, de donner pour rien huit concerts devant le corps diplomatique, en échange de quoi le tableau prit la route de Paris. Elle s’était dévouée pour la France.
« Ce que le tableau est devenu ? Mais je n’en sais rien, nous nous sommes brouillés à cause de lui, c’était inévitable. Il l’aimait. Je crois bien qu’il l’a gardé, la brute, je ne sais pas ce qu’il en a fait. Il est détruit, ou alors il a été reconduit en Italie entre deux gendarmes. C’est ce que l’on m’a dit, oui, je me souviens vaguement que l’on m’en avait reparlé, mais vous dire qui, et où en Italie… » Je restai à méditer dans le coin du salon où nous nous étions mis. Je la regardai après quelque temps. Elle s’était endormie. J’observai ses paupières closes, je pensai malgré moi à saint Vincent de Paul momifié. Un sentiment étrange me pénétra. Un nouveau sacrilège, plus terrible encore que le premier. Trois cents jours d’indulgence en moins. Je n’eus rien le temps d’analyser, car l’hôtesse arrivait vers nous : « Alors, qu’est-ce que je vois, mon petit père Corot, toujours aussi fin causeur, vous avez réussi à endormir ma belle madame C.-M. ***, vous êtes bien le premier. Madame, s’il vous ennuie, je vous roule plus loin. Les paysagistes sont assommants comme la pluie. »
En partant, cette version féminine de la momie de saint Vincent de Paul me donna sa photographie par Nadar. Elle la tira doucement d’un petit porte-cartes en argent qu’elle avait dans le sac à ouvrages de dentelles noires qui lui réchauffait les genoux. Chez moi, je regardai le cliché de tous mes yeux. Elle était assez belle et la lumière venait bien sur ce visage de vieille femme. Je nettoyais ses rides, je tirais sur la peau de cette face comme un embaumeur, je remodelais ses lèvres, je la réveillais et je me demandais sans fin : « Si c’était elle ? »
« Ma rivale » avait-elle dit en souriant. Si c’était elle la femme peinte dont elle était jalouse ? La vieille madame C.-M. ***, cette diva édentée, la femme de ma vie. Il fallait me faire à l’idée. Je portais son deuil, elle était vivante, drapée de noir, je l’avais même hypnotisée. Si je la demandais en mariage ? Je pousserais son fauteuil mécanique. Je le repeindrais en bleu et en rose. J’irais dès que possible lui faire une visite. Je me jetterais sur l’impotente, je soulèverais ses jupes, je tirerais ses bas, je verrais bien si elle a une petite tache brune au mollet droit. Ce serait mon triomphe. Je me crus le héros d’un conte fantastique d’Hoffmann. J’étais prêt à vendre mon reste d’âme, à brader mes mois d’indulgence. Puis je n’osai pas. Je restai chez moi à penser à elle. Je tombai amoureux, dans le cours de la semaine suivante. Si j’avais eu l’esprit plus romantique, je l’eusse prise pour la Mort. Elle m’obsédait. J’étais sûr qu’elle avait les yeux de La Dormeuse. Je ne voulais pas aller la voir, j’attendais de la rencontrer à nouveau. On ne trousse pas si volontiers, même à mon âge, les jupons brodés de la Camarde. Peu de jours après, on m’annonça sa fin. Elle n’était pas venue me rechercher. Je n’étais pas allé la voir.
Elle avait dit : « Peut-être en Italie. » Elle en savait plus qu’elle n’en avouait.
*
Plus je vieillis, plus le souvenir de cette nuit dans les cavernes me revient et me hante. « Violette oubliée au jardin d’Horace », phrase séchée entre mes pages, je pleure en repensant à elle, à ce temps d’autrefois dans Rome. J’ai rouvert souvent ma fenêtre, pour peindre le paysage qu’elle encadre : à Ville d’Avray, chez nous, le petit chemin, l’étang et la maison Cabassud, à Orléans, les toits au faîte de tuiles avec la tour de Saint-Paterne, les jardins Boboli à Florence, à Rome encore quelquefois — mais je me souviendrai toujours du premier matin où, en Italie, j’avais écarté la table, pour placer mon chevalet devant le ciel. Ces journées ont été le meilleur de ma vie. J’ai encore bien des idées, le vieux père Corot prépare sa prochaine manière. Je vois tout autrement. C’est comme si je n’avais jamais su faire un ciel, car ce que je vois est bien plus rose, plus profond, plus transparent et plein d’odeurs. Ah, que je voudrais vous le rendre en quelques phrases, et vous montrer jusqu’où s’en vont ces immenses horizons. Mais à chacun son métier, vous viendrez à l’atelier. Je ne voudrais tout de même pas mourir sans avoir fait un chef-d’œuvre. Je suis vieux, je veux une nouvelle fois retourner en Italie. Je suis sûr que madame C.-M. *** m’a menti, qu’elle n’a dit la vérité qu’à demi. J’ai rangé son portrait dans mon tiroir de photographies et je la regarde parfois. J’aurais dû la faire parler plus.
J’irai chercher ma belle à Rome, j’irai à Naples, je veux la revoir, ouvrir mes yeux devant les siens. La Dormeuse pour laquelle je donnerais tous les paysages, les jardins Farnèse, le pont de Narni, le Pincio à la tombée du jour, la villa d’Hadrien à Tivoli, le petit Chaville, les étangs de Mortefontaine. Je donnerais même mes nuits sur la plage d’Ostie. J’irai en Italie en faisant vœu de ne rien voir, de ne rien entendre, de ne rien sentir, je m’empêcherai de respirer l’air de Rome, je me retiendrai de nager comme autrefois, j’avancerai à genoux, je passerai les Alpes sur un âne, je franchirai le Rubicon sur un pont de bateaux, j’irai baiser l’anneau du pape, je prêterai serment à Garibaldi, j’ouvrirai une boutique de perruques sur le Corso, je peindrai en jaune l’arc de Titus, je ferai tout ce que l’on voudra. Je ne veux pas mourir sans l’avoir revue. Il faut que je trouve la force de partir.
Ville d’Avray, Mortefontaine, 1866.
III
LA COURSE DE CHEVAUX LIBRES
(Rome et Naples en 1817)
Читать дальше