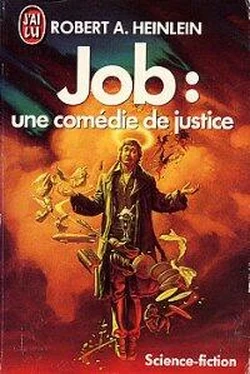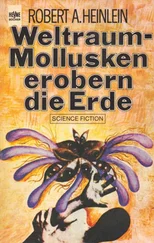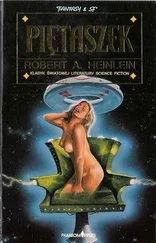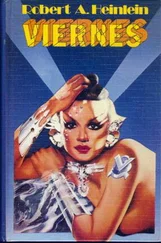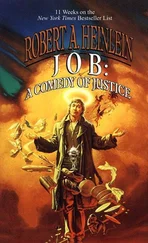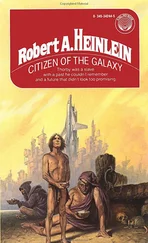Tous les matins je tuais des cafards et je nettoyais consciencieusement le sol. Et tous les soirs, avant de me retirer, je répandais encore un peu de poudre. Il est impossible (d’après moi) de venir à bout des cafards, mais on peut lutter et parvenir à les repousser et à maintenir un statu quo.
Quant à la qualité de ma vaisselle, il n’aurait pu en être autrement : ma mère souffrait d’une véritable phobie de la saleté et, comme je m’étais retrouvé dans une famille nombreuse, j’avais lavé ou essuyé des assiettes de sept à treize ans sous l’œil maternel vigilant. (Ensuite, j’avais obtenu mon diplôme de vendeur de journaux, ce qui ne m’avait plus guère laissé de temps pour la vaisselle.)
Mais n’allez pas croire que, si j’excellais à la vaisselle, je l’adorais pour autant. En fait, l’enfant que j’avais été détestait ça autant que l’homme que j’étais devenu.
Alors, pourquoi continuer ? Pourquoi ne pas m’enfuir ?
N’est-ce pas évident à vos yeux ? En faisant la vaisselle, je restais auprès de Margrethe. La fuite était sans nul doute très possible pour certains débiteurs – je ne pense pas que l’on faisait beaucoup d’efforts pour rattraper ceux qui disparaissaient par une nuit noire – mais c’était une entreprise plus difficile pour un couple marié dont la femme était d’un blond particulièrement frappant dans un pays où, de toute façon, n’importe quelle blonde était voyante, et dont le mari ne parlait pas un mot d’espagnol.
Certes, nous travaillions durement : douze heures par jour, de onze heures le matin à onze heures le soir, sauf le mardi, et deux heures de repos pour la siesta ainsi qu’une demi-heure pour chaque repas. Mais cela nous laissait les douze heures qui restaient, et notre mardi complet.
Même aux chutes du Niagara, nous n’aurions pu vivre une lune de miel aussi agréable. Nous disposions d’une petite pièce dans les combles, à l’arrière au restaurant. Il y faisait chaud mais nous n’y étions pas pendant la journée, et à onze heures du soir, il y faisait toujours bon, quelle qu’ait été la température durant la journée. A Mazatlan, la plupart des habitants de notre classe sociale (la plus infortunée !) n’avaient pas de salle d’eau. Mais nous travaillions et nous vivions dans un restaurant et nous pouvions partager des toilettes à chasse d’eau avec les autres employés pendant les heures de travail. Pendant les douze autres heures, elles étaient à notre seul usage. (Il y avait aussi des tinettes à broyeur au fond, que j’utilisais parfois pendant le travail, mais je crois que Margrethe s’en est toujours abstenue.)
Nous avions la jouissance d’une douche au rez-de-chaussée, juste à côté des toilettes des employés, et l’établissement, vaisselle oblige, disposait d’un énorme chauffe-eau. La Señora Valera était constamment sur notre dos pour nous reprocher d’utiliser trop d’eau chaude (« Le gaz coûte cher ! »), nous l’écoutions patiemment sans rien dire et nous continuions de prendre nos douches bien chaudes.
Le contrat que notre patron avait passé avec l’Etat l’obligeait à nous fournir le gîte et le couvert (et à nous vêtir, selon la loi, ce que je n’appris que bien trop tard).
C’est pourquoi nous mangions et dormions au restaurant. Pour la nourriture, elle n’avait rien de gastronomique, mais elle était bonne.
Mieux vaut vivre d’amour et d’eau fraîche… Nous étions l’un près de l’autre et cela nous suffisait.
Margrethe recevait régulièrement des pourboires, tout particulièrement des gringos, et elle faisait de petites économies. Nous dépensions le moins possible. Elle nous avait acheté des chaussures et constituait un petit pécule pour le jour où nous ne serions plus des peones et pourrions enfin aller vers le nord. Je ne me faisais pas d’illusions : la nation qui se situait au nord du Mexique n’était pas vraiment celle où j’étais né mais son équivalent dans ce monde-ci. Mais on y parlait l’anglais et j’avais la certitude que cette société devait être plus proche de ce que nous connaissions.
Les pourboires de Margrethe, dès la première semaine, amenèrent des frictions avec la Señora Valera. Si Don Jaime était légalement notre patrón , c’était elle la propriétaire du restaurant : c’est du moins ce que nous avait appris Amanda la cuisinière. Jaime Valera avait autrefois été serveur ici même et il avait épousé la fille du propriétaire. Ce qui avait fait de lui le maître d’hôtel [11] En français dans le texte. ( N.d.T .)
attitré. A la mort de son beau-père, il était devenu le propriétaire du restaurant, tout au moins aux yeux du public. Mais c’était sa femme qui tenait les cordons de la bourse et qui trônait derrière la caisse enregistreuse.
(Peut-être serait-il utile que j’ajoute qu’il était pour nous Don Jaime parce qu’il était notre patrón , mais pas aux yeux du public. Le Don honorifique ne se traduit pas en anglais. Etre propriétaire d’un restaurant ne faisait pas de lui un Don comme, par exemple, la fonction de juge.)
La première fois que la Señora surprit Margrethe recevant un pourboire, elle lui demanda de le lui restituer : à la fin de chaque semaine, elle lui donnerait un pourcentage.
Margrethe me rejoignit précipitamment dans l’arrière-cuisine.
— Alec, que dois-je faire ? Sur le Konge Knut , les pourboires représentaient mon principal salaire et personne ne m’a jamais demandé de les partager. Est-ce qu’elle peut vraiment exiger cela ?
Je lui dis de ne pas restituer ses pourboires à la Señora et de lui dire plutôt que je voulais en discuter avec elle le soir même.
C’est là un des avantages de la condition de peón : on ne risque pas de se faire virer pour un désaccord avec le patron. Bien sûr, les Valera auraient pu nous jeter dehors… mais ils auraient du même coup perdu les dix mille pesos qu’ils avaient investis.
A la fin de la journée, je savais exactement quoi dire et comment le dire : en réalité, c’est Margrethe qui le dirait puisque j’estimais qu’il me faudrait encore un mois avant que j’assimile suffisamment l’espagnol pour un minimum de conversation.
— Monsieur, madame, nous ne comprenons pas ce règlement qui interdit les cadeaux. Nous désirons consulter le juge afin de lui demander ce que stipule le contrat.
Comme je m’y étais attendu, ils n’avaient pas la moindre envie de voir le juge se mêler de ça. Légalement, Margrethe était à leur service mais ils n’avaient aucun droit sur l’argent qui pouvait lui être donné par un tiers.
Mais ce n’était pas fini. La Señora était tellement furieuse de s’être fait rembarrer par une simple serveuse qu’elle fit immédiatement apposer un écriteau : NO PROPINAS – POURBOIRE INTERDIT. La même notice figura sur le menu.
Les peones ne peuvent pas se mettre en grève. Mais il y avait cinq autres serveuses, dont deux des filles d’Amanda. Le jour même où la Señora Valera interdit les pourboires, elle se retrouva avec une seule et unique serveuse (Margrethe) et personne aux cuisines. Elle décida d’abandonner le combat. Mais je suis convaincu qu’elle ne nous a jamais pardonné.
Don Jaime nous traitait comme des employés alors que sa femme nous considérait comme des esclaves. En dépit du bon vieux cliché sur l’« esclavage rémunéré », il existe un monde de différences. L’un et l’autre nous faisions tout notre possible pour être des employés dévoués tout en épongeant notre dette, mais nous refusions absolument d’être des esclaves, et il était inévitable que nous finissions par nous accrocher avec la Señora Valera.
Читать дальше