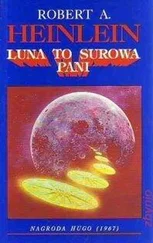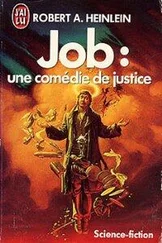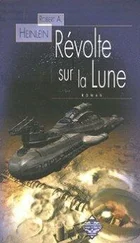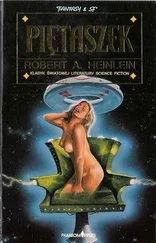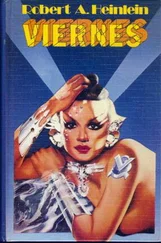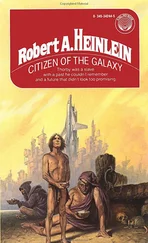Robert Anson Heinlein
Une porte sur l’été
Par un des hivers qui précéda de peu la guerre de Six Semaines, j’habitais avec mon chat de gouttière, Petronius le Sage, une vieille ferme dans le Connecticut. Je doute qu’elle s’y trouve encore ; elle était située en bordure de la zone qui fut soufflée, et Manhattan n’échappa à la destruction que de justesse. Ces vieilles baraques flambent comme du papier de soie. Serait-elle encore debout, elle ne constituerait plus qu’un logis peu attirant, en raison du voisinage actuel. Pourtant, à l’époque, nous l’aimions bien, Pete et moi. Le manque total de confort nous permettait de bénéficier d’un loyer modeste. Ce qui avait été une salle à manger donnait au nord ; je jouissais donc d’un éclairage adéquat lorsque je travaillais sur ma planche à dessin.
Toute médaille a son revers. Cette maison avait un défaut : ses onze portes de sortie.
Douze, en comptant la chatière de Pete.
J’ai toujours essayé, partout, d’aménager une chatière pour Pete : en l’occurrence, une planche remplaçant la fenêtre d’une chambre à coucher inoccupée avait été percée d’un orifice de la largeur de ses moustaches. De trop nombreuses heures de ma vie ont été passées à ouvrir des portes aux chats. Depuis l’aube de la civilisation, 978 siècles de temps humain ont au total été employés à ce geste ; j’en ai fait le compte, les chiffres sont là pour vous le prouver.
Donc, habituellement, Pete utilisait sa chatière, sauf s’il parvenait à m’obliger à lui ouvrir une porte, ce qui le comblait d’aise. Mais il refusait d’employer la chatière par temps de neige.
Durant son enfance de chaton, alors qu’il n’était encore qu’une boule duveteuse et bondissante, Pete s’était élaboré une philosophie toute personnelle : j’avais la charge du logis, de la nourriture et de la météorologie. Lui était chargé du reste. Il me rendait tout particulièrement responsable du temps qu’il faisait. Les hivers du Connecticut ne sont jolis que sur les cartes de Noël. Cet hiver-là, très régulièrement, Pete allait jeter un coup d’œil à sa chatière, et, se refusant à emprunter ce chemin recouvert d’une déplaisante matière blanche – il n’était pas fou – venait me tanner jusqu’à ce que je lui ouvre une porte.
Il avait la conviction inébranlable que l’une d’elles, au moins, devait s’ouvrir en plein soleil – s’ouvrir sur l’été. Il me fallait donc, chaque fois, faire le tour des onze portes en sa compagnie, les lui ouvrir l’une après l’autre, et lui faire constater que l’hiver sévissait également, tandis que ses critiques sur mon organisation défectueuse s’élevaient crescendo à chaque déception.
Il s’obstinait ensuite à ne pas sortir tant qu’il n’y était pas absolument forcé par ses propres contingences internes.
Lorsqu’il rentrait, la glace collée à ses petites pattes silencieuses faisait un bruit de claquettes sur le plancher. Il braquait sur moi un regard foudroyant et refusait de ronronner jusqu’à ce que tout fût léché, séché. Alors seulement, il me pardonnait… jusqu’à la sortie suivante.
Mais il n’abandonna jamais sa recherche de la porte ouvrant sur l’été.
Le 3 décembre 1970, je la cherchais, moi aussi.
Ma quête était à peu près aussi désespérée que l’avait été celle de Pete en ces hivers du Connecticut. Le peu de neige existant en Californie du Sud se cantonnait sur les montagnes, pour les skieurs, non loin de Los Angeles. Elle ne serait d’ailleurs pas parvenue à traverser le brouillard de fumées qui planait sur la ville. Cependant, l’hiver était dans mon cœur.
Non que je fusse malade (mis à part une gueule de bois permanente) : j’étais du bon côté de la trentaine pour quelques jours encore, et loin d’être dans la dèche. Ni police, ni mari outragé, ni plaignant d’aucune sorte ne me cherchait. En fait, je n’avais rien qu’un peu d’amnésie n’eût guéri. Mais l’hiver était dans mon cœur, et je cherchais la porte qui aurait donné sur le soleil.
Si je vous fais l’effet d’un homme qui s’apitoie complaisamment sur son sort, vous êtes dans le vrai. J’aurais pu me dire qu’il existait sur cette planète plus de deux milliards de gens en plus mauvaise forme que moi. N’empêche, je cherchais cette porte sur l’été.
La plupart de celles que j’avais essayées dernièrement étaient des portes de bar, du genre de celle qui se dressait précisément devant moi à ce moment-là.
Grill-Bar Sans Souci, disait l’enseigne. J’entrai, repérai une table dans un box, vers le milieu de la salle, posai soigneusement sur la banquette le fourre-tout que je portais, me glissai à côté et attendis le garçon.
— Ouonné, souffla le fourre-tout.
— Vas-y doux, Pete, répondis-je.
— Mnan !
— Pas question ! Tu viens d’y aller. Boucle-la, voilà le garçon.
Pete se tut. Je levai la tête.
— Un double scotch maison, un verre d’eau fraîche et un ginger ale.
Le garçon sembla contrarié.
— Du ginger ale, monsieur ? Avec du scotch ?
— En avez-vous, oui ou non ?
— Bien sûr, monsieur, mais…
— Dans ce cas, apportez-le. Je ne le boirai pas, c’est pour la vue… Et apportez également une soucoupe.
— A votre gré, monsieur. (Il donna un coup de torchon sur la table :) Que diriez-vous d’un bon petit steak, monsieur ? Je vous recommande également nos coquilles Saint-Jacques.
— Écoutez, mon vieux, je veux ce que je vous ai commandé, rien de plus. Et n’oubliez pas la soucoupe.
Il n’insista pas et disparut. Je recommandai à Pete de ne pas se faire de souci et lui promis qu’on allait se régaler. Le garçon revint, portant fièrement le ginger ale sur la soucoupe. Il l’ouvrit pendant que je mélangeais le scotch et l’eau.
— Voulez-vous un autre verre pour le ginger ale, monsieur ?
— Merci, je suis un vrai de vrai. Je bois à même la bouteille.
Il se tut et je le payai, ajoutant un généreux pourboire.
Dès qu’il eut tourné le dos, je versai le ginger ale dans la soucoupe et tapai légèrement sur le fourre-tout.
— A la soupe, Pete !
Je ne fermais jamais la fermeture à glissière du fourre-tout lorsque Pete s’y trouvait. Il écarta l’ouverture à l’aide de ses pattes, passa la tête et lança un coup d’œil circulaire. Puis il se dressa et posa ses pattes sur le bord de la table. Je levai mon verre et nous échangeâmes un regard complice.
— A la santé des femmes, Pete. Trouvons-en, et oublions-les aussi vite !
Il acquiesça des oreilles, ma réflexion étant l’expression même de sa philosophie personnelle. Puis, penchant délicatement la tête vers le ginger ale, il se mit à laper.
— Enfin, si on peut ! ajoutai-je avant d’ingurgiter une longue goulée de scotch.
Pete ne répondit pas. Oublier une compagne ne représentait pas un effort pour lui : c’était un célibataire-né.
De l’autre côté de la rue, clignotait une publicité lumineuse. Elle changeait sans cesse : « travaillez en dormant » disait-elle ; « oubliez vos ennuis en rêvant » poursuivait le texte, qui doublait de dimension pour conclure :
MUTUAL ASSURANCE COMPANY
Je lus ces annonces plusieurs fois sans y prêter attention. Je n’en connaissais pas plus que tout un chacun sur l’« animation suspendue ». J’avais lu différents articles de vulgarisation lorsqu’on avait commencé à en parler, et je recevais deux ou trois fois par semaine des prospectus de maisons d’assurances à ce sujet. Habituellement, je les jetais sans les regarder, ils ne me concernaient pas plus que les publicités pour rouge à lèvres.
Читать дальше