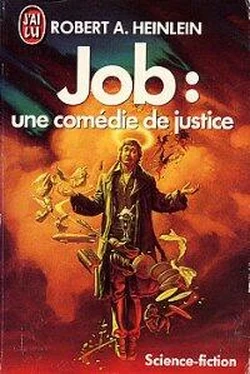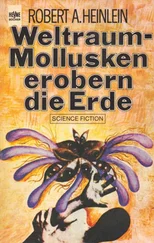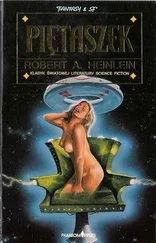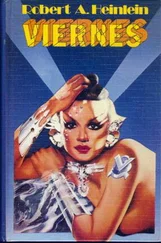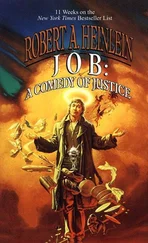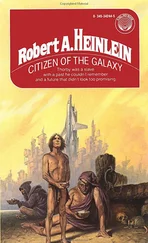Nous nous sommes finalement posés. Et personne n’a été tué. Mais les aéronefs sont tellement mieux !
Ah, le déjeuner ! Tout se terminait magnifiquement !
C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre.
Genèse, 3:19
Une demi-heure après que la machine volante se fut posée dans le port de Mazatlan, Margrethe et moi étions assis en compagnie du sergent Dominguez dans le réfectoire de la troupe. Il était tard pour le déjeuner, mais on nous servit. Et j’avais enfin trouvé des vêtements. Enfin, quelques-uns, et avant tout un treillis. Mais la différence entre la nudité absolue et un pantalon est plus grande qu’entre un pauvre treillis de travail et l’hermine la plus fine. Essayez et vous verrez.
Un petit bateau avait rejoint le point d’amarrage de la machine volante. Ensuite, j’avais été obligé de traverser l’embarcadère jusqu’au bâtiment du quartier général où j’avais attendu qu’on me trouve un pantalon. Des étrangers défilaient sans arrêt et me regardaient. Parmi eux, de nombreuses femmes. Et je sais maintenant ce que l’on éprouve lorsqu’on est cloué au pilori. C’est effroyable ! Jamais, depuis ce fâcheux incident qui s’est produit un certain dimanche à l’école quand j’avais cinq ans, je n’avais été aussi embarrassé.
Mais, à présent, c’était oublié et il y avait de la nourriture et de la boisson devant nous. Pour le moment, j’étais profondément heureux. La nourriture ne m’était pas familière. Qui a dit que ventre affamé n’a pas d’oreilles ? Parce qu’il avait tout à fait raison : le repas était délicieux. De petites galettes de maïs trempées dans la sauce, avec des haricots poêlés, un ragoût particulièrement relevé, un plat de petites tomates jaunes et du café très noir, amer et fort. Que demander de mieux ? Aucun gourmet n’a jamais connu pareille fête.
(Tout d’abord, j’avais été quelque peu froissé de constater que nous mangions dans le réfectoire des hommes de troupe et non avec le lieutenant Sanz, au mess des officiers. Bien plus tard, on me fit remarquer que je souffrais d’un syndrome civil très répandu : un civil sans expérience militaire tend toujours à considérer que son rang social est l’équivalent de celui d’un officier et non d’un homme de troupe. Si l’on y réfléchit bien cette notion est à l’évidence ridicule, quoique presque universellement répandue. En tout cas en Amérique… où un homme « vaut n’importe quel autre et mieux que la plupart ».)
Le sergent Dominguez avait récupéré sa chemise. Pendant qu’on me trouvait un pantalon, une femme (une femme de ménage, selon moi ; les Gardes-Côtes mexicains ne semblaient pas avoir défini une hiérarchie féminine), une femme du quartier général, donc, était partie en quête de vêtements pour Margrethe. Ceux-ci s’avérèrent être une blouse et une jupe de coton aux couleurs vives. C’était à l’évidence une tenue modeste et de peu de prix, mais elle allait à ravir à Margrethe.
Mais nous n’avions ni l’un ni l’autre de chaussures. Le temps était chaud et sec, de toute manière, et cela pouvait attendre. Nous avions bien mangé, nous étions sains et saufs et nous avions retrouvé des vêtements. Et puis, il y avait cette hospitalité chaleureuse qui me donnait le sentiment que les Mexicains étaient le peuple le plus affable de la Terre.
Après ma deuxième tasse de café, j’ai demandé à Margrethe :
— Mon amour, comment pouvons-nous nous retirer sans paraître impolis ? Je crois que nous devrions aller au consulat américain sans perdre de temps.
— Il faut retourner au quartier général.
— Encore de la paperasse ?
— On peut appeler ça comme ça. Je crois qu’ils veulent nous questionner de manière plus détaillée pour savoir comment nous sommes arrivés et où on nous a retrouvés. Il faut reconnaître que notre histoire est plutôt bizarre.
— Oui, je le crois sans peine.
Notre première entrevue avec le commandant avait été loin d’être satisfaisante. Si j’avais été seul, je pense qu’il m’aurait carrément traité de menteur… mais il était difficile pour un homme aussi infatué de son ego masculin de s’adresser de la sorte à Margrethe.
L’ennui, c’était avant tout notre bon vieux Konge Knut .
Il n’avait pas coulé, il n’était pas au port : il n’avait jamais existé.
Je n’étais que modérément surpris. S’il s’était transformé en trois-mâts ou en quinquérème, je n’aurais pas été surpris du tout. Mais j’avais plus ou moins espéré un vaisseau qui aurait porté le même nom : j’estimais que les règles l’exigeaient. Mais, à présent, il devenait évident que je ne comprenais pas les règles. S’il y en avait.
Margrethe m’avait fait remarquer un facteur qui confirmait tout ce que je craignais : ce Mazatlan-là n’avait rien à voir avec la ville qu’elle avait déjà visitée. Elle était plus petite et ce n’était pas une ville touristique : en fait, le long quai où le Konge Knut aurait dû s’amarrer n’existait pas dans ce monde-ci. Je crois que ce fait, ajouté à l’existence des machines volantes, lui avait amplement prouvé que ma « paranoïa » était l’hypothèse la moins probable qui fût. Lorsqu’elle était venue à Mazatlan, le quai était long et vaste. Or, il n’existait plus et cela l’avait particulièrement secouée.
Le commandant ne s’était pas montré impressionné. Il avait passé plus de temps à poser des questions au lieutenant Sanz qu’à nous interroger. Il semblait plutôt fâché contre Sanz.
Un autre facteur était apparu que je ne comprenais pas sur le moment et qu’en fait je n’ai jamais vraiment compris. Le supérieur de Sanz était « capitaine » (ou capitan ). Le commandant lui aussi avait le grade de capitaine. Mais l’un et l’autre n’étaient pas du même rang.
Les Gardes-Côtes utilisaient les grades de la marine. Pourtant, ceux qui conduisaient les machines volantes avaient des grades de l’armée de terre. Je suppose que cette différence avait une origine historique. Et cela pouvait expliquer la friction : un capitaine de marine n’était nullement disposé à accepter comme parole d’évangile le rapport d’un officier de machine volante.
Le lieutenant Sanz avait ramené deux survivants nus qui racontaient une incroyable histoire. L’officier à quatre galons semblait en vouloir particulièrement à Sanz pour tous les aspects invraisemblables de notre récit.
Mais Sanz n’était pas intimidé. Je me dis qu’il n’avait sans doute aucun respect pour un supérieur qui n’avait jamais volé plus haut qu’un nid de corbeau. (Ayant fait l’expérience de son cercueil volant, je comprenais très bien qu’il ne devait pas être enclin à se prosterner devant un vulgaire marin. Même parmi les pilotes de dirigeables, j’avais rencontré cette tendance à diviser le monde en deux races : ceux qui volent et ceux qui ne volent pas.)
Après un moment, s’apercevant qu’il ne parvenait pas à ébranler Sanz et qu’il ne pouvait communiquer avec moi que par l’entremise de Margrethe, le commandant avait haussé les épaules et donné quelques instructions qui avaient eu pour effet de nous amener devant un déjeuner. J’avais cru sur le moment que nous en resterions là, mais il s’avérait que l’interrogatoire allait reprendre, où que cela dût nous mener.
Notre deuxième entrevue avec le commandant fut brève. Il nous fit savoir que nous rencontrerions le juge à l’immigration à quatre heures, ce même après-midi – ou du moins la cour chargée de cette juridiction, car il n’existait pas de cour indépendante pour les affaires d’immigration. En attendant, nous avions une liste de frais à payer et nous devions voir avec le juge les possibles conditions de règlement.
Читать дальше